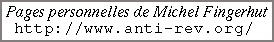

Après avoir quitté Auschwitz le 18 janvier 1945 et avoir marché pendant trois jours, poussées sur les routes par les SS, nous avons été entassées dans des wagons de marchandises découverts et avons voyagé ainsi sous la neige jusqu'à Bergen-Belsen où nous sommes arrivées à peu près au moment où Auschwitz était libéré.
Devant le portail du camp, ma mère a trouvé par terre un petit croûton de pain desséché ; elle m'a dit: « C'est un mauvais présage, ici nous allons mourir de faim ». Son pressentiment s'est révélé exact. A Bergen-Belsen il n'y avait plus de Zeilappel, on ne travaillait pas, mais on ne nous donnait presque plus rien à manger, et nous fûmes très vite affaiblies et envahies par la vermine et les poux.
A part la perpétuelle recherche de nourriture à voler près des cuisines ou à déterrer du sol, notre principale occupation consistait à épouiller notre couverture, nos vêtements, notre corps et surtout notre tête. Malgré cela les poux continuaient à pulluler ainsi que les rats et une épidémie de typhus se déclara, qui fit 17 000 victimes en trois semaines, nous dit-on par la suite. C'était début mars 1945.
Tous les jours nous étions réquisitionnées à coups de schlague pour sortir les cadavres des blocks et les traîner par les bras et les jambes jusqu'à un tas sur lequel on devait les balancer. Le tas s'élevait et s'allongeait de plus en plus. Quant à nous, complètement blasées, nous éprouvions un petit pincement au coeur uniquement lorsque disparaissait un être très proche, parente ou amie.
Aujourd'hui, j'ai donc eu 17 ans et reçu un merveilleux cadeau: le typhus! Dans mon délire je crie que je ne reverrai plus Paris et j'entends la voix de ma mère: « Si, tu reverras Paris, je te le jure! » Ma mère s'est si bien démenée en chipant à la cuisine de l'eau chaude qu'elle nous distribuait avec la même cuiller, à deux amies malades et à moi, elle a déployé une telle énergie qu'elle nous a effectivement tirées du néant toutes les trois. Au bout de deux semaines la fièvre est tombée et c'est alors que j'ai recommencé à avoir faim. Malheureusement, on ne nous donnait plus qu'un rutabaga pour vingt par jour. Je m'affaiblissais de plus en plus. Alors ma mère a eu une autre de ses intuitions. Elle s'était débrouillée pour porter la soupe au block « Revier » (c'était l'hôpital où l'on mourait autant que dans les autres blocks, faute de médicaments, mais où on distribuait de la soupe) ; en échange, elle recevait un demi-litre de soupe qu'il fallait manger sur place.
Ma mère m'a donc traînée, titubante, jusqu'aux cuisines. On portait le baril de soupe à quatre, deux de chaque côté. Elle s'est mise derrière moi pour pouvoir me pousser dans le dos et me faire avancer. Devant le block s'entassaient des cadavres souillés. L'odeur était épouvantable. Ce premier demi-litre de soupe, je l'ai vomi aussitôt avalé, mais le lendemain j'ai pu garder la nourriture et c'est ainsi que j'ai repris quelques forces, après une semaine de ce travail.
Nous devions être dans la deuxième semaine d'avril. Depuis une dizaine de jours nous entendions des bruits de canon et des détonations. Les Allemands avaient mis le drapeau blanc sur le bâtiment administratif. Et tout à coup, plus de bruit de canon, plus de détonations! Dans nos esprits malades a surgi une pensée: « Ils ont contourné le camp et ne nous ont pas libérées! Nous allons toutes mourir ici! »
Puis une nuit, j'ai fait un rêve étrange... Je nageais sous l'eau, une eau glauque envahie d'herbes, vraisemblablement un étang, et chaque fois que je voulais remonter à la surface pour prendre l'air, ma tête heurtait une couche de glace. Je ne pouvais plus respirer. Au moment où j'allais sombrer dans l'inconscience, j'ai fait un dernier effort vers la surface et ma tête a émergé d'un trou dans la glace. J'ai repris souffle avec délices.
Le lendemain, nous étions libérées. C'était le 15 avril 1945.
Vers la fin de la matinée, nous avons entendu une voix sonore qui disait dans toutes les langues, par haut-parleur: « Ici la 1re armée anglaise. Vous êtes libérées ». Celles qui pouvaient encore marcher se sont traînées dehors et ont vu des Jeeps et des camions entrer dans le camp. Nous n'osions y croire et eux, les soldats anglais, horrifiés, ne croyaient pas ce qu'ils voyaient: une légion de « musulmans », zombies ambulants, décharnés, aux yeux vides, des mourants gisant sur le sol et des monceaux de cadavres.
Un des camions s'est arrêté près de notre block ; on a ouvert les portes arrières, et devant nos yeux émerveillés est apparue une montagne de pains. Nous nous sommes précipitées en nous bousculant vers cette manne et j'ai rassemblé mes souvenirs d'anglais du lycée pour demander un morceau de pain à l'un des soldats qui le distribuaient. II m'a regardée avec tendresse et m'a dit en yiddish: « Red mamelouschen » (parle ta langue maternelle) — c'était un juif anglais. La, j'ai enfin commencé à sentir que nous étions libres.
Les barbelés entre le camp des femmes et celui des hommes ont été cisaillés , les gens à peu près valides ont pillé les magasins du camp. Cette première nuit de liberté fut une nuit magique, une nuit de fraternité. Dans tout le camp brillaient des feux sur lesquels les gens faisaient cuire des soupes de farine roussie et de pommes de terre. Nous allions d'un groupe à l'autre, partageant soupe et joie.
Hélas, beaucoup d'entre nous moururent après la libération. Les grands malades avaient été transportés par avion vers des hôpitaux, mais pour certains ce fut trop tard. Quant à nous, les soi-disant valides, nous n'avions que ce que les Anglais pouvaient nous donner, les rations de l'armée, soupe et lait en boîtes, beaucoup trop gras et riches pour nos estomacs rétrécis et nos organismes épuisés. Une épidémie de dysenterie fit de nombreuses victimes.
II y avait près de Bergen-Belsen un camp de prisonniers, le stalag IIB. Quand ils surent que dans le camp libéré se trouvaient des Françaises, les prisonniers français vinrent nous voir et restèrent muets devant nous ; puis ils nous dirent: « On croyait qu'on avait souffert mais, à côté de vous, c'était de la rigolade! ». Ils ne savaient plus quoi faire pour nous. Ils abattaient des vaches dans les champs pour nous apporter de la viande rouge: ils nous bourraient de sardines à l'huile et de chocolat, ce qui n'était pas indiqué du tout pour nous, mais leur compassion et leur sollicitude nous faisaient chaud au coeur. J'ai encore la mandoline et l'harmonica que l'un d'eux nous a donnés. Un autre m'a fait cadeau de sa valise en bois, marquée K.G. (Kriegs Gefangener -- Prisonnier de Guerre) que j'ai traînée à travers l'Allemagne, pleine de coupons de tissu et de l'édition complète du « Comte de Monte-Cristo » d'Alexandre Dumas, portant le tampon de la bibliothèque du stalag.
Avant de nous transférer à Bergen dans des casernes militaires plus confortables que le camp (destiné de toute façon à être brûlé), les Anglais nous passèrent au DDT — insecticide puissant — pour tuer tous les poux. Pour nous qui avions l'habitude de nous montrer nues devant les SS, c'était une banalité mais ces pauvres tommies nous aspergeaient de DDT en détournant la tête et en rougissant. Cela nous a bien fait rire.
Au bout d'un mois de « convalescence », nous traversâmes l'Allemagne dans des camions, en chantant la Marseillaise. Nous voyions les villes bombardées et les gens cherchant dans les décombres, en quête de souvenirs et surtout de nourriture. Ils ressemblaient à ce que nous étions peu de temps auparavant, mais nous ne pouvions pas ressentir de pitié car nous avions le coeur endurci et toujours nous hantait la pensée qu'ils savaient ce qui se passait dans les camps.
Le 24 mai 1945, un an jour pour jour après notre arrestation (le 24 mai 1944), notre train entrait en Gare du Nord où nous accueillit une fanfare jouant la Marseillaise, ce qui nous fit tout de même monter les larmes aux yeux.
Ensuite, il a bien fallu réapprendre à vivre dans une société « normale »
Sarah Montard
Matricule A 7142
____________________________
Server / Server
© Michel Fingerhut 1996-2001 - document mis à jour le 14/11/1998 à 16h52m40s.
Pour écrire au serveur (PAS à l'auteur)/To write to the server (NOT to the author): MESSAGE