


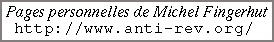

Elle est assise sur un bout de canapé et la caméra tourne. Plein cadre sur son visage. On perçoit son souffle trop court, une tension à fleur de peau, de coeur, un noeud d'émotions. Elle nous échappe pourtant. Ses yeux éteints fixent quelque chose que l'objectif est inapte à capter. Quelque chose qui l'isole à jamais : les images d'une autre vie. Les images d'avant sa mort. C'est de là-bas qu'elle parle, par-delà les décennies, risquant le dangereux voyage dans sa mémoire, l'improbable collision de son passé et de notre présent. La caméra ne quitte pas ses yeux sombres, mais c'est sa voix, calme, presque atone, qui nous indique le chemin.
1942, descente des nazis dans le ghetto de Kovno, en Pologne : cris, affolement, course, embarquement dans des cars bondés. Et sur un terrain d'aviation, à quelques pas de trains en attente, premier tri de la population : d'un côté les hommes, de l'autre les femmes, ailleurs les enfants. Son nouveau-né dans les bras, une jeune femme regarde autour d'elle, hagarde.
Bessie K. Je tenais le bébé, et j'ai pris mon manteau, et j'ai emballé le bébé, je l'ai mis sur mon côté gauche car je voyais les Allemands dire « gauche » ou « droite », et je suis passée au travers avec le bébé. Mais le bébé manquait d'air et a commencé à s'étouffer et à pleurer. Alors l'Allemand m'a rappelée, il a dit : « Qu'est-ce que vous avez là ? « Maintenant... (elle marque une pause) Je ne savais pas quoi faire parce que cela allait vite et tout était arrivé si soudainement. Je n'y était pas préparée (...)Il a tendu son bras pour que je lui tende le paquet ; et je lui ai tendu le paquet. Et c'est la dernière fois que j'ai eu le paquet.
Depuis ce moment-là, dit-elle, ( malgré la présence à l'autre bout du canapé de son second mari, également rescapé des camps ) « j'ai toujours été seule », incapable d'en parler et même de s'en souvenir. Avec le sentiment d'être morte. Sans doute livre-t-elle là, dans ce petit studio de vidéo de l'université de Yale, à deux heures de New York, ce qu'elle n'avait jamais confié auparavant, ce qui était enfoui, indicible, mutilant. Quelques fragments d'elle-même, camouflés sous des couches de mémoire si profondes qu'elle les avait rendues inexplorables. Trop dangereuses. Douloureuses à l'extrême.
Elle dit, avec des mots très simples et avec son visage fané, ses frémissements, sa voix, ce que les livres d'Histoire ne diront jamais de la Shoah. Elle impose sa douleur sur un terrain où l'accumulation de discours politiques, de décrets administratifs, de notes, de chiffres, de rapports, ont fini par édulcorer la réalité de la mort. Elle recentre l'Histoire sur le sort des victimes qui avaient toutes un nom, un passé, ébréchant, par ce morceau d'humanité, la carapace monstrueuse, inaccessible de la Shoah.
Et c'est bien là le but du programme d'archivage vidéo de Yale (Fortunoff Video Archive for Holocaust Testimonies) qui, depuis 1979, a déjà recueilli aux Etats-Unis, en Israël et dans plusieurs pays d'Europe dont la France plus de trois mille récits de rescapés du génocide juif. « Parce que l'histoire orale, dont se méfient traditionnellement les historiens est un matériau irremplaçable, affirme le professeur Geoffrey Hartman, qui supervise le projet. Parce que le témoignage touche au plus près à la réalité du génocide, en montre toute la complexité humaine, en établit les résonances dans le présent. Parce qu'il apporte des informations qui enrichissent la connaissance conférée par le document écrit, mais plus encore que cela. »
Les rescapés, au fond, le savent mieux que quiconque, conscients de partager ensemble un savoir aussi inouï qu'exclusif : celui d'une autre « planète » ; celui d'un monde qui échappe aux canevas habituels de la recherche historique, hermétique aux normes ou aux valeurs communément admises, étranger à la raison des hommes, qu'ils n'ont jamais pu totalement quitter. « Comme si on menait une double vie. »
Isabella L. J'ai l'impression que ma tête est pleine d'ordures : toutes ces images, ces sons, mes narines, sont remplies de la puanteur de la chair brûlante. Vous ne pouvez pas en avoir l'expérience ; c'est comme s'il y avait une autre peau sous la mienne et que cette peau s'appelait Auschwitz. Impossible à ôter, là à chaque instant... C'est vraiment plus dur quand on porte ça. Je ne suis pas comme vous.
Ils n'ont de cesse de le dire, obsédés par « l'anormalité », incapables d'insérer l'expérience du camp dans la chronologie de leur vie. Auschwitz ne constitue pas un épisode de leur histoire. Auschwitz est « la » fracture. Dont on ne se remet pas.
Jacob K. (le mari de Bessie). On conçoit la vie comme une chose précieuse. Et puis, voilà que l'enfant auquel Bessie donne la vie est enlevé par les Allemands et tué. Mais qui sommes-nous, superhumains, pour pousser cela de côté et dire au monde : « merci de nous avoir libérés » ? Et puis c'est tout, on se lave les mains comme si rien n'était arrivé ? Je ne peux pas faire la paix avec cela. Je ne peux pas (...)Est-ce que je fais partie de la communauté humaine ? Je ne crois pas.
Parler. Parler pour témoigner de vies très chères qui ont été ôtées (beaucoup de rescapés finissent leur intervention en présentant de vieilles photos de famille à la caméra). Parler pour transmettre aux générations futures le point du vue longtemps mal présenté des victimes. Parler en poursuivant tout haut un dialogue intérieur qui n'en finit pas. Parler aussi pour confirmer authentifier un passé inimaginable : « La nuit, quand je m'allonge, je ne peux pas croire ce que mes yeux ont vu », dit Helen K., déportée à Auschwitz et à Maidanek. Parler comme un besoin vital.
« Le mensonge est toxique, et le silence étouffe », affirme le psychiatre Dori Laub qui, enfant, fut lui-même interné dans un camp et travaille depuis, à Boston, sur le traumatisme des déportés. « Chaque survivant a un besoin impérieux de dire son histoire pour parvenir à en réunir les morceaux ; besoin de se délivrer des fantômes du passé, besoin de connaître sa vérité enterrée pour pouvoir retrouver le cours normal de sa vie. C'est une erreur de croire que le silence favorise la paix. Il ne fait que perpétuer la tyrannie des événements passés, favoriser leur déformation et les laisser contaminer la vie quotidienne. »
Mais parler seulement si l'on est écouté. « Le récit non écouté est un traumatisme aussi grave que l'épreuve initiale », estime le docteur Laub, confirmant ainsi un cauchemar récurrent des déportés à l'intérieur des camps. C'est là qu'il faut comprendre le silence dans lequel se sont repliés tant de rescapés après la guerre, faute d'interlocuteurs attentifs, soucieux de leur histoire et prêts à effectuer avec eux le voyage. « Je voulais tellement dire !, se souvient hélène W., revenue orpheline à Paris. Tant de choses à raconter ! Personne ne voulait entendre. « Tu as tant souffert, cela n'est pas la peine d'en parler », me disaient certains, moins pour me protéger que pour se protéger eux-mêmes. Alors je me suis tue. Et quand on me demandait d'où venait ce numéro sur mon bras, je disais que j'avais été dans la marine, n'importe quoi... »
Les intervieweurs des archives de Yale, qui allient des connaissances en histoire et en psychologie, savent les risques de cette plongée en mémoire : l'inévitable confrontation avec les questions existentielles que soulève l'expérience du survivant, l'idée de la mort, du temps qui passe, de la perte des êtres chers, des liens entre parents et enfants, et de l'ultime solitude. Ils savent aussi que leur discrète intervention, plus proche de l'accompagnement amical que du questionnaire, fera d'eux les premiers « témoins » d'un événement qui, par sa nature, excluant toute position autre que celle de bourreau ou de victime, n'en eut réellement aucun. « Une notion apaisante pour le narrateur, déchargé d'un statut ambivalent et asphyxiant. » Ils savent enfin la nécessité d'un investissement personnel et émotionnel dans la rencontre. Témoigner est parfois une si lourde décision.
Le professeur Lawrence Langer, de Boston, est probablement l'un de ceux qui connaissent le mieux les archives vidéo de Yale. D'abord parce qu'il a lui-même réalisé un certain nombre d'entretiens, et puis parce qu'il en a étudié plusieurs centaines, fasciné par cette mémoire « insomniaque » de la Shoah et la force intrinsèque de chacun des récits. Pas de « parcours-type » ou « syndrome du survivant », remarque-t-il, mais une collection d'expériences différentes selon les camps, selon le type de travail (à l'intérieur ou à l'extérieur), les possibilités d'accès à de l'eau ou à un supplément de nourriture, la compréhension de l'Allemand, l'état de santé, la connaissance du sort réservé au reste de la famille... « C'est l'idée même qui sous-tend ce travail sur la mémoire, confirme Joane Rudof : Il ne s'agit plus de l'Histoire abstraite de 6 millions de juifs, mais bien l'histoire d'1+1+1+1... »
Ni cliché ni message simpliste. Une sincérité criante, et même, souligne Larry Langer, une détermination étonnante à « déromantiser » l'expérience du génocide. Pas de « héros » ni de geste « héroïque », lorsque les témoins parlent du camp. Aucune glorification personnelle pour expliquer la survie. Jamais d'envolée lyrique sur la « transcendance », le « salut » voire la « rédemption » par la souffrance qui, selon Langer, encombre si fréquemment les commentaires sur le génocide et éloigne de la réalité du mal. Encore moins de cet hommage « au triomphe de l'esprit » destiné à distiller de l'espoir là où il n'y eut qu'horreur. Les témoins ne théorisent ni ne tirent de leçons. Et malmènent quelques mythes.
Celui, par exemple, d'un mode de conduite particulier, qui aurait facilité ou assuré la survie. Chimère ! dit Lawrence Langer. Les rescapés sont lucides et modestes. Il n'y avait pas de méthode puisqu'il n'y avait pas de logique ; pas de stratégie concevable, puisqu'il n'y avait pas de choix et que les prisonniers ne maîtrisaient aucun paramètre. Sans doute certains insistent-il : « Ma volonté de vivre était si forte ! », ou bien : « Il fallait vivre pour revenir raconter! » La force de caractère ne pouvait certes pas nuire. Mais tous reconnaissent aisément que la volonté ne pouvait rien contre la faim, le typhus ou la sélection.
« Je veux vivre ! », hurlait, devant Nathan A., la jeune femme rousse en s'agenouillant aux pieds du commandant du camp de Budzyn qui, en lui indiquant d'un geste la file de gauche, l'orientait vers la chambre à gaz. Le commandant lui tira une balle dans la tête. Nathan, quatorze ans, fut éclaboussé de cervelle et de sang. Mais son père, qu'on avait dirigé vers la droite, s'approcha alors d'un garde et déclara fermement : « Je me porte volontaire pour aller à la mort avec mon fils ». « Emmenez-le ! », lui dit-on, et Nathan rejoignit son père dans la colonne de droite.
Une leçon ? Une prime au courage ou à la dignité ? Allons donc ! Personne ne pouvait être dupe. Plutôt une prime à l'arbitraire et à la tyrannie tant il est vrai que le résultat inverse était aussi vraisemblable. Anna G. n'a-t-elle pas toute sa vie gardé le souvenir de cette petite fille se débattant entre trois SS qui l'emmenaient à gauche et suppliant sa mère de ne pas l'abandonner, laquelle refusa résolument l'offre de quitter « la bonne file » pour accompagner l'enfant ?
Il est des zones de mémoire plus sensibles, des souvenirs comme des brulûres, des souffrances à la limite du dicible. La vidéo enregistre alors un silence plus dense que le texte d'un grand livre. C'est l'impuissance ressentie à la mort d'un parent que l'on tient dans les bras. C'est le remords affolant de n'avoir pas triomphé de ce qu'ils peinent à appeler le hasard. C'est le cas de ce Hongrois débarqué à Auschwitz, dans un état de totale ignorance, avec des parents orientés dès l'arrivée vers la gauche et ses quatre frères dirigés à droite.
Abraham P. Je me suis penché vers mon petit frère en lui disant : « Solly, va rejoindre papa et maman ». Et comme un petit bonhomme, il y est allé. Si j'avais su que je l'envoyais droit au crématoire ! Je... J'ai ce sentiment de l'avoir tué. Je me suis demandé s'il avait pu rejoindre mes parents, je pense que oui. Il a dû leur dire : « Abraham m'a dit d'aller avec vous ! » Je me demande ce que mon père et ma mère ont pensé, surtout quand ils sont rentrés ensemble dans le crématoire... Je ne peux pas me retirer cela de la tête. Cela me fait si mal, et je ne sais pas que faire.
Impasse. Besoin de colère et de révolte. Mais contre qui ? Quel fautif ? Quel ennemi ? « Enorme, monstrueux, l'antagoniste n'est même pas identifiable », souligne Lawrence Langer. De là, peut-être, l'explication de la fréquence avec laquelle les témoins affirment avoir vu en personne le sinistre Docteur Mengele (connu pour pratiquer des expériences sur les déportés) diriger la sélection. « Au moins, ils ont un nom, un ennemi qui incarne le mal, un responsable vers qui orienter leur haine. »
Difficile, inavouable aussi, cette honte de soi pour le souvenir d'actes pitoyables, ordinaires dans la vie du camp, et condamnables par la morale « hors camp ».
Hannah F. Une nuit, j'avais si faim que je ne pouvais pas dormir. Ma voisine, avec laquelle j'étais devenue très amie on était cinq sur notre couchette sauvegardait pour le petit-déjeuner une minuscule tranche de pain et un bout de margarine. Eh bien cette nuit-là, j'ai volé son morceau de pain, et je ne l'ai jamais avoué. Elle s'est levée le matin et a juré comme un camionneur. J'en étais malade, très malheureuse, très désolée, parce que j'avais faim et qu'elle avait faim...
Parfois il y a l'atroce, sorti d'on ne sait quel recoin de la mémoire, peut-être faute de langage adéquat pour donner à certains mots « faim », « froid », « sauvage » un surplus de sens correspondant à la réalité du camp. L'exemple que cite le professeur Langer va sans doute au-delà.
Moses S. Un jour, les Anglais ont bombardé le camp de Mauthausen. Et j'ai dit : « Yankel, lève-toi, il ne fait pas bon rester là, ou tu deviendras moins que rien ». On s'est donc levés et on a trouvé une main provenant du bombardement...
L'intervieweur : Une grenade à main ?
Moses S : Non, une main, une main humaine.
L'intervieweur : Oh, une main humaine !
Moses S. : On était cinq, on l'a divisée et mangée...
Comment, sans raconter l'histoire, aurait-il décrit la cruauté, la folie, la déchéance, la déshumanisation ? Les mots leur semblent fades, inutiles, pour évoquer les images qui leur reviennent. Ils trébuchent sur ces mots devenus traîtres, ils soupirent, ils marquent une pause, ils se reprennent. Leur récit est plein d'accrocs. « Vous comprenez ce que je veux vous dire ? », s'enquiert plusieurs fois hélène W., sceptique sur les capacités de son auditoire à la suivre dans son voyage infernal. Peine perdue, semble penser la plupart. « Si quelqu'un me racontait cette histoire, je dirais : Elle ment. Parce que cela ne peut pas être vrai. Et c'est ce que vous allez peut-être vous dire. Parce que pour nous comprendre, il faut être passé par là. »
La solitude donc. Une solitude qui accable et fait parfois regretter « culpabiliser » de n'être pas morts là-bas, « logiquement », avec le reste des siens.
Martin R., parlant de sa nouvelle vie. Le jour, je travaillais dur, j'étudiais, j'essayais d'aller de l'avant, et la nuit, je combattais les Allemands. Les SS me poursuivaient sans cesse et moi, j'essayais de sauver ma mère et ma soeur (toutes deux gazées à Auschwitz). Et je sautais d'un bâtiment à l'autre et ils me tiraient dessus, et chaque fois, la balle traversait mon coeur.
Mourir en rêve... Mais continuer de vivre. Et même donner la vie. Obsédé par l'Absence. « Ce sentiment qu'il n'y a personne que l'on puisse appeler pour partager sa joie ou sa tristesse, le jour où l'on a un bébé. » « Moi », dit Edith P. « je n'avais personne ».
« Là-bas », ici. « En ce temps là », aujourd'hui... Le témoignage télescope les époques et les sentiments, offrant sur le génocide le plus humain des documents. Il servira il sert déjà à des chercheurs, des historiens, des enseignants. Et il donnera à une poignée d'enfants les fragments enfin recollés d'une histoire familiale que leurs parents, jamais, n'avaient pu raconter.
Annick Cojean - Le Monde du 25/04/95
 |
 |
 |
____________________________
Server / Server
© Michel Fingerhut 1996-2001 - document mis à jour le 24/09/2000 à 15h28m26s.
Pour écrire au serveur (PAS à l'auteur)/To write to the server (NOT to the author): MESSAGE