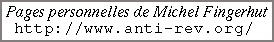

Oswiecim, Pologne, septembre 1997. Il fait beau. Il fait chaud. Au Sud, on aperçoit les Beskides, avant-dernier ressaut occidental des Carpates avant les Sudètes tchèques. Les cars se rangent sur le parking, en bordure de potagers d'où émergent des choux, trop vite montés en graine. Une voie de chemin de fer sort de hautes herbes folles comme un serpent indolent. Elle traverse l'esplanade et s'engouffre sous un porche ouvert surmonté d'une tour carrée dont le dernier étage est vitré sur les quatre côtés: la 'porte de la mort'!
Nous sommes à Brzezinka - la boulaie.
Oswiecim, Brzezinka. En polonais, ces noms sont inoffensifs. En allemand, ils sont effroyables: Auschwitz, Birkenau. Nous sommes à Birkenau. Et, il fait beau.
Auschwitz - le camp-mère - était une ancienne caserne autrichienne: des bâtiments de brique rouge de deux étages, alignés le long de sages allées. C'est aujourd'hui un musée. A l'entrée, les visiteurs disposent d'un grand parking, de kiosques où l'on peut acheter des boissons fraîches, des glaces, des livres. En ce chaud mois de septembre, des camping-cars, immatriculés en Allemagne, s'installent pour la nuit. Il est 5 heures; on ne visite plus. Les portes du bunker se sont refermées sur la chambre à gaz et les fours crématoires devant lesquels vacillent les petites flammes des bougies du souvenir.
En août 1942, le camp principal ne suffit plus. Surtout, il n'est pas adapté à l'extermination en masse des juifs décidée la même année, en janvier, lors de la conférence de Wansee. Les SS ouvrent le camp de Birkenau, construit sur des marais asséchés, à 3 km de l'ancienne caserne. C'est un vaste périmètre de plus d'un kilomètre de façade sur 800 mètres de profondeur, entouré de hauts murs de barbelés, ponctués de miradors.
Les lieux sont à peu près dans l'état où ils se trouvaient en janvier 1944 à l'arrivée de l'armée soviétique. Là où les baraquements ont été détruits, se dressent des cheminées, alignées comme les pierres de Carnac...
Nous entrons. Nous suivons les rails, puis les traversons. Nous nous trouvons sur une bande de terre entre deux voies: la rampe. De part et d'autre, isolées par des grilles, les longues baraques; derrière nous, la porte de la mort; devant nous le monument dressé après guerre, entre les deux bâtiments en ruine des chambres à gaz et des crématoires II et III. Les trains s'arrêtaient ici. Les trains et la vie... La vie d'Emile Fersztendyk, quatre ans, né à Paris, arrêté à Bordeaux à l'été 1942, envoyé à Drancy le 26 août sur réquisition de Maurice Papon, déporté le 31, disparu trois jours plus tard, là-bas, devant nous, droit dans le ciel, veillé par l'horizon bleu des Beskides.
Un long voyage. Du camp d'internement de Mérignac, dans la banlieue de Bordeaux, il ne reste rien, qu'une stèle. A Drancy, la cité de la Muette a retrouvé sa vocation première: loger les plus défavorisés, tandis qu'un wagon de marchandise est là comme un collage surréaliste... 'Combien de tours de roue, d'arrêts et de départs', chante Jean Ferrat. Bordeaux-Saint-Jean - Austerlitz: 20 heures. En camion ou en bus jusqu'à Drancy. De là, encore un minimum de trois jours. Et déjà la faim, la peur, la puanteur et la mort. Enfin, les portes s'ouvraient. Là, sur la rampe couleur de plage. Mais sur quoi, mon Dieu!
Qu'as-tu vu à Auschwitz, dit-elle. Je ne vois rien. Ou bien c'est très loin. Des photos jaunies de mon enfance. Des visages. Une petite fille. Elle s'appelait Charlotte... Je ne vois rien. J'entends. Les portes qui s'ouvrent; les chiens; les pleurs; la détresse des couples qu'on sépare; les ordres. J'entends la rumeur, le piétinement sur la rampe, sur le chemin, les coups sur le dos des vieilles trottinant vers la chambre à gaz.
J'entends descendre cette foule dans l'escalier, poussée par les kapos; le froissement des habits qu'on ôte; le frôlement des corps nus dans l'étroit couloir; l'énorme porte qui grince sur ses gonds. Soudain comme un murmure, comme le bruit d'un ruisseau dans la montagne et des cris. Des cris venus des entrailles de la terre. J'entends la dernière prière du dernier rabbin du dernier shtetel de l'histoire: shema Israël...
Tu n'as rien vu à Auschwitz. Elle dit: j'ai vu les baraques, alignées, rectilignes. C'était beaucoup plus grand que je ne pensais. J'ai vu la porte, symétrique. L'inscription 'Arbeit macht frei' de mes bouquins d'histoire n'y figure pas. Symétriques, aussi, les deux chambres à gaz, aujourd'hui explosées, dont il ne reste que les ruines. Les architectes qui ont conçu cela, les kapos qui supervisaient les travaux, les industriels qui ont fourni les matériaux, tout cela, je n'arrive pas à le voir. Je cherchais, involontairement, entre les traverses de la voie ferrée, les traces de ces vies disparues. Un message oublié. Une boucle d'oreille.
Un petit groupe d'hommes et de femmes, parlant hébreu, l'oeil braqué sur un plan, cherchait le numéro d'une baraque où l'un des leurs avait dû séjourner. Il faut y entrer. En humer l'odeur propre. Compter les châlits, innombrables, qui en forment comme l'ossature. Errer dans ces allées, étroites, dont on apprécie aujourd'hui la fraîcheur. Tenter de décrypter, parmi les graffitis obscènes des touristes de passage, les messages qu'un détenu aurait pu, un jour peut-être, y laisser.
Les chambres à gaz? Un amoncellement, béton et ferraille, devant lequel deux jeunes Américaines pleuraient. Je m'en souviens à peine. J'avais l'oeil sec. Je posais des questions techniques, parce qu'il faut bien parler. Je voyais ce monde désincarné.
Nous remontons la rampe. Nous faisons le chemin qu'ils ont fait. Mais nous le faisons vingt fois quand ils ne l'ont fait qu'une. Non, tu n'as rien vu à Auschwitz.
Derrière les ruines des crématoires II et III se trouvent des fosses rectangulaires. L'eau d'anciennes pluies y stagne. Les plantes des anciens marais y renaissent. Mais l'eau est sombre et la vase noire. On y déversait les cendres. Tout autour poussent des grands trèfles. Un tracteur y fauche la pitance des vaches que les Polonais, alentour, promènent, en laisse, comme des chiens. Nous marchons en silence dans le silence. Une brise chaude éveille les peupliers, dressés comme des cierges de pâques. On voudrait ne voir ces lieux que sous un ciel bas et noir. On voudrait avoir froid. Comment imaginer la mort dans ce tapis de trèfle, sous ce soleil d'automne, si rond, si beau? Nous marchons et d'autres marchent. Devant nous, derrière nous. Ils photographient. Ils écoutent les explication d'un guide. On se croise. Sans se voir. On n'ose pas. Ce lieu ouvert est le plus clos du monde.
A qui parles-tu, dit-elle. A qui parler? Vois! Mais tu dis qu'ici, on ne voit rien? Ferme les yeux! Des millions de fantômes rayés. Des millions de mains tendues. Des millions de regards. Pourquoi? Mais pourquoi quoi? Leur mort? Ma vie? Ta vie? Comme si c'était le Destin; comme si c'était écrit. Mais nous savons, nous, qu'au bout de cette voie ferrée, tout au bout, quelqu'un quelque part signait un ordre. Quelqu'un pour qui un homme était un juif et un enfant juif un problème administratif. Quelqu'un qui, le soir, dînait en compagnie, quand les flics qu'il avait requis arrachaient à la nuit des enfants bouclés. Vois! Ce sont leurs cheveux; leurs chaussures; leurs jouets... Appelle-les, ils sont là!
La fin de l'après midi est proche. Nous avons quitté Birkenau et, au camp-mère, notre visite du musée s'achève. En silence dans le silence.
Dis, qu'as-tu vu à Auschwitz. Elle dit: j'ai vu les photos d'identité qui tapissent les murs. De face, de profil, de biais. Les hommes sont rasés, portent parfois la trace de coups. Les femmes ont un fichu sur la tête. Certaines sourient à l'objectif, comme ces deux jumelles, dont les visages sont côte à côte. J'ai vu les cages de verre. Celle des valises, déjà poussiéreuses, sur lesquelles les noms sont si soigneusement inscrits à la craie. Celle des prothèses, arrachées aux invalides. Ces tombereaux de cheveux, d'où émergent quelques nattes, blondes, brunes, encore tressées. Devant ces galeries silencieuses, obscènes, j'ai eu honte de mon écoeurement. J'ai hâté le pas. J'ai voulu sortir. Fumer une cigarette... Et je t'ai vu pleurer.
Tu n'as rien vu à Auschwitz. Mais ta colère me ramène à la vie. J'étais loin.
Elie Wiesel rappelle l'adresse du poète juif Aharon Zeitlin à ceux qui l'ont quitté: 'Vous m'avez abandonné, leur dit-il. Vous êtes ensemble; sans moi. Moi, je suis ici. Seul. Et je fais des mots.'
BERNARD FREDERICK et ELISABETH FLEURY
____________________________
Server / Server
© Michel Fingerhut 1996-2001 - document mis à jour le 05/12/2000 à 15h29m33s.
Pour écrire au serveur (PAS à l'auteur)/To write to the server (NOT to the author): MESSAGE