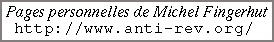

À la fin de 1998, la maison d'édition Robert Laffont a publié Conversations et entretiens avec Primo Levi, et réédité le roman Maintenant ou jamais, publié en 1982 chez Einaudi à Turin (la traduction française parut un an plus tard). L'écrivain italien, dont le célèbre Si c'est un homme était passé pratiquement inaperçu en 1947 pour devenir, dès la fin des années 1950, un des livres les plus lus de l'après-guerre, s'est donné la mort en avril 1987 ; depuis, des rééditions, mais aucun manuscrit nouveau.
L'édition en un volume de ces entrevues (Conservations et entretiens), qui sont en fait un choix de très nombreuses publications antérieures, vient à un moment du débat des idées en Occident que l'on pourrait qualifier de stratégique. Qui plus est, ce nouveau livre nous rappelle à tout moment l'engagement profond de l'auteur dans sa lutte contre le fascisme italien et le national-socialisme allemand ; il est la somme d'une pensée et d'une mémoire exceptionnellement lucides que rien ne corrompt : ni le passage du temps ni le quotidien, et encore moins les honneurs. Il martèle inlassablement la même phrase : « Plus jamais. »
Levi était chimiste. Cette profession lui avait sauvé la vie durant sa captivité au camp hybride de concentration/d'extermination de Buna-Monowitz, rattaché au complexe d'Auschwitz, en Haute-Silésie. Toute l'œuvre de cet homme, qui avait rédigé le récit de l'horreur vécue au camp, est centrée sur ces mois, de janvier 1944 à la libération. « Horreur » : le mot est trop faible, trop usé, il faudrait en inventer un autre pour désigner ce qui s'est passé dans les camps nazis. Elie Wiesel, qui avait été au même camp que Levi, a fait circuler (ce qu'il a regretté plus tard) le terme « holocauste », qui signifie littéralement que les animaux sacrifiés aux dieux devaient être « brûlés tout entiers ». Mais les juifs n'étaient pas sacrifiés, ni aux dieux des nazis ni à une quelconque autorité spirituelle ; ils étaient exterminés comme on extermine la vermine, dans une haine froide, incompréhensible, méthodiquement. Quand Si c'est un homme devint une lecture obligée dans les écoles italiennes et quand son auteur fit de longues tournées pour répondre aux questions des adolescents, il rédigea un appendice au livre où il prend position sur les questions les plus fréquentes : « Avez-vous pardonné aux Allemands ? », « Pourquoi n'y a-t-il pas eu des rébellions dans les camps ? » et, la plus terrible : « Comment s'explique la haine fanatique des nazis pour les juifs ? » Ses réponses, Levi les reprend pendant trente ans, et il emploie toute sa vie à raconter ce qui s'est passé. Au début des années 1970, il constate qu'il a épuisé le sujet, qu'il n'a plus rien à ajouter. Pourtant, il continue à écrire et à rappeler, avec une fermeté admirable, les faits du génocide nazi.
Pour lui, il faut raconter la réalité des camps, ou alors se taire, et abandonner le projet de nommer ce qui se soustrait à une formulation cohérente. Adorno avait dit qu'après Auschwitz, « on ne peut plus écrire de poésie ». Levi n'est pas de cet avis : « Mon expérience prouve le contraire. [...] Quand je parle de ‘ poésie ’, je ne pense à rien de lyrique. À cette époque, j'aurais reformulé ainsi la phrase d'Adorno : après Auschwitz, on ne peut plus écrire de poésie que sur Auschwitz. » (Conversations et entretiens, p. 138 ; nous abrégeons en CE par la suite.) Pourtant, Levi parle, et abondamment, de ces mois au Lager nazi, à Auschwitz. Il lui faut cerner le thème de la dignité de l'homme.
Car ces condamnés à mort meurent sans gloire, ils n'ont pas droit au moindre geste qui pourrait les honorer, sont envoyés aux chambres à gaz dans le dépouillement total et la négation de la dignité de l'homme. En entrant au camp, ils remarquent une phrase en allemand : « Arbeit macht frei » (le travail rend libre) — mais libre de quoi ? Le passé du prisonnier est anéanti, sa mémoire, oblitérée. Ici, à Auschwitz, les condamnés juifs — il y en a d'autres, des criminels de droit commun, des Allemands pour la plupart, qui se situent très haut sur l'échelle des internés, tandis que les juifs occupent invariablement la place la plus basse — ne savent pas quel est leur crime. Désormais, ils sont dans le monde de Kafka, où rien n'est compréhensible : le camp est une tour de Babel horrifiante, avec des ordres hurlés que les prisonniers ne comprennent pas. Tout leur est hostile : les gardes, les kapos (les responsables de chaque bloc), le travail épuisant sous la neige, dans la boue, le froid des baraques. Leur baptême est un tatouage ; désormais, Levi est sans nom, il porte le numéro 174 517. Sous l'enseigne « Arbeit macht frei », il tente d'enseigner les rudiments de l'italien à un prisonnier, en se remémorant la Divina commedia de Dante. Pour ne pas effrayer son camarade, il évite soigneusement de citer les vers (il ne les citera jamais) parmi les plus terribles, ceux qui sont gravés au-dessus de la porte de l'Inferno : « Per me si va nell'eterno dolore, / Per me si va tra la perduta gente [...] / Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate. » (« Par moi on entre dans l'éternelle douleur, / Par moi on va parmi les êtres perdus [...] / Laissez tout espoir vous qui entrez. » Enfer, 3e chant, vers 2, 3 et 9.)
Dans cet enfer, l'homme est transformé en vermine : d'abord, il est dépouillé de sa dignité par une cruauté calculée, froide, efficace : le prisonnier doit laper sa soupe comme un chien, le kapo essuie sa main sale sur la blouse de Levi, chiffon accroché à un squelette ambulant ; au laboratoire, une jeune Allemande se bouche le nez puisque le jeune chimiste répand son odeur de vermine ; pour elle, il est le Stinkjude, le juif puant. Quand la SS (Schutzstaffel, escadron de protection ou de défense ; les Allemands étaient maîtres de l'euphémisme, pensons à l'utilisation du terme Endlösung, la « solution finale », pour désigner l'extermination) pend un prisonnier ayant saboté un four crématoire au camp de Birkenau, les prisonniers doivent assister à cette mise à mort ignoble, sans aucun espoir de rébellion.
La destruction physique du prisonnier dépouillé de sa dignité et de son identité amène chez les survivants, très rares, un immense sentiment de culpabilité : pourquoi ne suis-je pas mort, alors que tous mes amis ont péri ? Beaucoup se suicident dès l'arrivée de l'armée russe, incapables désormais de soutenir le poids de leur vie au milieu de ces millions de morts. On a souvent demandé à Levi s'il n'y avait pas dans le fait qu'il ait survécu un signe de la main de Dieu, qui l'aurait choisi afin qu'il rende compte de ce que l'homme est capable de faire à l'homme. Si l'auteur garde habituellement son calme devant les questions les plus insistantes, ici il devient impatient : il est un juif sécularisé, il n'est pas croyant, il est chimiste. Levi ne croit qu'au hasard et non en Dieu : quel est ce Dieu qui abandonne les siens aux pires traitements que peut inventer l'homme pour faire périr son semblable ? (Après la guerre, des intellectuels juifs ont effectivement fait ce procès à Dieu, et L'ont condamné.) Quand Levi doit partager, pendant les derniers jours de son existence au Lager, son bat-flanc souillé avec un camarade qui vient de mourir, il fait ressortir, en des termes détachés, son malheur : « Celui qui tue est un homme, celui qui commet ou subit une injustice est un homme. Mais celui qui se laisse aller au point de partager son lit avec un cadavre, celui-là n'est pas un homme. » (Si c'est un homme, p. 185.)
Quand Levi tente d'expliquer la haine des Allemands envers les juifs, il évoque « l'aversion pour ce qui est différent de nous » (Si c'est un homme, p. 205), l'accusation de déicide que les chrétiens n'abandonnent que sous Jean XXIII (« les juifs ont mis à mort le fils de Dieu »), la théorie des races inférieures, et l'expression de cette haine jusque dans la mort, puisque le gaz utilisé était le même que celui employé pour « la désinfection des cales de bateaux et des locaux envahis par les punaises ou les poux » (Ib., p. 209). Il aurait pu remonter dans l'histoire : au XVIIIe siècle, dans la foulée de l'Aufklärung, certains États allemands, et tout particulièrement la Prusse, avaient aboli les lois empêchant l'intégration des juifs ou leur épanouissement culturel. Mais dans ces mêmes États, après la domination napoléonienne, naît un farouche nationalisme, qui provoque, dès le romantisme et à la suite de philosophes comme Fichte ou Hegel, un durcissement à l'égard de ceux qui se distinguent du peuple chrétien. Quand Richard Wagner publie en 1851 (sous pseudonyme) son essai Das Judentum in der Musik (« La judaïté en musique »), il exprime ce que bon nombre de ses contemporains pensent des juifs : ils s'infiltrent partout ; ils accaparent les meilleures places dans la société ; par leur culture différente, ils minent les fondements de l'État. (La haine de Wagner se fonde essentiellement sur l'envie causée par le succès de son collègue Meyerbeer...) C'est la discorde entre Hellènes et Nazaréens, sensualisme et spiritualisme, Athènes et Jérusalem, comme l'a si bien démontré Albrecht Betz dans son livre sur le poète Heine, juif allemand (Der Charme des Ruhestörers, [« Le charme du fauteur de troubles »], 1998 ; Heine avait bien prédit que « ceux qui brûlent les livres finissent tôt ou tard par brûler des hommes »). Et le philosophe allemand Nietzsche, de concert avec le Français Gobineau, va paver le chemin à l'Autrichien Hitler, qui reprend les clichés hérités du XIXe siècle ayant encore cours chez le peuple allemand et qui instaure un régime ne permettant aucun écart de la ligne de conduite officielle, qu'il prend en charge, personnellement : « L'agression vient d'en haut, dira Levi, pas d'en bas. [...] Le grand malheur, je crois qu'on peut le dire, c'est le respect excessif à l'égard de l'autorité, ce n'est pas l'exercice de l'autorité. » (CE, p. 58.)
Par la description du sort de rescapés (La trêve, 1963 ; Les naufragés et les rescapés, 1986) ou encore des partisans de l'Europe de l'Est, Levi montre la combativité, le courage, la débrouillardise de ces juifs qui n'hésitent pas à prendre les armes et à combattre les Allemands là où ils le peuvent. Dans Maintenant ou jamais, l'auteur fait revivre, sous forme de roman — il dit que c'est son premier roman —, un groupe de partisans, des juifs russes et polonais pour la plupart, qui se battent sur tous les fronts (le titre du livre, une citation du rabbin Hillel, est emprunté aux Pirké Avoth, les « Maximes des Pères », datant du IIe siècle). Partis de la Biélorussie, ils traversent toute l'Europe à la recherche de la terre promise, perdue depuis deux millénaires, et d'un havre de paix : la Palestine. Ils traversent des épreuves terrifiantes, risquent la mort à tout moment, sont prisonniers de la glace, de la boue des steppes, rencontrent partout les traces de la haine des nazis contre les juifs. Quand ils arrivent à Milan, à la fin de la guerre, ils sont pris en charge par une organisation juive italienne : c'est maintenant ou jamais qu'il faut aller en Palestine.
L'auteur le sait bien, il le dit lui-même à maintes reprises dans ses entrevues : il n'est pas romancier, il est chimiste. Il observe, soupèse, mélange les ingrédients, mais il n'invente pas. Ainsi, il s'est basé, pour ce texte comme pour d'autres (Le système périodique, 1975 ; La clé à molette, 1978), sur les récits d'autres rescapés — ce qui n'en fait pas nécessairement de la littérature, même si les éléments de leur vie ont été ordonnés, filtrés, mis en perspective, rendus plus vivants et mouvants par le dialogue. Ces textes, qui se veulent une suite d'images colorées, restent statiques dans l'ensemble, sans intention narrative particulière. Il s'agit de documents. Levi y utilise une langue à peine différente que celle de Si c'est un homme, garde son ton froid, distant, neutre, qui observe sans émotivité. Manifestement, il n'est pas un écrivain, même s'il raconte admirablement : son esprit scientifique suit la linéarité, ne trahit ni la chronologie, ni les lieux. Quand il veut faire vivre ses personnages — les plus forts sont Mendel, Gédal, Line —, ceux-ci restent étrangement unidimensionnels, ne vivent guère dans leur chair. Les nombreux dialogues sont autant d'illustrations de la pensée de ces partisans ; ils tournent inlassablement autour du thème du combat, tout au long des pérégrinations du groupe, pendant les deux dernières années de la guerre (la « Note » à la fin du livre est révélatrice à cet égard).
Ces récits d'événements vécus ou rapportés portent en eux la grave question de la vengeance et du pardon. Dans une entrevue avec Giorgio Calcagno, quelques mois avant sa mort, Levi dit : « [J]e suis chimiste, je veux comprendre le monde qui m'entoure. [...] Le verbe ‘ pardonner ’ ne fait pas partie de mon vocabulaire. [...] On me demande si j'ai pardonné. Je crois être, à ma façon, un homme juste. Je peux pardonner à tel homme et pas à tel autre. [...] Celui qui a commis un crime doit le payer, à moins qu'il ne se repente. Mais pas en paroles. Je ne me contente pas du repentir verbal. » (CE, p. 145 ; nous soulignons.) En d'autres termes : Levi attend l'acte du repentir. Comme il le mentionne à plusieurs reprises, il a pu constater cet acte à l'échelle de la population (ouest) allemande — la question des crimes nazis a été largement escamotée en République démocratique allemande, jusqu'à sa chute il y a dix ans — et plus particulièrement parmi la génération de l'après-guerre qui, aujourd'hui, ne se distingue guère de celle d'autres pays européens. Les négationnistes de l'Holocauste, comme Darquier de Pellepoix ou Faurisson, qui soutiennent encore et toujours que les chambres à gaz d'Auschwitz n'ont servi que pour la désinfection des poux ou qu'elles n'ont jamais existé, sont pour Levi « une délégation d'idiots ». En 1978, à Varèse, au cours d'un match de basket entre l'équipe locale et un club israélien, les partisans italiens avaient chanté un hymne à la gloire des camps d'extermination. Pour Levi, « les garçons de Varèse, à ce qu'il me semble, étaient assez inconscients de ce qu'ils faisaient ». (CE, p. 273.)
Mais ces « idiots » n'existent que parce qu'ils ignorent ces événements tragiques (ici, le terme acquiert sa pleine valeur), ou qu'ils ne veulent pas les connaître. Une bande de jeunes idiots qui renversent les pierres tombales d'un cimetière juif sont aussi coupables d'ignorance que certains jeunes néonazis qui lèvent le bras dans le salut fasciste et ne savent même pas dans quel siècle est né Hitler... C'est pour cela qu'il faut (re)lire les livres de Primo Levi : avec eux, nous combattons l'ignorance, maintenons la vigilance à l'égard de l'obscurantisme et du nationalisme. Parce que l'Holocauste a eu lieu, il peut donc se reproduire. Milvia Spadi résume les propos tenus par Levi au cours d'une des plus émouvantes entrevues qu'il ait accordées : « ‘ C'est notre faute si nous n'en savons pas plus — dit Levi, en faisant allusion au génocide du Cambodge —, nous aurions dû nous informer, lire le peu qui a été écrit. ’ Aujourd'hui, on est convaincu que tout le monde ‘ sait ’ ce qui se passe dans le monde. On aimerait rayer le mot ‘ génocide ’ de notre vocabulaire, ne pas avoir à l'appliquer aux événements actuels. [...] Évidemment, si, aujourd'hui, nous ‘ savons ’ tous, nous ne pouvons pas nous dérober. Nous devons essayer de comprendre de quoi est faite cette force, et l'arrêter. Pour que la douleur et la mémoire ne soient pas inutiles. » (CE, p. 237 et suivantes ; nous soulignons.)
____________________________
Server / Server
© Michel Fingerhut 1996-2001 - document mis à jour le 05/12/2000 à 15h29m36s.
Pour écrire au serveur (PAS à l'auteur)/To write to the server (NOT to the author): MESSAGE