


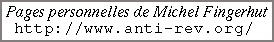

C'est un débat douloureux et sensible qui traverse l'Allemagne du chancelier Schröder: faut-il du passé faire table rase, tourner une fois pour toutes la page de la Shoah, au risque de l'oublier? L'écrivain Bernard-Henri Lévy a mené une enquête intellectuelle auprès des nouveaux dirigeants allemands, de l'ancien chancelier Helmut Schmidt, du chef de la communauté juive Ignatz Bubis.
Je n'avais plus revu Gerhard Schröder depuis ce jour d'août 1998 où nous étions venus, avec quelques autres, pendant la campagne électorale, lui apporter notre soutien. Je l'avais trouvé sombre. Peu loquace. J'avais noté son habitude, chaque fois qu'il le pouvait, de laisser Oskar Lafontaine, le patron du Parti, prendre la parole à sa place et, sinon, sa diction lente, un peu mécanique. Ce qui frappe, là, c'est la joie. L'euphorie discrète mais insistante. C'est l'air d'un homme qui a le sentiment d'avoir gagné la double bataille, mêlée, de la politique (fierté du « militant SPD » rendant enfin le pouvoir au « parti de Bebel et Bernstein ») et de la vie (cette « nouvelle épouse » dont toute l'Allemagne se répète qu'il a « tenu le coup » grâce à elle, qu'elle est le « secret de sa réussite », etc.). Il a le regard clair. Une belle voix de crooner. Il a la cravate avantageuse: rouge, jaune, noir, les couleurs du drapeau allemand - il se débrouille toujours, paraît-il, pour avoir, dans ses cravates, les trois couleurs du drapeau. Gerhard Schröder est un homme heureux.
Son bureau, à la chancellerie, est d'une sobriété déconcertante. Pas un objet. Pas un livre. Une table de travail, à un bout. Une table de réunion, à l'autre. Un côté allemand de l'Est dans la décoration ou dans le plateau de cigarettes, à la disposition des invités. Dans mon dos, seule note de fantaisie, un grand tableau néoexpressioniste, teintes laiteuses et bleuâtres, qui montre un groupe en train de danser, devant la porte de Brandebourg, le jour de la chute du Mur. Etat modeste. Austérité de principe, presque ostentatoire, de la République de Bonn. Mortification volontaire d'un Etat qui, en se repliant sur cette humble bourgade de province, aurait voulu se faire ermite. Ce seront d'ailleurs ses premiers mots, empruntés à Frédéric Il, mais qu'il attribue bizarrement à Helmut Schmidt: « je suis, de mon Etat (modeste!), le premier serviteur. »
Que pense le Serviteur des déclarations de Martin Walser, ce romancier considérable, figure de la gauche intellectuelle, dont les propos sur la « représentation permanente de la honte », la « routine de la culpabilisation » et « l'instrumentalisation d'Auschwitz dans le débat public » viennent de déclencher une énorme polémique? Il défend Walser dont la position a été, selon lui, « mal comprise ».
La question du « Mémorial »? Est-il toujours hostile au projet d'un Mémorial de la Shoah, ce fameux « Mahnmal », voulu, par Kohl, au centre de Berlin? « Ce n'est pas à moi de décider. C'est au peuple. Il y aura un débat parlementaire, au printemps, et chacun, y compris les ministres, pourra prendre la parole et voter selon sa conscience, sans discipline de parti. »
N'a-t-il pas un avis personnel, tout de même? N'a-t-il pas déclaré qu'il voulait un monument où l'on entrerait « avec plaisir »? Il esquive encore. « J'ai juste voulu dire: un lieu où l'on rencontrerait l'Histoire et une Histoire qui, au lieu de nous étouffer, nous aiderait à affronter l'avenir. »
Bref, un Schröder prudent. Circonspect. Une impression, très étrange, d'indifférence à ces questions. Et puis, à la toute fin, sur deux points précis, une brutalité qui me surprend.
Le « cas Goldhagen », d'abord, ce jeune historien américain dont j'ai, avec moi, le best-seller sur les Bourreaux volontaires de Hitler. Il prétend être le dernier Allemand à n'avoir pas lu le livre. Mais il ne peut s'empêcher d'ajouter, lueur froide dans le regard, voix cassante: « je ne l'ai pas lu, non ; mais je ne crois pas qu'il ait raison d'affirmer que l'ensemble de l'Allemagne a, non seulement su, mais voulu la Shoah. »
Ensuite, le cas Jan-Philip Reemtsma ce chercheur de Hambourg dont la grande exposition de photos sur « les crimes de la Wehrmacht » a déplacé, parait-il, des centaines de milliers de visiteurs dans le pays: « je ne l'ai pas vue non plus; mais je ne peux pas laisser dire qu'une armée, dans sa majorité, a pu commettre des crimes pareils ».
Et comme j'insiste que l'exposition, après, avoir tourné dans toute l'Allemagne, se termine ce week-end à Hanovre et que, Hanovre étant sa ville, je serais honoré de pouvoir la voir en sa compagnie, il retrouve son air d'obligeance enjouée: il sera à Hanovre, en effet, ce week-end, mais il est déjà pris… une petite fête… il insiste sur le mot français: « eine kleine fête »... il répète: une « fête de vieux amis », ceux qui l'ont soutenu, ses camarades, le SPD... mais pourquoi, puisque je serai dans la ville, ce soir-là, ne pas me joindre à eux et venir, moi aussi, faire la fête ? La fête, pas la mémoire... Une fête, au lieu de la mémoire et de l'Histoire... Est-ce la doctrine du chancelier? Est-ce là ce qu'il entend lorsqu'il parle d'instaurer un rapport « détendu » avec le passé ?
Georg-Clemens Dick est un de ces « diplomates verts » que Joschka Fischer a amenés dans ses bagages quand il a pris les rênes du ministère des affaires étrangères. Il me reçoit, en fin de journée, à son bureau, dans l'énorme bâtiment sans âme qu'il occupe, pour quelques mois encore, jusqu'au déménagement à Berlin. Longs couloirs silencieux. Lumière pauvre. Alignement de pièces austères où l'on aperçoit, à travers les portes entrebâillées, des meubles ordinaires, des rideaux de mauvaise rayonne, des posters. Ambiance de cité U ou d'hôpital désaffecté. Parfum tiers-mondiste. Et Dick, cheveux gris et courts, allure sportive, pieds sur le bureau au moment où je pousse sa porte: le contraire du haut fonctionnaire traditionnel - on l'imaginerait plutôt sur un terrain de foot, ou en montagne, ou bien en train de faire un trekking. « Cette affaire Walser est évidemment énorme, m'explique-t-il. Mais l'Allemagne, ce n'est pas que cela. Prenez la réforme du droit de la citoyenneté par exemple. Savez-vous ce qu'elle va concrètement signifier? Deux millions de nouveaux Allemands... » Il sourit, me propose une friandise: « deux millions de nouveaux Allemands qui seront, du même coup, deux millions de nouveaux Européens! qui dit mieux? » Cette fois, le diplomate en santiags éclate de rire, enchanté du bon tour joué à l'Europe des philistins: « pour nous, Allemands, donc Européens, c'est une révolution aussi énorme, dans son genre, que la chute du mur de Berlin ».
Lettre, faxée à l'hôtel, par l'adjoint de Georg-Clemens Dick, Helmut Elfenkemper. A la fin de la conversation, Dick s'est laissé à raconter comment la maison de ses parents, à Aix-la-Chapelle, jouxtait une synagogue détruite par les nazis, puis reconstruite, mais lentement - en sorte qu'il a grandi « au rythme de la synagogue ». Du coup, et par association d'idées, je lui ai fait observer que les choses n'ont pas beaucoup changé pour lui puisque l'entrée de son ministère, ici, à Bonn, se trouve être à nouveau en face d'une synagogue - hasard ou fait exprès? la synagogue reconstruite en face du ministère, ou le ministère installé là parce qu'il y avait déjà la synagogue?
Eh bien, lettre pour dire deux choses. Primo: enquête faite, le bâtiment date de 1955, la synagogue de 1959 et c'est à dessein qu'elles ont été placées face à face - la politique extérieure de la nouvelle Allemagne s'inscrivant sous le signe, explicite, de la repentance à l'endroit des juifs. Secundo, et plus énorme encore: la rue s'appelle « Tempelstrasse », rue du « Temple », ce qui, en allemand, ne signifie pas « temple protestant », mais « synagogue ». Or cela aussi est récent; l'endroit s'appelait Wörthstrasse, rue « de Wörth », du nom du village alsacien, théâtre de la charge des cuirassés de Reichshoffen et, par conséquent, d'une défaite française ; en sorte qu'en la rebaptisant, en se donnant pour adresse la « rue du Temple juif » au lieu de la « rue de Wörth », la diplomatie d'Adenauer et de ses successeurs faisait d'une pierre deux coups: elle effaçait une allusion antifrançaise malvenue en ces temps - années 50 - de « récupération de souveraineté » et elle redisait à la face du monde et, en particulier, d'Israël que « Quai d'Orsay », en allemand, se dirait dorénavant « rue de la Synagogue »... Geste magnifique. Engagement sacré.
La pensée du chancelier telle qu'elle me paraît ressortir, à la réflexion, du ton de ses deux éclats sur Reemtsma et Goldhagen: décrisper ces affaires de mémoire, alléger ce passé qui ne veut pas passer, penser à autre chose. C'est le côté « Terminator » de Schröder. Rapidité de l'intelligence, sans doute; brio; impression, par moments, de voir un écran d'ordinateur lui apparaître sur le front. Mais aussi, et c'est ce qui met mal à l'aise: tentation de l'effacement; l'écran qui, tout à coup, fait le vide, déprogramme tout, recommence. Les informaticiens du monde entier redoutent le « bug » de l'an 2000. Lui le souhaite. Il l'appelle de ses voeux. Il rêve d'un formidable « bug » qui, d'un seul coup, sur fond de fête, ferait passer l'Allemagne dans une modernité définitive. Gerhard Schröder ou le « bug » de la mémoire allemande. Ne m'a-t-on pas raconté qu'il est prévu de « désamianter », dans la partie Est de Berlin. l'immeuble du conseil d'Etat où il doit s'installer après Bonn? « Désamianter » n'est pas exactement « oublier ». Mais tout de même! Ce souci de décontamination au moment même où il s'installe dans les meubles de la RDA! On reste dans la même logique, au coeur de la contradiction majeure du « schröderisme »: d'un côté, tirant les ultimes leçons de la chute du Mur, une « Ostpolitik » à usage interne ; de l'autre, parce que le passé pèse trop lourd et qu'on préfère la fête à la mémoire, un « désamiantage » de l'histoire nationale, une neutralisation de sa part maudite - nazisme et stalinisme.
Schröder et Walser .. Le chancelier et le romancier .. L'un veut changer de mémoire. L'autre, quand il en a assez de voir des images de la Shoah à la télé, réclame le droit de changer de chaîne et de zapper. Du « bug » au « zap ». D'un effacement, l'autre. Il y a, dans l'Allemagne d'aujourd'hui, des gens qui revendiquent le droit, non de nier l'horreur, mais de ne plus la voir, de la contraindre à quitter nos écrans mentaux. Sauf - ce serait sans doute l'argument de Dick et de la plupart des jeunes Allemands qu'un certain Victor Hugo a tout dit sur la question: vous pourrez toujours essayer de zapper, buguer, fermer les yeux - l'oeil reste dans la tombe et regarde Schröder et Walser...
« Timide tentative, dirait Franz Hessel, de promenade dans le coeur de Berlin » La rue du 17 juin, en mémoire de l'insurrection ouvrière de 1953. La colonne de la victoire, flanquée des statues de Rohn et Moltke. La porte de Brandebourg. Le « quartier des Français » avec ses vieilles maisons pastel jaune paille, rose indien, mauve, vert amande qui sont comme un conservatoire du Berlin du XVIIIe siècle. L'Université Humboldt. L'Opéra. Le petit temple grec qui fut le monument aux morts des guerres allemandes avant de devenir celui des « victimes du fascisme et du militarisme ». La cathédrale protestante, où Goering s'est marié. Le Château, enfin, des Hohenzollern que tout le monde semble d'accord pour reconstruire à l'identique, pierre par pierre, sur les plans d'origine de Andreas Schlüter. Rien de tout cela n'est nouveau, certes. Mais l'impression est saisissante. Il y a mémoire et mémoire. Il y a celle que l'on zappe et celle que l'on promeut. C'est le même Berlin qui croule sous les « Mahnmale », les honore, les restaure et fait, tout à coup, tant d'histoires pour construire un monument à la mémoire des « Juifs assassinés d'Europe ».
Un autre exemple de ce « deux poids deux mesures ». C'était l'autre soir, près de Bonn, sur les hauteurs de Remagen, dans le château d'Ernich qui est, depuis cinquante ans, la résidence des ambassadeurs de France. Le parc. Le pont de Remagen, en contrebas, dont les lumières brillent dans la nuit. L'ombre d'Apollinaire qui a choisi là, tout près, à cause de la source « Apollinaris », son pseudonyme. Celle, aussi, de William Gaddis, l'écrivain new-yorkais qui vint après la guerre, pour l'armée américaine d'occupation, tourner un documentaire sur le pont et sur la bataille qui, ici même, au pied du château, a décidé du sort de la guerre. « Un endroit incroyable, n'est-ce pas », murmure l'ambassadeur. François Scheer, en s'approchant de la baie ouverte sur la nuit claire et sur le Rhin? Histoires du pont. Souvenirs de diplomate et d'esthète. Et puis, de fil en aiguille, sur un ton de liberté peu habituel chez un diplomate de ce format, deux récits politiques qui, dans mon esprit, se connectent aussitôt. La commémoration ratée du 11 novembre 1918: Chirac avait invité Kohl et Schröder, une fois élu, se vexe. La célébration sans problème, à quelques jours d'intervalle, des « Paix de Westphalie » de 1648: c'est lui, l'ambassadeur, qui y représentait la France et il témoigne, là, en revanche, du faste des cérémonies. L'ambassadeur a beau dire. Il est difficile - et il le sait - de ne pas faire le lien. D'un côté, le service minimum d'une Histoire immédiate que l'on s'efforce de refroidir. De l'autre, pour un événement vieux de 350 ans, une célébration maximale, des expositions à Münster et Osnabrück, des manifestations monstres en présence de toutes les têtes couronnées d'Europe. Voilà à quoi risque de ressembler cette veille de l'an 2000 dans l'histoire de l'Allemagne. Voilà un pays qui, l'année même où il « oublie » de commémorer l'entrée, en 14-18, dans l'âge des boucheries qui conduiront jusqu'à la Shoah trouve non seulement l'argent, mais le désir, le temps, de fêter comme jamais ce que les nationalistes des années vingt considéraient comme l'installation, pour. deux cents ans, dans « la grande humiliation allemande ».
Bonn, encore. Un immeuble parmi d'autres. Une plaque, à gauche de l'entrée. On dirait une plaque de dentiste. Ou d'avocat. Elle dit simplement, cette plaque: « Dr. Helmut Kohl, Bundeskanzler, a. D ». Traduction: « a. D. », comme « ausser Dienst », littéralement « hors service », ou « à la retraite » - Helmut Kohl, « chancelier à la retraite » comme on dit « recteur honoraire » ou « ex-ambassadeur ». Toujours la modestie de l'État. Celle, aussi, de l'ex-chancelier - peut-être teintée d'humour - redevenu, en un clin d'oeil, après seize ans de pouvoir, un citoyen parmi d'autres. Mais cette question, surtout, qui me trotte dans la tête jusqu'au lendemain: que serait-il advenu du projet de Mémorial s'il l'avait finalement emporté? y aurait-il eu, sous son règne, un débat aussi vif? Kohl et son monument. Kohl et son mot malheureux sur la « grâce de la naissance tardive ». Le forcing de Kohl, à la fin, pour que soit posée la première pierre, la vraie, celle qui rendait l'entreprise irréversible. Et le maire de Berlin, Eberhard Diepgen, pourtant du même parti que lui, qui ne veut pas voir sa ville devenir la « capitale de la pénitence allemande ». Kohl, ou la fin d'une époque. Kohl, ou 1'ultime.représentant d'un régime de la conscience et de la mémoire.
Et si Martin Walser était en train, tout simplement, de se prendre pour Martin Luther? Et si ce catholique s'était mis en tête de parler le Luther dans le texte? Oh! Pas le Luther antisémite. Pas celui des « Propos de table » de la fin: « brûlez les Talmuds! brûlez les Juifs avec, car ce sont des Talmuds vivants! » Mais le Luther de l'appel à la conscience. Le Luther de la « foi seule », de l'« intériorité » muette, impérieuse. Un Luther qui, remis au goût du jour selon Walser, nous dirait: contre la ritualisation de la mémoire, contre la manière à la fois juive et catholique de se souvenir, j'en appelle à une intimité autiste de la conscience avec elle-même et avec Dieu. « Seul contre tous », dit Walser. « Je suis seul contre tous, mais je n'en démords pas. » Et on entend, en écho, le « j'en suis là, je n'en bougerai pas » de Luther face à Charles Quint... Religion et politique. Résurgence, dans les débats les plus actuels, des plus anciennes questions religieuses. Remarque de Laurent Dispot, qui me cornaque durant ce voyage: « on ne fait jamais assez de sociologie religieuse quand on essaie de comprendre l'Allemagne contemporaine ».
Martin Luther... Martin Heidegger... Martin Walser... A chaque tournant de l'histoire allemande, un Martin? je veux dire un « grand réformateur », venant offrir son « grand discours » fondateur: les « 95 thèses contre les Indulgences » de Luther, à Wittenberg ; le « Discours du Rectorat » de Heidegger, à Fribourg; et puis, cette fois-ci, le « Remerciement » pour le « prix des libraires », à l'église Paul? C'est faire beaucoup d'honneur à Walser. Mais allez savoir si ce n'est pas ce qu'il a dans la tête quand il se plaint de ce « service » de la mémoire « Dienst », le mot même de Heidegger - que les Allemands d'aujourd'hui seraient contraints de célébrer. Allez savoir si ce n'est pas ce qu'ont à l'esprit tous ceux qui, dans cette affaire, ont pris parti pour lui. Ce matin encore, le chauffeur de taxi: « vous ne trouvez pas bizarre, vous, qu'on nous embête avec ce Mahnmal au moment même où, comme par hasard, les Juifs réclament de l'argent aux banques et aux compagnies d'assurance? »
La maison d'Oskar Schindler - le Schindler de la « Liste » - face à la gare. Celle de Goethe, à côté de l'hôtel. Goethe justement - à cause de « l'année Goethe » - à la devanture des librairies. Un monde fou dans les rues. Il me semble, pas mal d'étrangers. Un parfum de grande capitale, dès la descente du train, que l'on sentait moins à Berlin. Sommes-nous toujours en Allemagne, ou déjà en Europe? Nous sommes à Francfort. Nous sommes dans la ville - pêle-mêle - de Goethe, des Rothschild, d'Adorno, de la Banque centrale européenne et de l'école de Francfort. Nous sommes dans la ville de Ignatz Bubis, président de la communauté juive allemande et, pour l'heure, adversaire de Walser: « vous livrez des munitions à l'extrême droite », lui a-t-il dit; « vous êtes un incendiaire spirituel »...
Bubis donc, chez lui. Rondeur pétillante. Mélange de malice et de bonhomie. Prototype, aussi, de ces juifs allemands, plus allemands que les Allemands, constitutifs du génie de l'Allemagne, pièce à jamais manquante dans le puzzle de l'« unité » retrouvée. A-t-il jamais regretté ce choix de revenir ici, après 1945, recommencer la vie? S'est-il jamais dit: je me suis trompé, on ne peut plus être juif, en Allemagne, après Auschwitz? « Oui, dit-il. Une fois. Pendant huit jours. C'était en 1985, au moment où la Schauspielhaus a failli monter la pièce de Fassbinder, "Les déchets, la ville, la mort": vous savez, l'histoire de ce "Juif riche", mais supposé "intouchable" à cause de la Shoah, que les édiles de Francfort instrumentalisent pour couvrir leurs trafics immobiliers. » L'immobilier… Francfort... N'était-il pas lui-même, dans ces années, promoteur immobilier à Francfort? Et Fassbinder, pour imaginer son « Juif riche », n'a-t-il pas forcément pensé à lui? Bubis rit. « Il y a des gens qui, à l'époque, ont affirmé cela. je les ai poursuivis. » Aujourd'hui, alors? L'affaire Walser? Cet écrivain de gauche, longtemps proche des communistes, soutenu par le chancelier, qui déchaîne une tempête en disant que le temps est venu de « tourner la page » d'Auschwitz? Bubis, cette fois, se rembrunit. « Oh Walser... » Mais, très vite, il m'entraîne dans la pièce voisine, sans doute le bureau de sa secrétaire: « tenez ; c'est mon courrier de ce samedi matin ; on va l'ouvrir ensemble ; une lettre d'encouragement ; une autre ; une troisième qui me dit "tenez bon! "; là, non, ce seront des insultes ; regardez; j'en étais sûr ; je les détecte dès l'enveloppe, à cause de l'écriture ; ça nous fait trois sur quatre ; c'est, depuis huit jours, la proportion ; ce qui veut dire, n'est-ce pas, que c'est Walser qui a perdu. » Bubis est triste mais serein. Il se serait passé, sans doute, de ce débat. Mais il a confiance en l'Allemagne. Il sait qu'il n'a pas eu tort, il y a cinquante ans, de faire retour dans sa « petite patrie » de Francfort. Un instant, pourtant, l'idée m'effleure: à quoi ressemble, ce même matin, le courrier de Martin Walser?
Le concierge de nuit de l'hôtel. Proustien comme il n'est pas permis. Lecteur assidu du « Feuilleton » - c'est-à-dire du supplément culturel - de la Frankfurter AlIgemeine Zeitung. Quand Bubis, me dit-il, traite Walser d'« incendiaire des esprits », une oreille francfortienne cultivée entend trois choses. Le livre de Max Fritsch, Bidermann et les incendiaires. L'incendie du Reichstag: « vous n'êtes pas un antisémite, Monsieur Walser; vous êtes un innocent; vous êtes juste un simplet qui mettez le feu aux esprits... » Ou, enfin, les incendies de la « Nuit de cristal » si mal nommée: en cette nuit fatale du 9 novembre 1938, l'important, l'horrible, n'était-il pas le crépitement des incendies plus que le bruit des vitres brisées? et, d'ailleurs, sa réponse à Walser, Bubis ne l'a-t-il pas faite ce 9 novembre 1998, dans son discours anniversaire, justement, de la nuit des incendies?
Consternant, vraiment, ce débat? Pas sûr. Car comparons. Ici Bubis-Walser. Chez nous... J'hésite à l'écrire, mais enfin... Pendant que les Allemands s'enflamment pour ou contre le « Mémorial », pendant que la Frankfurter publie, sur quatre pages, la sténographie d'un entretien de haut niveau entre le romancier et le porte-parole des juifs allemands et que le grand public, ce jour-là, se rue sur le journal et fait bondir son tirage de presque un quart, pendant qu'on discute, dans les familles, du sens des mots, de leur étymologies comparées - pendent ce temps, donc, nous en sommes, nous, au débat Le Pen-Mégret. Pas de quoi pavoiser. Ni donner de leçons de morale aux Allemands.
Bubis encore. Grande synagogue de Francfort. Ce n'est pas la « vraie » grande, incendiée en 1938, jamais reconstruite depuis. Mais c'est l'autre. La moyenne L'ancienne synagogue libérale saccagée mais restaurée, et devenue, avec les années, le temple du judaïsme orthodoxe à Francfort. Bubis est, plus que jamais, dans son royaume. Les fidèles, dès qu'il paraît, se pressent autour de lui, l'embrassent, l'encouragent. Et lorsqu'il monte en chaire, pou prononcer son discours d'hommage à l'homme dont, ce matin, on fête les soixante-dix ans, un silence affectueux se fait. Double visage de Bubis. Il y a le grand Bubis, celui qui est connu dans toute l'Allemagne et dont on a avancé le nom, il y a cinq ans, pour succéder à Richard von Weizsäcker à la présidence de la République - celui qui, tout à l'heure, quand il a téléphoné pour demander un taxi, a juste dit « Ich bin Bubis -, et on entendait, à distance, l'émotion du standardiste, on le devinait presque rectifiant la position. Et puis, il y a Papy Bubis, Bubis le familier, au milieu de ses contemporains et des jeunes juifs de Francfort, leurs enfants - dans cette synagogue trop grande où l'on sent l'étouffante et douce présence des morts. Je trouve, à cet instant, qu'il ressemble à Ben Gourion. Le dernier Ben Gourion. Celui des rencontres avec Adenauer et de l'acceptation, par Israël, des réparations allemandes. Voilà, oui, une piste: une Allemagne qui, à cause de la chute du Mur, de l'Europe et, maintenant, des débats sur le droit du sol et la double nationalité, serait au seuil d'un « passage » aussi décisif que celui, il y a cinquante ans, de la « récupération de souveraineté » - et un Bubis qui, dans ce nouveau passage, jouerait le même rôle apaisant, rassurant, que Ben Gourion dans celui d'autrefois.
Il a une lettre, dans sa poche, qu'il me montre chez lui, au retour de la synagogue. C'est une lettre de Frank Schirrmacher, l'un des directeurs de la rédaction de la Frankfurter. C'est lui qui, selon les méchantes langues, aurait orchestré la polémique. Et c'est lui qui, en tout cas, a prononcé, dans l'église Paul, la « laudatio » qui introduisit le discours « incendiaire » de Walser. Or voici ce qu'il écrit à Bubis: « si vous n'aviez pas réagi avec cette dureté, la controverse n'aurait jamais eu lieu ; mais elle est, on s'en rend compte, infiniment nécessaire; cher Monsieur Bubis, je n'ai pas seulement admiré votre calme, votre fermeté inébranlable, dans ce débat à la "FAZ" ; mais aussi vos efforts, qui m'ont beaucoup impressionné, pour aller au devant de Walser et le comprendre ; le dialogue aurait peut-être pu s'élever à un niveau supérieur si Martin Walser s'était, de son côté, efforcé de vous comprendre aussi ». Comment, après une lettre pareille, douter que Bubis l'ait emporté? Comment désespérer de l'Allemagne et de son inépuisable ressource démocratique?
« Je ne suis entré dans ce débat que pour protéger Bubis. » L'homme qui s'exprime ainsi est la conscience du pays. C'est l'homme qui, dans un discours resté célèbre, prononcé au lendemain de la visite de Kohl et Reagan au cimetière de Bitburg, avait osé dire que « le 8 mai 1945 est le jour de la libération de l'Allemagne ». C'est l'ancien président Richard von Weizsäcker, dans sa maison de Dahlem, le quartier résidentiel de Berlin, qui fut aussi, sous l'égide du pasteur Martin Niemöller, la seule paroisse protestante à tenir tête au nazisme. C'est une maison qui ne lui ressemble qu'à moitié. Patricienne, sans doute. Elégante. Mais un mélange un peu incongru d'Allemagne et de Chine, de vieux meubles de cuir cossus et d'estampes, objets chinois, fine porcelaine laine des tasses à thé, bibelots. Et puis, comme chez le chancelier, un tableau moderne, inattendu dans le grand salon clair: le portrait de la grande actrice juive allemande, interprète fétiche de Brecht et, notamment, de « Mère courage », Therese Giehse. « Pourquoi faut-il protéger Bubis, reprend Weizsäcker, sous l'oeil sévère et triste de Therese Giehse? Parce que cette idée qu'il était possible, pour un Juif, de revenir vivre en AIlemagne n'était pas une idée qui allait de soi et... » Sa femme entre, avec un samovar. Elle est belle. Elle porte une jupe longue en gros velours bronze, façon bavaroise ou tyrolienne, qui lui donne un air de jeune fille. Le vieux Président en est tout métamorphosé: rosissement des joues, tendresse nouvelle dans le regard bleu-vert - il ressemblait à Jünger; le voici qui ressemble à Novalis, baron de Hardenberg. « Le fond de l'affaire, reprend-il, c'est qu'il faudrait se débarrasser de Walser. » Je sursaute. « Je veux dire: se débarrasser, dans ce débat, de Walser. Car Walser ne fait pas le poids. Il n'est à la hauteur, ni de Bubis, ni de ce débat qu'il a lancé. Ç'aurait pu être un beau débat, remarque z. Mais pas avec lui, pas avec ce type, honnête certes, mais falot et tellement petit bourgeois... » Voyant que je souris, il s'enhardit: « au fond, je ne respecte pas Walser ; il a donné, l'autre jour, une interview au Bild pour expliquer que le pire, pour un homme, était de mourir de mort naturelle et il a pris l'exemple de Hemingway qui lui, au moins, a choisi sa mort. Non, mais quel culot! Que ne prend-il modèle sur Hemingway pour écrire de meilleurs livres? » Weizsäcker rit. « Bubis est un personnage; il en fait trop, mais c'est un personnage; alors que Walser n'est pas un personnage! » Il a élevé le ton. Il est en colère, tout à coup, à l'idée que Walser ne soit pas un personnage. Dont acte. La cause est entendue. Weizsäcker est la conscience de l'Allemagne. Puisque cette « conscience » choisit d'ignorer Martin Walser, j'en ferai désormais autant. Et pourtant...
Reste le débat sur le « Mémorial ». Il y a, si l'on essaie de résumer, cinq arguments en circulation contre le principe même de sa construction. 1. On ne verra que lui; il écrasera la ville de tout son poids de culpabilité, de honte. Réponse: heureuse honte! deuil béni! rien n'est plus beau qu'un peuple qui, comme le peuple allemand, décide de regarder ses crimes. 2. On ne le verra pas ; on ne voit, très vite, plus les monuments. Réponse: il faudrait s'entendre ; mais admettons ; les monuments, à la limite, sont autant faits pour être là que pour être vus ; c'est un marquage symbolique ; un témoignage ; ce sera - osons le mot - comme une circoncision de la ville. 3. Pourquoi un monument nouveau? N'y a-t-il pas déjà - c'est l'argument, notamment, de Schröder - les ruines des camps, celles de la villa Wannsee, le Musée juif de Berlin? Ne tient pas, là non plus. Car ceci n'empêche pas cela. Et on voit mal en quoi la présence de ces éclats brisés du Témoignage interdirait de bâtir, dans la ville capitale, un grand monument national. 4. L'argument d'une partie de l'extrême-gauche et, notamment, de Günter Grass: oui au principe d'un Mahnmal, mais à condition qu'il commémore aussi les autres victimes du nazisme: homosexuels, tsiganes, Slaves, esclaves divers. Ne s'aventure-t-on pas, en raisonnant ainsi, sur le terrain ô combien périlleux de la concurrence des victimes et de la négation, nonn seulement de la Shoah, mais aussi, de proche en proche, des crimes dont elle est l'étalon? 5. L'argument d'Helmut Schmidt enfin, mais repris par beaucoup d'autres: un monument pareil, c'est un pousse-au-crime ; il faudra des dispositifs de sécurité formidables pour empêcher les gens de venir pisser dessus. Souci, on en conviendra, bien étrange dont il est permis de se demander s'il exprime un risque ou un fantasme et auquel on opposera la belle idée lancée, l'autre soir, dans la conversation, par Tilman Fichter, Professeur à l'école des cadres du SPD. une compagnie de jeunes gens guidant les visiteurs, racontant et expliquant la destruction des Juifs d'Europe et montant, par la même occasion, une sorte de garde tournante... Non. Aucune de ces raisons ne tient. Il n'en reste, au fond, qu'une - qui saute aux yeux, ce matin, porte de Brandebourg, à deux pas de l'ancienne Chancellerie, face à l'esplanade encore déserte prévue pour le « Mahnmal »: l'effroi face à la tâche ; le vertige ; l'impossible représentation du Mal absolu... Mais bon. Comme disent encore, et Tilman Fischer, et Lea Rosch, qui est, depuis dix ans, l'âme du projet: « c'est difficile? c'est un défi lancé à l'Art et à la conscience universelle? raison de plus pour ne pas céder, imaginer, travailler.... »
L'autre semaine, ce groupe de jeunes gens, sans doute des
Allemands de l'Est, qui lâchent, en plein Berlin, sur Alexanderplatz -
« Berlin Alexanderplatz », tiens, encore Fassbinder... - un cochon de
quatre mois sur lequel ils ont peint une étoile de David et, en grandes lettres
bleues de 25 centimètres, les cinq lettres
 |
 |
 |
____________________________
Server / Server
© Michel Fingerhut 1996-2001 - document mis à jour le 05/12/2000 à 15h29m38s.
Pour écrire au serveur (PAS à l'auteur)/To write to the server (NOT to the author): MESSAGE