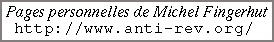

Danièle Lochak est professeur de droit public à l'Université de Paris X-Nanterre
Il est difficile d'évoquer le rôle de la doctrine sous Vichy sans que le propos soit immédiatement perçu comme polémique. Et cela, bien au-delà du cercle somme toute restreint de ceux qui pourraient ressentir cette évocation comme une mise en cause personnelle. Toute analyse critique de la production doctrinale de l'époque comme celle que j'avais tentée dans une précédente étude[1] court le risque d'être interprétée comme une attaque contre les juristes en général et contre la corporation des professeurs de droit en particulier.
Il ne s'agit pourtant pas, en se penchant sur ce qui s'est dit ou écrit dans les Facultés de Droit et les revues juridiques entre 1940 et 1944, d'adopter cinquante ans après la posture confortable du juge, encore moins de s'ériger en purificateur idéologique d'un passé que l'on n'a pas vécu au nom des évidences d'aujourd'hui. S'il l'on revient sur "ce passé qui ne veut pas passer", ce n'est pas seulement pour tenter d'éclairer une période obscure, dans tous les sens du mot, de notre histoire, mais aussi parce que ce retour fournit l'occasion et le moyen de s'interroger de façon plus générale sur le rôle et la responsabilité propres du juriste dans la société, sur les fonctions que remplit, éventuellement à l'insu de son auteur, voire à son corps défendant, le discours juridique. En gardant à l'esprit, comme le rappelait Alfred Grosser à l'occasion d'un colloque consacré à "Juger sous Vichy"[2], que "l'étude du passé n'a guère de sens, lorsqu'il s'agit de comportements finalement appréciés en termes de morale, si elle ne se prolonge pas par une réflexion sur le présent".
C'est dans cette perspective qu'il m'a paru utile de réexaminer, à la lumière des objections qu'elles ont pu susciter, les hypothèses avancées dans l'étude déjà évoquée. La première objection peut s'énoncer de la façon suivante : la mise en lumière des effets néfastes des commentaires doctrinaux qui se voulaient neutres et objectifs implique-t-elle que la seule alternative acceptable de la part des juristes face à la législation antisémite eût été soit de se taire, soit à l'inverse de prendre clairement parti ? Question qui renvoie à son tour à une autre, plus générale : que doivent faire les juristes confrontés à des lois qu'ils jugent non pas simplement critiquables mais moralement inacceptables ?
La seconde objection, d'ordre plus théorique, peut également être énoncée sous forme de question : si effets néfastes il y eut, est-ce le positivisme et sa prétention à la neutralité qu'il faut incriminer, ou doit-on admettre à l'inverse, avec Michel Troper[3], que c'est l'incapacité de la doctrine à s'en tenir aux stricts préceptes d'une science du droit positive qui l'a perdue ?
Je me propose donc, après avoir brièvement résumé les thèses énoncées précédemment et rappelé en quoi les commentaire doctrinaux de la législation antisémite ont contribué à banaliser cette législation et à légitimer l'antisémitisme, d'examiner ces différentes objections, en vérifiant si elles ne sont pas, à leur tour, réfutables.
Les tribunaux sont appelés à trancher toute une série de problèmes délicats et complexes. La nouveauté et la complexité même de ces problèmes excite la sagacité des juristes : la doctrine emboîte le pas aux juges, se livrant à ce minutieux travail d'exégèse, d'interprétation des textes, de recherche de la volonté du législateur, d'analyse critique de la jurisprudence, dans lequel elle excelle. Mais l'intérêt porté à ces questions va de pair avec leur banalisation : loin d'être considéré comme un droit d'exception, le droit antisémite vient tout naturellement prendre place parmi les autres branches du droit et se trouve consacré comme discipline à part entière.
L'effet de banalisation se manifeste également dans la façon naturelle, presque candide, avec laquelle les auteurs entreprennent d'analyser les textes nouveaux et de commenter la jurisprudence, utilisant sans la moindre distance les catégories du législateur, voire tout simplement les catégories de l'antisémitisme officiel. Le "métis juif", la "race juive", l'"aryanisation" des entreprises : les catégories du droit antisémite s'intègrent sans résistance dans les catégories du droit commun.
De cette transmutation de la logique antisémite en pure logique juridique on trouve de nombreux exemples. Ainsi, lorsqu'il s'agit de justifier la compétence que les tribunaux civil se sont reconnue sans hésitation pour statuer sur les contestations relatives à la qualité de juif, la quasi-totalité des auteurs s'accordent pour estimer que l'appartenance à la race juive est bien une question d'état et entreprennent de le démontrer à l'aide d'arguments concordants et convaincants : la qualité de juif soulève avant tout une question de filiation, puisqu'elle résulte de la condition des grands-parents ; elle peut soulever en outre une question de preuve de mariage, dans l'hypothèse où l'appartenance à la race juive dépend de la condition du conjoint ; l'appartenance à la "race juive" entraîne de surcroît une série d'incapacités, ce qui achève de plaider en faveur de la thèse défendue[4].
De sorte que la "race juive", assimilée à une banale question de nationalité ou de domicile, vient trouver sa place parmi les catégories connues du droit civil, à l'issue d'un raisonnement qui occulte entièrement les conséquences attachées à la qualification de "juif". Les auteurs jonglent avec les textes et les concepts antisémites sans apercevoir ce qu'il peut y avoir de scabreux dans la subtilité même de leurs constructions juridiques, dans cette application à raisonner de façon strictement abstraite et formelle.
On ne trouve pour autant aucune marque d'hostilité virulente à l'égard des Juifs dans la littérature juridique de l'époque. Les auteurs s'appliquent à décrire consciencieusement le contenu des dispositions nouvelles, mettent en évidence le cas échéant certaines contradictions et imperfections de la législation, approuvent ou critiquent les décisions juridictionnelles en fonction du seul critère de leur compatibilité avec les principes d'interprétation traditionnels.
Mais c'est précisément parce qu'il se voulait neutre et présentait toutes les apparences de l'objectivité, parce qu'il n'était pas ouvertement militant et idéologique que le discours des juristes a pu, nous semble-t-il, remplir efficacement sa fonction de légitimation.
De fait, la plupart des juristes ont considéré que l'ordre juridique issu de la "Révolution nationale" était un ordre juridique valide, et que le droit antisémite, en particulier, dès lors qu'il était effectivement en vigueur, pouvait et devait être étudié avec les mêmes concepts et la même technique que d'autres branches plus "classiques" du droit. Ils se sont par ailleurs efforcés au maximum d'éviter de porter des jugements de valeur - positifs ou négatifs - sur les textes qu'ils commentaient. Sans doute peut-on relever, ici ou là, un signe discret d'approbation, ou plus rarement de désapprobation, consciente ou inconsciente. Mais ce qui frappe, lorsqu'on lit la majorité des textes, c'est bien cette volonté, revendiquée et parfois affichée de façon ostentatoire, de rester neutre, qui tranche sur la tendance qu'a souvent la doctrine, en dépit de ses professions de foi positivistes, à se défaire d'un jusnaturalisme latent. Lorsqu'il s'agit des Juifs, les mêmes auteurs qui n'hésitent pas à donner leur opinion sur les lois qu'ils commentent semblent n'avoir plus rien à dire. Comme si, à force de s'astreindre à la neutralité, leur sens critique avait fini par s'anesthésier.
On peut en revanche avancer l'idée qu'en prenant au sérieux la législation raciale, en traitant le droit antisémite comme une banale branche du droit, la doctrine a participé à la légitimation de la politique antisémite de Vichy et contribué à sa façon à en faciliter tant l'acceptation que l'application. En dissertant doctement et sans passion de ces questions, ils leur conféraient une sorte de respectabilité : car quelle impression pouvait-on retirer de la lecture de ces notes et de ces chroniques, sinon que l'ostracisme légal frappant les Juifs était une chose normale, naturelle, aussi normale et naturelle que toute autre mesure édictée par le législateur ? En se livrant à l'analyse des nouveaux textes pour - selon les termes de l'un d'eux - contribuer à leur intelligence et en faciliter l'application, la doctrine ne pouvait que renforcer la crédibilité de la législation antisémite, en redoublant en quelque sorte l'effet de "naturalisation" grâce auquel le droit agit sur les représentations collectives et contribue à inculquer une certaine idée de la normalité.
Les lois raciales, au-delà de leur contenu concret, du nouvel ordre juridique qu'elles tendaient à instaurer, imposaient une vision du monde fondée sur le partage de la société en deux catégories, en deux "races" distinctes et inégales : les Juifs et les aryens ; or la doctrine, en acceptant - fût-ce de façon purement formelle - d'entrer dans le système de pensée du législateur, en acceptant de raisonner à l'intérieur du cadre conceptuel ainsi tracé, en reprenant à son compte des catégories juridiques qui n'étaient autre que les catégories idéologiques de l'antisémitisme d'Etat, entérinait implicitement mais nécessairement la vision du monde sous-jacente à la législation nouvelle .
En lisant, à l'époque, les lois et les décrets de Vichy, ou mieux encore l'analyse qu'en faisaient des juristes sérieux et compétents, qui reprenaient mot pour mot les termes du législateur, voire même en créaient de nouveaux, dérivés grammaticalement ou logiquement des premiers (tels qu'"aryanisation" ou "métis"), on ne pouvait douter un instant de l'existence d'une race juive, pas plus que de la nécessité d'aryaniser les entreprises.
Ainsi la doctrine a-t-elle contribué, quels qu'aient pu être par ailleurs ses sentiments profonds, à faire accepter la désignation des Juifs comme catégorie à part et leur exclusion de la société française[5].
Consciencieux - ou bien orgueilleux ? Car on ne peut négliger l'incitation à publier que constitue la pression d'une carrière à accomplir ou d'une notoriété à entretenir. Le représentant du ministère public dans ce même procès suggérait que Maurice Duverger avait pu céder au désir très humain de se rendre célèbre à vingt-trois ans, à la petite vanité pédagogique qui l'aurait conduit à être le créateur d'une doctrine. Et l'intéressé lui-même, loin de récuser cette explication, paraît bien la reprendre à son compte : évoquant la proposition que lui fit Bonnard de rédiger ses travaux sur les fonctionnaires "afin d'en faire l'une de ces longues et minutieuses analyses de lois et décrets dans la tradition de la Revue du Droit public", il reconnaît qu'il aurait pu refuser cette proposition. Et il ajoute, sur un mode interrogatif, certes, mais qui laisse néanmoins entrevoir qu'il ne se méprend pas sur ses propres motivations : "Est-ce l'orgueil qui me fit accepter ? Tous les manuels, tous les professeurs répétaient que "la doctrine" pouvait influencer la pratique et la jurisprudence. Présenter la première synthèse des textes nouveaux dans la plus sérieuse des revues juridiques, n'était-ce pas se hisser au niveau de "la doctrine" ? "[9]
Mais toute la question est de savoir si l'on pouvait parler des lois antisémites et de leur application sans se salir les mains, ou, disons, sans salir sa plume, auquel cas il n'y aurait eu d'autre alternative que de se taire. Faire le choix de l'abstention, du silence, n'était-ce pas le seul choix éthiquement acceptable ? André Glucksmann, appelé à témoigner, faisait valoir en ce sens que "rien n'oblige un juriste à commenter une loi ignominieuse". Dans le même sens, Pierre-Henri Teitgen, qui avait décidé pour sa part de ne pas évoquer dans ses cours les actes constitutionnels de Vichy, s'indigne dans ses mémoires de l'attitude de ceux de ses collègues qui avaient accepté d'exposer "sans broncher, par exemple, le statut des juifs établis par Pétain"[10]. A la propension des juristes, poussés par des objectifs carriéristes, à prendre la plume, Richard Weisberg oppose de son côté "la rhétorique du silence", cette forme de "refus éloquent de verser du fuel verbal supplémentaire sur une masse discursive inflammable"[11].
Dans le jugement rendu contre Actuel[12], le tribunal, tout en faisant écho à cette thèse, ne l'a pas reprise à son compte. "Le seul fait de publier un texte qui ne critique pas ouvertement une loi contraire à la morale ne suffit pas à caractériser la complaisance de son auteur à l'égard d'une telle loi", ont estimé les juges, qui poursuivent ainsi : "serait choquant le commentaire purement technique d'un texte privant certains individus de leurs droits en raison de leur race ou de leur religion. En revanche, peut être envisageable la démarche du juriste qui, sachant que la situation politique de son pays empêcherait la publication d'une critique trop évidente de la loi, suggère sous une forme voilée, pour venir en aide aux victimes de cette loi, l'interprétation permettant d'en restreindre autant qu'il est possible le champ d'application. Encore faut-il, pour que l'accusation de complaisance soit dépourvue de fondement, que cette critique, même implicite, existe".
Il y aurait donc - et la thèse est à examiner avec sérieux - plusieurs façons de parler des lois iniques, dont certaines seraient inacceptables, d'autres acceptables voire même souhaitables. Ce qui conduirait à distinguer selon les formes de la prise de parole, à tenir compte de la variété des postures adoptées par les auteurs. Nous nous proposons de revenir plus loin sur ces distinctions, qui ont en effet leur importance et qu'on ne peut considérer comme négligeables.
Pourquoi alors ne pas reconnaître que les auteurs auraient eu raison - ou en tout cas des raisons - de rédiger leurs commentaires, puisque ceux-ci étaient utiles, et de les rédiger en des termes mesurés, évitant la critique de front, afin de leur conférer plus d'efficacité ?
A vrai dire, si l'argument tiré des effets potentiellement bénéfiques des écrits doctrinaux pour les victimes de la discrimination mérite qu'on s'y arrête, ce n'est assurément pas l'article de Maurice Duverger sur les fonctionnaires qui serait de nature à nous persuader de son bien fondé. La relecture qu'il propose de son propre texte - par rapport auquel il prend d'ailleurs une étrange distance, parlant toujours de l'auteur à la troisième personne - visant à montrer que son ambition était de pousser les magistrats et les administrateurs "vers une interprétation susceptible de corriger les excès des lois d'exception", paraît en effet quelque peu forcée. Ainsi, par exemple, dans le développement consacré à la preuve, l'auteur insiste surtout sur le caractère irréfragable de la présomption de "race" attachée à l'appartenance à la religion juive, et sur l'existence d'une présomption légale, résultant de la non appartenance à une autre religion, qui facilite la preuve de l'appartenance à la religion juive[13].
Par ailleurs, lorsqu'il s'agit d'interpréter la disposition du statut de 1941 prévoyant la possibilité de relever des interdictions qu'elle édicte (« les juifs : 1. qui ont rendu à la France des services exceptionnels ; 2. dont la famille est établie en France depuis au moins cinq générations et a rendu à l'Etat français des services exceptionnels »), l'auteur prétend, de façon contestable au regard du principe de l'interprétation utile des textes, que la phrase est "ambiguë" sur le point de savoir si ces conditions sont alternatives ou cumulatives ; et il ajoute qu'il appartiendra à la jurisprudence de faire "un travail d'interprétation constructive"[14]. Pourquoi diable, s'il se préoccupait tant de sauver des Juifs, n'a-t-il pas proposé lui-même l'interprétation de la disposition soi-disant litigieuse qui aurait permis de conférer à l'exception le champ d'application le plus large ?
En ce qui concerne enfin la question de l'indemnisation, en insistant sur le fait que l'exclusion des Juifs était une mesure d'intérêt public, l'auteur pouvait éventuellement prétendre expliquer la raison d'une telle indemnisation ; mais sur le plan pratique, dès lors que le législateur avait lui-même prévu d'assurer l'indemnisation des fonctionnaires juifs évincés (et cela "scrupuleusement", dit Maurice Duverger[15]), on discerne mal à qui cette "construction juridique" pouvait bénéficier.
D'autres auteurs ont en revanche effectivement proposé des interprétations restrictives des textes sur lesquelles ont pu - ou auraient pu (nous ne savons pas ce qu'il en fut réellement) - s'appuyer les victimes des mesures d'exclusion.
Un des exemples les plus intéressants à cet égard, car aussi l'un des plus ambigus, nous est fourni par une chronique de Joseph Haennig parue à la Gazette du Palais en 1943 sous le titre : "Quels moyens de preuve peuvent être fournis par le métis juif pour établir sa non-appartenance à la race juive ?". Dans cette chronique, l'auteur propose de prendre modèle sur la jurisprudence allemande qui admet tous les moyens de preuve pour établir la non-appartenance à la race juive. Il cite en particulier l'exemple d'une femme issue par son père de deux grands parents juifs, dont les tribunaux allemands ont décidé qu'elle ne devait pas être considérée comme juive, bien qu'elle ait fréquenté l'école rabbinique, qu'elle ait accompagné son père une fois par an à la synagogue, qu'elle se soit inscrite en 1934 auprès d'un bureau de placement juif, et qu'elle ait été enregistrée sur la liste tenue par la synagogue, dès lors qu'elle avait été baptisée protestante, qu'elle n'avait été inscrite sur les listes de la synagogue qu'à son insu et n'avait jamais versé aucune somme à la communauté, que ses rapports avec le culte hébraïque étaient purement superficiels car ne visant qu'à sauvegarder la paix familiale, et qu'elle s'était inscrite auprès d'un bureau de placement juif uniquement parce que son nom lui interdisait d'être employée dans une famille aryenne[16].
Si l'invitation à regarder du côté de la jurisprudence des tribunaux allemands est évidemment troublante - nous reviendrons plus loin sur ce point -, force est de constater qu'il ne s'agit nullement d'inciter les tribunaux français à plus de rigueur et de sévérité dans l'application des textes : tout au contraire, l'auteur vise à mettre en évidence l'"esprit large et objectif" dont témoigne la jurisprudence allemande en matière de preuve.
De façon générale, la plupart des commentateurs ont affirmé sans hésitation qu'en cas de contestation sur la qualité de Juif, la preuve devait incomber à l'administration, conformément aux principes traditionnel résumés dans l'adage latin "actori incumbit onus probandi". Devant les tribunaux répressifs, en particulier, c'était au ministère public d'établir que les conditions constitutives du délit étaient réunies et que la personne poursuivie pour défaut de déclaration imposée par la loi sur le recensement des Juifs y était effectivement astreinte : car si l'on suivait l'administration qui prétend renverser le fardeau de la preuve, on aboutirait à une extension arbitraire et injuste du texte, contraire au principe de l'interprétation restrictive des lois pénales[17].
Au nom de ce même principe, les auteurs ont contesté vigoureusement l'attitude de l'administration qui entendait considérer comme juif un individu dont les grands-parents paternels étaient juifs, mais dont la grand-mère maternelle était catholique et le grand-père maternel inconnu : non seulement ceci revenait à présumer que le grand-parent inconnu était juif, et donc à interpréter les textes de façon extensive, mais accepter une telle présomption eût contraint l'intéressé à faire la preuve que son grand-père maternel n'était pas juif, en contradiction avec les dispositions du code civil qui interdisent la recherche de la paternité naturelle[18].
De même furent critiqués les jugements - ultérieurement annulés en appel - qui acceptaient de considérer comme juif un individu issu de deux grands-parents juifs seulement, et dont il était établi qu'il n'avait jamais appartenu à la confession juive, dès lors que, n'appartenant à aucune religion, il ne pouvait apporter la preuve qu'il avait adhéré à l'une des deux confessions reconnues par l'Etat avant la loi de 1905, seul mode de preuve de la non-appartenance à la religion juive prétendument admis par le législateur [19]. A l'inverse, les auteurs approuveront les décisions qui reconnaissent que la preuve de la non-appartenance à la religion juive peut être établie par tous moyens[20].
On relève également au passage l'emportement du commentateur contre le jugement qui, à propos d'enfants en bas âge, prétendait que le fait d'avoir été baptisé ne pouvait être considéré comme le signe de l'adhésion à la confession catholique, laquelle exige "une volonté réfléchie et nettement exprimée" que ne sauraient posséder des enfants de moins d'un an, de sorte que leur père avait effectivement commis un délit en les déclarant comme "sans confession" et non comme "juifs". Ce jugement, que la Cour d'appel d'Aix devait d'ailleurs annuler, faisait fi, déclarait le commentateur, du principe selon lequel les lois pénales, les lois d'exception et celles qui édictent des déchéances sont d'interprétation restrictive, principe qui "représente le minimum de garantie due, dans une société civilisée, à la protection individuelle, même lorsqu'ils s'agit de juifs" [souligné par nous]. Il n'avait guère de peine à démontrer les conséquences absurdes auxquelles aboutissait une attitude aussi rigide : "décider qu'un enfant qui n'a jamais pratiqué le moindre rite hébraïque, qui n'a jamais été circoncis, même par mesure d'hygiène, et qui, au contraire, a été baptisé selon le rite catholique, appartenait à la religion juive, est un résultat franchement inattendu pour un homme de sens commun. Et condamner cet homme moyen à une peine correctionnelle pour ne l'avoir pas prévu, alors que des juristes en demeurent encore tout ébahis, c'est peut-être faire assez bon marché de l'élément intentionnel indispensable à la consommation d'un délit pénal". Et l'auteur concluait, sur le mode ironique, que le tribunal de Brive "nous fait tous naître dans la religion juive et nous condamne à y demeurer jusqu'à ce que l'âge de raison nous permette d'en sortir par une adhésion réfléchie au catholicisme"[21].
On peut enfin citer, comme exemple d'interprétation a priori favorable aux victimes de l'exclusion, une étude consacrée aux mesures d'"aryanisation économique"[22], dans laquelle l'auteur s'attachait à démontrer que l'administration des biens juifs et leur liquidation devaient être soumises au contrôle du juge judiciaire qui a pour "mission traditionnelle d'être la sauvegarde des patrimoines privés". Dans la mesure où le Commissariat général aux questions juives était, lui, fermement attaché à défendre la compétence du juge administratif, on peut penser que la thèse de la compétence judiciaire était de nature à offrir aux intéressés une garantie plus efficace contre les mesures de spoliation dont ils étaient victimes.
La question appelle à mon sens une réponse négative. Et cela pour plusieurs raisons.
Il est sans doute peu réaliste de penser que par leur silence ou leur abstention les juristes auraient pu paralyser le système. Ce qui est vrai, en revanche, c'est qu'ils auraient ainsi évité d'apporter leur caution à un mécanisme d'exclusion qui tirait une partie de sa légitimité apparente de son caractère formellement juridique. Ce mécanisme s'appuyait en effet sur des textes que chacun à sa façon et avec ses préoccupations propres - l'administration, les tribunaux, les avocats, la doctrine... - contribuait à appliquer[25] ; et le seul fait de participer à ce processus d'application des textes, y compris en en proposant une interprétation restrictive permettant d'y faire échapper certaines personnes, contribuait à en asseoir la crédibilité et la légitimité puisqu'il fallait pour cela raisonner à l'intérieur des cadres et avec les concepts imposés par le législateur.
Le problème soulevé dépasse au demeurant très largement la période de Vichy et la question de l'antisémitisme. Ainsi, par exemple, aujourd'hui, les associations qui, dans un contexte qui n'est certainement pas assimilable à celui de Vichy, se préoccupent du sort des étrangers, se trouvent parfois placées devant un dilemme qui n'est pas sans analogies avec celui que l'on vient d'évoquer. Tout en récusant globalement une législation qu'elles jugent de plus en plus attentatoire aux principes démocratiques fondamentaux et à l'universalité des droits de l'homme, elles n'en sont pas moins amenées, dans la défense des cas individuels et pour des raisons d'efficacité pratique, à s'adapter aux normes définies par l'administration, à utiliser les arguments qu'elles savent recevables par elle, et à sélectionner les dossiers qu'elles lui soumettent en fonction de leurs chances de succès. Mais ce travail de sélection n'est-il pas une façon d'entériner les lois et réglements en vigueur ? Ne revient-il pas à cautionner l'arbitraire de pratiques administratives encore plus rigoureuses ? Ne contribue-t-il pas à tracer cette fameuse ligne dont parle Weisberg qui permet d'en sauver quelques uns en se résignant au sacrifice des autres dont la demande n'est pourtant pas moins légitime au regard des principes et des critères auxquels soi-même on adhère ? Renoncer à la tentation de vouloir sauver à tout prix quelques individus, ne serait-ce pas en définitive la meilleure façon de faire apparaître en pleine lumière l'inhumanité de la loi et d'obtenir un jour - qui sait - sa révision ?
Il faut bien sûr d'abord revenir sur le fameux texte de Joseph Haennig, objet de controverse, qui conclut son étude en déclarant que l'analyse de la jurisprudence allemande indique la voie dans laquelle les tribunaux français "peuvent s'engager sans risque de déformer la pensée du législateur et en conformité avec les principes qui régissent les législation et jurisprudence raciales". Dans un précédent texte il faisait de même remarquer que "lorsqu'il y a lieu de procéder à l'interprétation d'une disposition de la loi française en matière raciale, il est tout de même permis de penser que le recours à la législation et à la jurisprudence allemande n'est pas sans intérêt pour celui qui cherche à voir clair dans un texte un peu obscur"[26]. Certes, Joseph Haennig ne fait pas l'éloge de la jurisprudence allemande en général : comme le relève Richard Posner, il se borne à approuver la décision juridictionnelle qui a sauvé une femme demi-juive des chambres à gaz et dont les tribunaux français pourraient à leur tour s'inspirer[27]. Il n'en demeure pas moins que l'existence d'une législation "raciale" française ne suscite pas la moindre réticence chez l'auteur, et que la méthode proposée n'a d'autre objectif que de rester fidèle à la véritable intention du législateur français, dont on postule qu'il n'a lui-même pas pu vouloir autre chose que le législateur allemand !
De même, dans l'étude citée plus haut sur l'aryanisation des entreprises, pour parvenir à la conclusion que les tribunaux judiciaires sont bien compétents pour contrôler les mesures de dessaisissement des Juifs et la liquidation de leurs biens, l'auteur trace un parallèle avec la faillite dans des termes qu'on a du mal à ne pas trouver ambigus : à l'instar de la loi sur la faillite qui, dit-il, en permettant l'élimination des commerçants qui alourdissent l'économie nationale, fait oeuvre de salubrité économique, la loi du 22 juillet 1941 "se méfie de la prospérité des juifs et ordonne leur exécution, parce que cette prospérité même tend à rompre à leur profit trop exclusif l'équilibre économique. Les deux institutions ont donc le même fondement ; elles ont la même nature"[28].
Bien qu'il émane cette fois d'un magistrat, on peut encore citer, tant il est symptomatique des contradictions relevées ici, le raisonnement utilisé par le rapporteur devant le tribunal civil de Rabat pour décider - finalement - qu'un individu issu d'un parent juif et d'un parent non juif et ayant épousé une femme non juive n'est pas juif : "[Pour qu'il soit considéré comme juif], il faut que cet individu hybride prouve par son appartenance à la religion judaïque qu'il a conservé, malgré une origine mixte, un attachement tout spécial à la race juive. S'il n'est pas de confession juive les quelques liens ancestraux qui le rattachent encore à la race juive s'évanouissent devant ceux qui l'attachent désormais à la race aryenne, liens ancestraux égaux et lien conjugal [...]. Cet individu est dégagé de toute servitude raciale juive"[29].
Parmi les auteurs qui ont pris la plume pour commenter les lois et les décisions de justice, tous n'étaient sans doute pas dans la même disposition d'esprit vis-à-vis de la politique antisémite de Vichy. Les raisons pour lesquelles ils ont pris la plume étaient elles-mêmes vraisemblablement très diverses, encore qu'on peut penser que la plupart l'ont fait machinalement, sans s'interroger sur les retombées de leurs écrits, encore moins sur leur éventuelle responsabilité, estimant se livrer simplement, comme on l'a dit, au travail normal d'un juriste. Certains ont-ils rédigé leurs textes avec la volonté délibérée de venir en aide aux Juifs exclus et dépossédés ? Rien ne permet de l'affirmer, ni d'ailleurs de l'infirmer. Mais, même s'il en était ainsi, il nous semble avoir montré que l'utilité immédiate de leurs analyses, à la supposer établie, ne pouvait en contrebalancer les retombées négatives.
Rappelons que, selon Michel Troper, seule la première attitude est authentiquement positiviste : en effet, dans les autres cas, les auteurs n'auraient été que des pseudo-positivistes, soit parce qu'ils concevaient leur activité comme prescriptrice, en produisant des arguments destinés à persuader le juge et en agissant de sententia ferenda, soit parce qu'ils faisaient intervenir dans leur description du droit en vigueur des considérations extra-juridiques[31]. Nous reviendrons plus loin sur cette remarque qui renvoie à la question de la neutralité de la science du droit.
Un exemple caractéristique de la première attitude est fourni par le commentaire de la loi du 14 septembre 1941 sur le statut des fonctionnaires dû à la plume de Marcel Martin[32]. Sur seize pages, la question de l'exclusion des Juifs et des naturalisés occupe quatre lignes. A propos des "conditions à remplir par le candidat à un service public", et juste après "nationalité française", on lit : "A quoi la loi adjoint toutes les autres conditions posées par des lois spéciales et tenant à la race (juifs et indigènes non citoyens)".
Cette attitude est aux antipodes de celle choisie, sur le même sujet, par Maurice Duverger, à l'évidence plus ambitieuse intellectuellement, qui s'étend longuement sur les motifs de l'exclusion des Juifs et d'autres catégories d'individus de la fonction publique, en reliant la réforme aux principes de la Révolution nationale : le caractère "autoritaire" et "profondément national" du régime expliquerait l'exclusion des naturalisés et des Juifs tandis que son caractère "familial" expliquerait les dispositions restrictives visant les femmes.
Dans leur effort pour expliciter les raisons qui ont provoqué l'intervention du législateur, les auteurs sont fréquemment amenés à reproduire un discours sur les Juifs où l'on retrouve les stéréotypes traditionnels, et qui exprime bien cette sorte d'antisémitisme feutré et "de bon aloi" - par opposition aux attaques virulentes de l'extrême-droite - si répandu avant la guerre dans les milieux conservateurs. Telles ces deux pages qu'André Broc, dans sa thèse sur La qualification juive[33], consacre au sort des Juifs, et dans lesquelles il constate "objectivement", en se fondant sur l'expérience historique, que les Juifs sont inassimilables, pour finalement aboutir au constat qu'"en France, notamment, l'afflux des juifs étrangers et leur propension à jouer dans notre politique intérieure et internationale un rôle inspiré par leurs propres intérêts ont redonné au problème juif dans son ensemble une actualité qu'il avait perdue"[34]. Ou encore, ailleurs, la référence au "génie commercial légendaire" des juifs, qui a fait qu'"avec le temps leurs placements en biens fonds [sont] devenus très importants", de sorte qu'une série de lois récentes ont dû intervenir pour "enrayer ce mouvement"[35].
D'une façon générale, les auteurs ont volontiers tendance à se réfugier derrière le discours officiel ; mais la forme sous laquelle ils en reproduisent les arguments révèle selon les cas une adhésion ou une distance plus ou moins marquée par rapport à ces thèses[36]. La plupart du temps ils semblent se couler sans effort dans le système de pensée du législateur et la logique antisémite qui le sous-tend, utilisant sans même recourir aux guillemets des expressions comme celles de "race juive", "race aryenne", "métis juif", "aryanisation des entreprises"... ou reprenant plus ou moins ouvertement à leur compte les motifs invoqués pour justifier les mesures antisémites.
Ainsi, dans un ouvrage dû à la plume d'un commissaire de police chargé de cours à la Faculté de droit de Lyon et de Joannès Ambre, avocat, la "question juive" est évoquée en des termes dont la prudence et l'ambiguïté apparentes ne parviennent pas à masquer l'adhésion des auteurs à la politique suivie : "Question éternelle [...], la question juive demeure et demeure entière. Aussi bien est-il vain, comme souvent on a tendu à le faire, d'en nier désespérément l'existence". Et plus loin : "Nous ne reviendrons pas sur les griefs trop connus imputés à tort ou à raison aux juifs. On les a souvent et "grosso modo" ramenés à deux points essentiels : 1. présence de trop nombreux juifs aux leviers de commande ; 2. absence de réaction véritablement nationale, ou pour reprendre le mot fameux évoqué plus haut, "absence de terre française à la semelle des souliers". Cet élément mal assimilé (et nous ne perdons pas de vue les exceptions confirmant cette règle), la Nation aura évidemment tendance, surtout dans les périodes de crise, à le neutraliser, sinon à l'expulser"[37].
Georges Burdeau, dans son Cours de droit constitutionnel édité en 1942 puis réédité en 1943, ne s'embarrasse même pas de ces quelques précautions rhétoriques lorsqu'il écrit que dans la perspective du redressement de l'esprit public, "il faut d'abord éliminer ou mettre hors d'état de nuire les éléments étrangers ou douteux qui s'étaient introduits dans la communauté nationale", et plus loin que le statut des juifs, en particulier, "est inspiré par cette constatation de fait [souligné par nous] qu'étant donné ses caractères ethniques, ses réactions, le juif est inassimilable"[38] .
Il arrive toutefois, à l'inverse, que les auteurs fassent preuve d'une prudence dans la formulation qui marque la volonté de conserver une certaine distance par rapport à l'énoncé des thèses officielles et de ne pas prendre parti sur leur bien-fondé. L'usage du pronom indéfini "on" et de la forme impersonnelle, en particulier, permet de maintenir l'ambiguïté sur le point de savoir s'ils reprennent ou non à leur compte les arguments du législateur[39].
Quant aux marques de désapprobation des mesures antisémites, non seulement elles sont rarissimes, mais elles sont souvent si feutrées qu'il faut lire entre les lignes pour les repérer[40].
On trouve parfois, il est vrai, des signes de compassion pour les victimes de la politique antisémite. Ainsi, commentant la décision d'un tribunal de commerce qui avait donné satisfaction au créancier d'une société ayant son siège en Alsace et dont les biens et avoirs s'étaient trouvés bloqués du fait de la législation allemande frappant les sociétés juives, l'annotateur, après avoir critiqué le caractère "anti-juridique" du jugement qui fait selon lui une fausse application du droit positif, et notamment de la législation sur les biens juifs, ajoute en conclusion : "Il est de même inutile de relever combien la solution donnée est contraire à la plus élémentaire équité : alors que différents textes invitent les juges à tenir compte de la position du débiteur et de la situation économique, le tribunal fait totalement abstraction de ce qu'il s'agit d'un réfugié de la zone interdite, privé tant de ses droits dans l'actif de la société en cause que de ses biens personnels, et frappé en outre, à raison de sa qualité de non aryen, d'une série de mesures d'exception. Il suffit que ce réfugié ait pu emporter ou recouvrer quelques sommes et ait pu, au milieu de difficultés sans nombre, exercer quelque activité dans son lieu de repli, pour que le tribunal en conclue que ce débiteur "ne rapporte pas la preuve de son impécuniosité actuelle" et le condamne envers un créancier qui, lui, n'a pas souffert de la guerre, n'a rien perdu, mais dont l'exercice des droits "ne peut être... suspendu ou entravé par les événements actuels". Il est navrant de constater que, dans les circonstances pénibles que nous traversons, il y a encore des individus qui ne songent qu'à défendre jusqu'au dernier centime leurs intérêts égoïstes et des magistrats pour leur donner raison, même au prix d'une violation de la loi"[41].
L'indignation exprimée par l'auteur est suffisamment rare pour qu'on la relève. Pour une fois les conséquences humaines - ou plutôt inhumaines... - des lois antisémites sont directement évoquées, ce qui tranche sur les analyses abstraites et déconnectées du réel dans lesquelles les juristes mettent généralement un point d'honneur à se cantonner. Mais, même dans ce cas, la critique porte plus - conformément à ce qu'on a constaté plus haut - sur l'application de la législation que sur son principe même.
Ou bien encore elle porte sur des questions adjacentes à la législation antisémite. Tel Jean Carbonnier qui approuve le Conseil d'Etat d'avoir annulé un arrêté préfectoral prescrivant aux voyageurs d'indiquer leur religion sur les fiches d'hôtel, car c'était imposer à la très grande majorité des voyageurs un trouble inutile puisqu'il eût suffit de leur poser la question précise : êtes-vous de race juive ? Et qui, obsédé par le souci de défendre la liberté de conscience, juge opportun de rappeller que les auteurs de la loi eux-mêmes ont tenu à affirmer que la nouvelle législation avait une portée purement raciale et ne portait nullement atteinte à la liberté religieuse...[42]. Tel encore Maurice Duverger qui, dans son étude sur les fonctionnaires, émet des réserves sur les mesures adoptées antérieurement à 1940 pour protéger les Français contre la concurrence des étrangers naturalisés.
Comment expliquer une telle anesthésie du sens critique dès qu'il s'agit des Juifs ? Si les auteurs ont été si peu enclins à exprimer leur désaccord avec la législation raciale de Vichy, n'est-ce pas tout simplement que cette législation ne heurtait pas fondamentalement leurs convictions ? L'hypothèse est d'autant moins extravagante que le milieu des juristes n'était pas avant-guerre, que l'on sache, farouchement philosémite... Les propos tenus par le bâtonnier Charpentier, qui n'éprouvait aucun scrupule à affirmer en 1949, donc après la guerre (!), qu'au barreau de Paris il y avait toujours eu un problème juif et que la politique de Vichy coïncidait avec les intérêts professionnels des avocats[43], sont à cet égard éclairants.
Alors que la doctrine a bien du mal, en règle générale, à respecter les principes positivistes dont elle se réclame, passant sans cesse d'un discours de lege lata à un discours de lege ferenda[44], lorsqu'il s'agit de rendre compte des mesures antisémites, les auteurs se retiennent, comme on l'a relevé, de prendre position : ils ne les critiquent pas, ils ne s'en félicitent pas non plus. Comme s'ils sentaient malgré tout confusément que "ces mesures-là" n'étaient pas exactement de la même nature que les autres.
De très nombreux exemples permettent d'illustrer cette attitude de retrait qui trahit aussi un certain embarras. "Il faut [...] se défier de soi-même, noter surtout ce qui est concret, objectif, le plus souvent s'abstenir de juger", énonce prudemment l'auteur d'une étude sur "Le nouveau statut des Juifs en France" dans son entrée en matière, en se réfugiant derrière une citation d'auteurs anciens[45]. "C'est à cette double étude, de pure technique juridique, qu'est consacré le présent essai, à l'exclusion de toute autre considération", précise à son tour l'auteur d'une thèse sur La qualification juive[46] .
On retrouve une tonalité identique dans l'avant-propos d'un ouvrage pratique intitulé La condition publique privée du juif en France : "Le lecteur voudra bien noter que nous avons saisi la plume de l'homme de loi, non la cravache du polémiste. Le Droit n'a que faire des vociférations partisanes, et il nous a paru moins utile de céder à des engouements ou à des répugnances hors de saison que d'analyser avec sérénité et probité les nombreux textes promulgués depuis l'avènement en France du régime nouveau. Des problèmes juridiques multiples, complexes, insolites ont été soulevés par l'élaboration de ce monument législatif qu'est le statut des juifs en voie de perfection constante [sic]. D'autres diront, s'ils en ont le goût et le loisir, si cette oeuvre leur apparaît nécessaire, solide, durable, efficace. Telle qu'elle est, elle existe. Pour notre modeste part, nous avons voulu la connaître, l'étudier minutieusement, la comprendre, et si cette ambition ne risquait d'apparaître excessive, tenter de guider nos contemporains dans l'imbroglio des textes parus".
Même précaution dans une brochure, intitulée Le statut des juifs en France, en Allemagne et en Italie, éditée par Express-Documents, qui précise en introduction que "suivant son programme et sa tradition, Express-Documents s'est attaché dans ce travail à faire oeuvre rigoureusement objective... On ne s'étonnera donc pas de n'y trouver aucune appréciation ni discussion des textes", ou encore dans le "Commentaire des lois, décrets, circulaires et ordonnances parus entre l'armistice et le 20 novembre" dû à la plume de René Floriot : "Le point de vue juridique a été seul pris en considération. La loi est-elle opportune ? Répond-elle à un besoin ? N'aurait-elle pas gagné à être conçue dans un esprit différent ? Autant de questions que nous nous sommes refusé d'aborder, voulant faire uniquement un travail de juriste et non une oeuvre de polémiste"[47].
La volonté de ne pas prendre parti, la prétention à la neutralité et à l'objectivité, même si elles sont démenties au détour d'un mot ou d'une phrase qui trahit les vrais sentiments de celui qui les écrit, sont affichées de façon si ostentatoire qu'il est difficile de ne pas les interpréter comme l'expression du besoin de se justifier - aux yeux des lecteurs ou à ses propres yeux - et, finalement, comme le signe d'un certain malaise. (Même si ce malaise semble se dissiper à mesure que les mois et les années s'écoulent et que l'effet d'accoutumance fait son oeuvre, à en juger par la disparition dans les écrits plus tardifs des périphrases embarrassées qui encombraient ceux du début).
De fait, l'attitude prudente observée face à la législation antisémite contraste avec les prises de position qu'on constate dans d'autres domaines, où les auteurs n'hésitent pas à émettre des jugements de valeur, soit positifs, soit négatifs, sur l'oeuvre juridique du nouveau pouvoir.
Ainsi, la loi qui autorise la légitimation des enfants adultérins, édictée en faveur d'un proche de Pétain en contradiction totale avec la conception traditionnelle de la famille remise à l'honneur par Vichy, est vivement contestée par la doctrine. Paul Coste-Floret intitule une chronique au Dalloz : "Une réforme regrettable : la loi du 14 septembre 1941 sur la légitimation des enfants adultérins". "A l'heure où le législateur a inscrit enfin le nom de la "Famille" parmi les principes fondamentaux de l'Etat, au moment où il s'efforce, en réformant le divorce, de consolider les foyers, on a peine à concevoir l'introduction dans notre droit d'une réforme qui donne à la polygamie... cette consécration légale jugée moralement impossible par l'unanimité de la doctrine. Il est grave de dissocier par un acte souverain la loi positive et la morale sur des points où la loi positive et la morale coïncident"[48]. Une préoccupation éthique que l'on ne voit apparaître dans aucun commentaire concernant la législation antisémite... Même réaction de la part de Paul Esmein qui se dit "surpris de voir cette réforme effectuée par un gouvernement qui annonça le renforcement de l'institution de la famille comme un des thèmes essentiels de son programme" et estime regrettable "que la légitimation des enfants adultérins ait été admise et que l'innocence des enfants excuse rétroactivement les parents, au préjudice de l'institution du mariage"[49].
La loi sur le divorce du 2 avril 1941, qui interdit aux couples de divorcer pendant les trois premières années du mariage, suscite également des réactions marquées, mais d'approbation cette fois, de la part de la doctrine. Si la réforme suscite quelques critiques chez les praticiens, au motif qu'en obligeant les époux à cohabiter pendant trois ans on risque de créer de violents conflits et en définitive, au nom de la morale, de susciter l'immoralité et la misère conjugale[50], la majorité des auteurs saluent cette véritable loi contre le divorce, qui devrait, en rendant le divorce plus difficile, le rendre beaucoup plus rare. "Des hommes éminents, dans tous les secteurs de l'opinion, reconnaissaient le péril que représentait pour la famille et, par delà, pour la nation, la multiplication des divorces. La loi du 2 avril 1941 est le frein que l'on réclamait"[51]. "Nulle réforme ne pourrait être plus importante... Cette loi mérite à notre avis une entière approbation"[52]. "L'intérêt que le législateur du 2 avril 1941 veut sauvegarder est un intérêt national, l'avenir de la race française"[53]. Des critiques sont en revanche formulées à l'encontre des dispositions concrètes de la loi, jugées souvent insuffisantes et techniquement mal préparées[54].
En commentant la législation antisémite, les auteurs auraient donc mieux respecté qu'à leur habitude les postulats de la science du droit positive qui commande de s'abstenir de tout jugement de valeur. Mais cette contrainte de neutralité et d'objectivité que s'est imposée - consciemment ou inconsciemment - la doctrine est précisément, nous semble-t-il, ce qui a permis au discours des juristes de remplir plus efficacement sa fonction de légitimation de la politique antisémite. Telle est en tout cas l'hypothèse que nous formulions et qui nous conduisait à mettre en cause le positivisme lui-même, dans sa prétention à énoncer un discours neutre et objectif. Hypothèse contestée par Michel Troper, pour qui la mise en cause de l'attitude de la doctrine sous Vichy ne saurait conduire à incriminer le positivisme[55].
La controverse ne porte donc à mon sens que sur la conception de la science du droit, et, au-delà, sur la conception que l'on se fait du métier de juriste. Il convient donc, à ce stade, de rappeler la distinction proposée par certains théoriciens du droit entre science du droit et dogmatique juridique ou entre science du droit et doctrine. La science du droit, rappelle Michel Troper, se borne à décrire les normes en vigueur, de sorte que ses propositions peuvent être vérifiées comme vraies ou fausses[58], tandis que la dogmatique cherche à établir quelles sont les normes applicables, qui n'ont par définition pas encore été appliquées, en se livrant à un travail d'évaluation. La science du droit vise exclusivement la connaissance, tandis que la dogmatique - qui est l'activité des juristes praticiens, mais aussi de la doctrine, dans son travail de systématisation - remplit en plus une fonction pratique, une fonction normative, de source complémentaire du droit[59].
La dogmatique, nous dit Michel Troper, dans laquelle est donc inclue la doctrine[60], n'est pas et ne peut prétendre être neutre, car elle recherche une norme qui n'existe pas encore, une norme qui doit être ; il s'agit donc bien d'une activité prescriptive, normative. En France, d'ailleurs, la doctrine revendique d'être une source de droit ; et si elle entend jouer un rôle dans la création du droit, elle ne peut être neutre. En revanche, la science du droit se borne à décrire des normes en vigueur : comme la description dépend seulement de la constation d'un fait empirique - une norme est ou n'est pas en vigueur -, on peut considérer que l'exigence de neutralité axiologique est satisfaite[61].
Mais les juristes ne résistent pas toujours à la tentation de passer subrepticement de la science du droit à la doctrine. Dans la mesure où les concepts juridiques ne sont pas univoques, où les textes ne peuvent prévoir toutes les hypothèses de la vie sociale et ne sont pas cohérents entre eux, il est inévitable que les opérations de définition, de classification, de systématisation, entraînent des prises de parti, et que l'auteur soit amené à indiquer des préférences et argumenter en ce sens. La doctrine a ainsi pour particularité de passer sans cesse d'un discours de lege lata à un discours de lege ferenda et d'abolir ainsi la distinction positiviste entre droit et science du droit [62].
A partir de ces prémisses, Michel Troper réplique à la mise en cause du positivisme sous Vichy que si les auteurs ont contribué à légitimer l'antisémitisme, ce n'est pas parce qu'ils ont décrit le droit en vigueur - car "rien n'empêche [...] de décrire de manière neutre et objective un certain droit positif que par ailleurs on réprouve et on combat" - mais parce qu'ils ont voulu énoncer les valeurs qui justifiaient les textes[63]. Le tort qu'a eu la doctrine, dit encore Michel Troper, c'est de ne s'être pas bornée à décrire les règles, mais d'avoir voulu comprendre ou expliquer le fond du droit et rechercher comment les règles pouvaient s'appliquer à des situations non explicitement prévues en éliminant les lacunes et les contradictions de la législation. En s'efforçant de mettre en lumière la ratio legis qui permettait d'interpréter la loi et d'en inférer une norme particulière applicable à tel ou tel cas d'espèce, les auteurs ont conçu leur activité comme prescriptrice, or une doctrine prescriptrice n'est pas positiviste et se situe même à l'opposé du positivisme [64].
Il est vrai qu'en rappelant les buts poursuivis par le législateur, même si on le fait dans un langage neutre, même si on s'entoure du maximum de précautions rhétoriques visant à mettre une distance entre le locuteur et les opinions rapportées, on leur confère inévitablement une sorte de respectabilité. Mais, contrairement à Michel Troper, je pense que la description du droit en vigueur, dès l'instant où elle s'aventure au-delà du simple constat selon lequel "les juifs ne peuvent plus accéder à la fonction publique", ou "les juifs sont exclus de telle ou telle profession", fait aussi problème, précisément parce que cette énonciation neutre du contenu du droit positif semble indiquer que ce contenu ne fait pas problème. La solution, à mon sens, ne réside donc pas dans une barrière qu'on tracerait entre la description pure d'une part, l'explication ou interprétation d'autre part.
En second lieu, l'idée qu'une science du droit serait neutre dès l'instant où elle décrit le droit tel qu'il est, sans faire interférer ses propres préférences ou valeurs morales avec cette description[65], n'est pas aussi évidente qu'il y paraît. Outre qu'elle postule une rupture radicale entre l'univers de la science et celui de l'idéologie qui est de plus en plus contestée par l'épistémologie contemporaine, y compris dans le domaine des sciences exactes, la prétention de construire une science du droit neutre et objective pourrait bien reposer sur une fausse conception de la neutralité et de l'objectivité.
D'une façon générale, l'objectivité suppose une distance entre le sujet qui étudie et l'objet qu'il étudie. Or cette distance n'existe pas réellement dans les sciences humaines, et l'objectivité y est d'autant plus difficile à atteindre que l'observateur est engagé dans la réalité qu'il étudie, qu'il attribue des valeurs aux faits qui l'intéressent, qu'il est porté à croire les connaître intuitivement.
S'agissant plus précisément de la science du droit, l'objectivité et la neutralité sont présumées atteintes lorsque le juriste énonce les normes dans les termes mêmes où les a énoncées le législateur - ou éventuellement le juge. La conception de l'objectivité développée par la science du droit repose sur l'idée qu'on peut séparer rigoureusement les faits et les valeurs et que, par conséquent, plus on "collera" aux faits - ici, aux normes -, plus on aura de chances d'atteindre l'idéal d'objectivité. Mais c'est oublier que le droit n'est pas neutre, que lui-même véhicule des valeurs, reflète des présupposés : en prenant le législateur au mot, en décrivant le contenu des normes en vigueur dans les termes mêmes où il les a énoncées, la science du droit, sous couvert de respecter le postulat de neutralité, contribue à diffuser les valeurs sous-jacentes à la législation en vigueur et à renforcer la croyance en leur légitimité.
La description strictement positiviste des règles, notions et institutions juridiques ne revient-elle pas en fin de compte à épouser étroitement le point de vue des acteurs mêmes de la vie juridique, en contradiction avec l'objectif que s'assigne la science du droit qui prétend faire prévaloir un point de vue externe sur le droit, distinct du point de vue interne qui est celui des acteurs ? En contradiction également avec les exigences de l'objectivité scientifique qui ne peut s'acquérir qu'au prix d'une rupture épistémologique avec les représentations véhiculées par les pratiques sociales - et le droit est l'une de ces pratiques. Faut-il rappeler que la science, selon le mot de Bachelard, ne correspond pas à un monde à décrire, mais qu'elle correspond à un monde à construire ?
Enfin, on ne peut ignorer que toute science - y compris cette science du droit prétendument neutre - produit des effets sociaux : nous avons ainsi longuement montré comment le commentaire "positiviste" de la législation et de la jurisprudence avait contribué à la banalisation du droit antisémite et à la légitimation de l'antisémitisme, et cela alors même que les auteurs avaient pris soin de ne pas y mêler leurs propres jugements de valeur. Michel Troper dénie la pertinence de cette remarque, qui revient selon lui à confondre la question des effets sociaux d'un discours et sa nature intrinsèque[66]. Aucun discours, même s'il relève de la conception la plus rigoureuse de la science, dit-il, n'est jamais neutre à ce point de vue, c'est à dire si l'on considère l'interprétation qu'on peut en donner et l'usage qu'on peut en faire. Il faut donc s'en tenir à une autre conception de la neutralité : un discours neutre est celui qui ne comporte pas de prescription ni de jugement de valeur.
L'objection ne me convainc pas : d'abord, parce qu'elle attribue à la science du droit un rôle décidément peu enthousiasmant ; ensuite, parce que, même en se cantonnant dans la pure description de la législation antisémite, les juristes ont, d'une certaine façon, participé à sa légitimation (j'ai déjà évoqué ces deux points plus hauts) ; enfin, parce qu'on ne peut pas évacuer si facilement la question des effets sociaux de la science, qui engage la responsabilité des scientifiques - ou, ici, des juristes -, et dont ils ne peuvent se désintéresser.
Ce qui amène, pour conclure, à s'interroger justement sur cette responsabilité propre des juristes. Le juriste peut-il, doit-il se cantonner dans une position d'observateur en apparence neutre et impartial face à un droit qui lui répugne moralement (nous supposerons pour les besoins de la démonstration que la législation antisémite répugnait effectivement à une partie au moins des auteurs que nous avons cités) ?
Si le juriste ne fait pas le travail de dénonciation, fondé sur une analyse serrée des textes, qu'il est souvent seul à pouvoir faire, qui le fera ? Il nous faut méditer le cri d'alarme que poussait Henri Dupeyroux en 1938[67] à la lumière des événements qui se déroulaient en Allemagne :
"La règle, rien que la règle, rien que le commentaire de la règle ! Que sombrent les régimes politiques, qu'une dictature emporte le parlementarisme ou que la loi de la majorité se substitue à la volonté d'un seul [...], le positiviste-juridique commente toujours, en principe avec une impassible tranquillité, parfois aussi avec le plus contagieux enthousiasme, la volonté changeante des maîtres du jour. Ils sont juristes, disent-ils, et, comme tels, ils font exclusivement du droit. [...] Ils en sont arrivés à construire à leur usage un droit qui n'emprunte plus rien à la morale ou à l'histoire, à la métaphysique ou à la sociologie, un droit qui vit sur son propre fonds, de ses seules ressources. [...] Ce n'est qu'une question d'agencement de règles vides et de formules. [...] On bannira rigoureusement, comme juridiquement impure [...], la notion de justice, idéal éternel et pain quotidien des sociétés humaines. A la seule condition d'un tel sacrifice, on pourra prononcer les mots de "science", de "savant" ou encore, c'est celui que l'on affectionne le plus, de "scientifique"... En deux mots, c'est au pur et simple commentaire de la loi que l'on condamne le juriste. [...] En admettant (ce que l'on affirme gratuitement) que cette tâche [l'exégèse des textes] constitue la substance même de son rôle, le juriste n'en est pas moins un homme, et il est naturel à l'homme de se hausser, quel que soit son état, à des considérations supérieures, et tout au moins à la considération de son état. Si l'homme est un être pensant, il n'est rien de plus normal que d'accepter qu'il pense sur son activité ordinaire".
Je persiste pour ma part à penser qu'une science du droit qui se cantonnerait dans la simple description du droit en vigueur ne mériterait pas qu'on lui consacre un instant de peine. La science du droit ne peut prétendre à ce titre que si elle se donne les moyens d'expliquer les phénomènes juridiques en les rapportant à d'autres faits ou discours sociaux, si elle accepte de faire prévaloir sur son objet un point de vue critique - critique voulant dire ici qui s'efforce de mettre en lumière ce qui n'est pas immédiatement perceptible ou visible [68]. Pour revenir à la doctrine sous Vichy, je ne pense pas que son tort ait été d'aller au-delà de la description du droit antisémite : encore une fois, dans une telle situation, décrire les règles c'était déjà admettre qu'elles étaient des règles comme les autres
Qu'on m'entende bien : je ne plaide pas pour le mélange des genres. Il est facile d'objecter que prendre parti, c'est tuer la science, et je sais tout ce que la rigueur juridique a à perdre d'y voir mêler sans cesse des jugements de valeur. Il faut savoir distinguer, dans sa propre pratique, ce qui relève respectivement du rôle du juriste, du rôle de l'intellectuel, du rôle du citoyen. Il faut être capable de dire clairement, lorsqu'on s'exprime, "d'où l'on parle", ne pas cultiver la confusion. Mais, pour autant, le juriste ne doit pas ignorer qu'il est aussi un intellectuel et un citoyen, et qu'il a à cet égard des responsabilités.
Si c'est la crainte de sortir de leur rôle de juristes qui a retenu les auteurs de prendre parti face à la législation antisémite - mais si cette hypothèse est exacte, il resterait à expliquer pourquoi, sur d'autres sujets, ils n'ont pas hésité à prendre parti -, je pense décidément qu'il eût mieux valu adopter la stratégie du silence. Car analyser la législation antisémite, argumenter, raisonner à l'aide des concepts imposés par cette législation, c'était renforcer la crédibilité de cette législation antisémite et redoubler l'effet de naturalisation par lequel le droit contribue à déterminer la sphère d'acceptabilité des actes et des conduites en faisant apparaître comme naturel ce qui n'est au départ que légal.
D'autant que sur cet effet de naturalisation est venu se greffer un effet d'accoutumance. L'utilisation de la terminologie antisémite et le maniement des concepts racistes ne sont pas innocents : on s'habitue d'abord aux mots, puis aux représentations qu'ils véhiculent, et on finit par trouver normales les pratiques sur lesquelles ils débouchent. Jean-Pierre Faye a bien montré qu'il existait un pouvoir propre des mots, qui définissent le champ de possibilité des discours et des actions et, au-delà, leur acceptabilité. Parce que les mots permettent de nommer les choses, ce qui sans le secours des mots était inconcevable devient concevable, puis acceptable, et finit parfois par se concrétiser : telle l'extermination des Juifs, que l'expression "solution finale" a fait entrer dans le champ du dicible, donc du possible, puis de l'acceptable[69].
Toutes proportions gardées, nous ne sommes pas aujourd'hui à l'abri des mêmes dérives. Dans le champ de l'immigration, nous assistons, impuissants, à l'enclenchement d'un processus où le droit, le discours et les pratiques conjuguent leurs effets et se légitiment mutuellement pour aboutir à une situation où plus rien ne suscite l'indignation. Sous couvert d'un objectif progressivement érigé en dogme : stopper l'immigration, l'étranger en situation irrégulière n'est plus considéré que comme un délinquant qui doit être puni, un "clandestin" qui doit être pourchassé. Tout ce qui naguère encore eût paru inacceptable finit dès lors par paraître naturel, normal, inévitable : normale, la mise en état de siège de certains quartiers pour effectuer des contrôles d'identité ; normales, les visites domiciliaires pour débusquer ceux qui se cachent ; normal, le refoulement des demandeurs d'asile puisque parmi eux se dissimulent de faux réfugiés ; normale, la dénégation du droit aux soins pour ceux qui ne respectent pas nos lois ; normal encore, le refus d'inscrire leurs enfants dans nos écoles ; inévitable, la séparation des familles... Normale, enfin, la délation, qu'on verra bientôt, si nous ne réagissons pas, érigée en acte civique au motif qu'on ne peut pas, dans un Etat de droit, laisser la délinquance impunie.
L'expérience de Vichy ne devrait-elle pas, pourtant, nous servir sur ce point de leçon ?
____________________________
Server / Server
© Michel Fingerhut 1996-2001 - document mis à jour le 19/02/1999 à 13h14m14s.
Pour écrire au serveur (PAS à l'auteur)/To write to the server (NOT to the author): MESSAGE