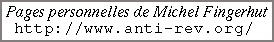

Si l'on définit la mémoire comme la « présence du passé » au sein de notre société, il saute aux yeux que, cinquante ans après, le souvenir du Génocide n'a jamais été aussi présent. De l'inauguration de plaques sur les lieux d'internement ou de départ pour la déportation à la publication de témoignages, de la collecte de témoignages, de récits de survivants au moyen de la vidéo aux émissions de télévision, en passant par les avis d'anniversaire de décès dans la presse ou la célébration, depuis le décret présidentiel du 2 février 1993 instituant une « Journée commémorant les persécutions racistes et antisémites commises sous l'autorité de fait dite gouvernement de l'État français (1940-1944) », il n'est de jour où, sous une forme ou autre, le souvenir des morts ne soit, en France, rappelé. L'image des relations complexes qu'Israël entretient avec la Shoah illustre, elle aussi, à quel point cet événement demeure, selon le mot de l'historien allemand Ernst Nolte, « du passé qui ne veut pas passer ». Israël et la France ne constituent pas dans ce domaine des exceptions. La mémoire du Génocide se développe de façon pratiquement identique aux États-Unis où existe depuis avril 1993, à Washington, l'impressionnant Mémorial national de l'Holocauste. Depuis la chute du communisme, dans les pays anciennement socialistes, de nouveaux centres voient le jour. Comme à Moscou où a été fondé en 1991 « le centre pour la recherche et l'éducation sur l'Holocauste ».
Car -- et il s'agit là d'un phénomène inédit -- il semble bien que les sociétés juives, celles de la diaspora comme celle d'Israël, ne parviennent pas à accomplir le deuil des victimes de la Shoah. C'est cette commune présence du passé qui nous autorise à mener une comparaison (des limites de laquelle nous sommes conscients) entre l'histoire de la mémoire en France, où les Juifs sont minoritaires, et en Israël, où elle a partie liée avec l'État. En effet, en France comme en Israël, plus les années passent, plus le souvenir paraît présent. Il n'en va pas ainsi de tous les traumatismes publics, loin s'en faut. Pour ce qui est du cas israélien, par exemple, l'élaboration de la mémoire collective s'appliquant à des traumatismes publics « classiques » (guerre d'Indépendance, bouleversements économiques, etc.) semble, comme en France, suivre les étapes traditionnelles du deuil. Un excellent terme de comparaison est fourni par le processus de mémoire de la très meurtrière guerre d'Indépendance, analysé par Emmanuel Sivan dans son livre La Génération de 1948, mythe, portrait, mémoire, et dans une livraison récente de la revue Pardès. En 1948, le Yishuv (c'est-à-dire les Juifs installés en Palestine avant la fondation de l'État1) perd 1% de sa population (5 800 victimes), et, dans la classe d'âge la plus touchée (la population masculine, de dix-neuf à vingt et un ans), ces pertes s'élèvent à 8 %. Bien que ces pertes en vies humaines fassent de cette guerre le conflit le plus meurtrier des affrontements israélo-arabes, le processus de deuil (choc initial, isolement volontaire, enfin retour à la vie normale) semble grosso modo fonctionner.
Mémoire de plus en plus présente, donc, et mémoire qui ne l'a pas toujours été de façon aussi obsédante dans les sociétés. La mémoire du Génocide a son histoire, ses rythmes spécifiques. Elle ne connaît pas -- c'est une de ses originalités -- de frontières: elle est transnationale et s'inscrit dans la même chronologie d'un pays à l'autre, pourvu que ce pays soit une démocratie, et pourvu qu'y vive une population juive. Une chronologie qui, comme pour les phénomènes culturels, n'est pas linéaire, connaît des temps de maturation et ne peut se laisser enfermer dans des cadres temporels rigides.
La mémoire -- le sociologue Maurice Halbwachs2, pionnier en la matière, l'a montré -- est un phénomène social, qui s'inscrit dans des cadres sociaux: famille, associations, État. Elle a ses lieux du souvenir: les plaques, les stèles, les mémoriaux où se déroulent des cérémonies, mais aussi les livres ou les films. C'est la façon dont cette mémoire s'est construite, dans ses moutures française et israélienne3 essentiellement, que nous nous attacherons à décrire.
Une première période s'ouvre dès la Seconde Guerre mondiale et se clôt avec l'enlèvement d'Eichmann. En Israël surtout, la périodisation de l'histoire de la mémoire tourne autour d'un axe: le procès Eichmann. C'est ce procès qui enclenche le processus d'identification aux victimes (et non plus seulement aux révoltés des ghettos ou aux résistants). Ce processus avait jusque-là été freiné par un certain sentiment de culpabilité lié à l'impossibilité d'agir dans laquelle le Yishuv, communauté sous tutelle, asservie au Livre blanc imposé par la puissance britannique mandataire, s'est trouvé pendant la guerre. Elle renvoit par ailleurs à une image très forte dans le mouvement sioniste de la diaspora comme antitype de l'idéal sioniste du « Juif nouveau ».
De cette première période, on peut dire globalement que, si le souvenir du Génocide est présent, il reste confiné dans des groupes sociaux, ceux des survivants, extrêmement étroits en France, infiniment plus larges en Israël. Ou bien il surgit de façon épisodique lors d'« affaires », comme en France avec l'affaire des enfants Finaly ou en Israël avec l'affaire Kastner4.
La nécessité de conserver la trace du Génocide apparaît très tôt, pendant la Seconde Guerre mondiale. Certains ont immédiatement pensé que leur présent deviendrait passé, et qu'un futur, qu'il ne leur serait probablement pas donné de vivre, devrait garder le souvenir de l'annihilation.
En Pologne, d'abord, où la persécution des Juifs commence avec l'occupation allemande, dès septembre 1939, les Juifs sont très vite enfermés dans des ghettos où ils périssent en masse de faim et d'épidémies. Avant même leur mise à mort par les Einsatzgruppen, les groupes mobiles de tuerie, à l'été 1941, avant les gazages systématiques qui commencent à Chelmno en décembre de la même année, les Juifs ont le sentiment que la persécution peut être fatale aux 3 250 000 de ceux qui peuplent la Pologne. Une de leurs réactions à la mort qui rôde est d'écrire, pour que les générations suivantes connaissent leur martyre. Beaucoup de textes ont survécu à leurs auteurs5, comme les journaux de Chaim Kaplan6, d'Abraham Lewin7 ou du président de Conseil juif de Varsovie, Adam Czerniakow8. Pourtant, le projet le plus vaste, le plus original est sans conteste celui d'Emmanuel Ringelblum. Enseignant, militant sioniste, Emmanuel Ringelblum était aussi un historien confirmé. Avec l'entrée des Allemands à Varsovie, il rédige sa propre chronique9, puis constitue des équipes chargées de rassembler tout ce qui concerne le ghetto. C'est l'Oneg Shabbat, l'« Allégresse du Shabbat », nom qu'il donne à ces archives et à cette organisation de résistance d'un type spécial. Très tôt conscient de la volonté exterminatrice des Allemands, Ringelblum fait de ses notes à la fois un acte historique pur et un acte de mémoire puisqu'il s'y adresse à la postérité. Placés dans des bidons de lait, que Ringelblum confie à la terre, deux des trois lots d'archives sont retrouvés, en 1946 et en 1950. Ils contiennent des matériaux précieux sans lesquels il eût été impossible d'écrire l'histoire du ghetto: presse clandestine dans sa quasi-totalité, correspondances et matériaux des organisations politiques, documentation sur l'Organisation juive de combat.
Le 28 avril 1943, rue Bizanet, à Grenoble, alors occupé par les Italiens, est créé le Centre de documentation juive contemporaine. L'initiateur en est Isaac Schneersohn. Immigré de Russie, militant communautaire, il s'était lancé avec succès dans les affaires mais les usines du groupe dont il était le P-DG avaient été aryanisées. Dès 1942, il sillonne la Zone libre pour prendre des contacts afin de créer un centre de documentation. Hormis quelques témoignages, nous ne possédons aucun renseignement sur ses motivations réelles et sur les fonctions qu'il assignait à ce centre. S'agissait-il, comme le suggère Raymond-Raoul Lambert10 et comme le laisse à penser sa composition -- une quarantaine de personnes responsables de diverses organisations juives --, de préparer un nouvel organisme communautaire pour l'après-guerre? Était-il question de rassembler une documentation pour récupérer les biens juifs « aryanisés », comme le pense Léon Poliakov, employé rue Bizanet11 sous l'Occupation et, par la suite, un des chercheurs du CDJC au cours des premières années de son existence ? S'agissait-il de « consigner ce qui se passait12 » pour porter témoignage de la persécution, comme l'écrit Schneersohn dans le texte qu'il rédige pour le dixième anniversaire de la fondation du CDJC13 ? Il est bien difficile de trancher avec certitude. Il n'empêche que, même si les origines ont été mythifiées, c'est bien également pendant l'Occupation qu'est créé le premier lieu français d'histoire et de mémoire du Génocide.
L'idée d'édifier un mémorial aux victimes de la Shoah, en Israël, naît, elle aussi, en même temps que l'événement. Elle a pour initiateur, en 1942, un certain Mordechaï Shenhaby, membre, il faut le noter, du mouvement sioniste de gauche Hashomer Hatzaïr. Celui-ci propose la création d'un « Jardin du peuple » de plusieurs hectares, destiné à l'origine à être planté dans une région agricole -- ce qui est conforme à l'idéal sioniste et pionnier du temps -- puis sur Har ha-Tzofim, le site actuel de l'Université hébraïque de Jérusalem. « Il nous faut intégrer le souvenir de la plus grande catastrophe du siècle au projet sioniste » dit-il. Son idée était de bâtir côte à côte un sanctuaire pour les victimes (avec leurs noms) et un sanctuaire pour les combattants. Avec le temps, espérait-il, le nombre des visiteurs du sanctuaire dédié aux victimes irait en diminuant tandis que le nombre des pèlerins venus pour rendre hommage aux combattants s'accroîtrait14.
Les réserves à ce projet sont de deux ordres. Tout d'abord le caractère exclusivement laïc de l'entreprise ne peut satisfaire les religieux (c'est ainsi qu'en septembre 1946 le service des pompes funèbres du grand rabbin invite les membres de l'exécutif de l'Agence juive à honorer de leur présence à Tel-Aviv l'enterrement des cendres provenant du camp de Chelmno). Un député de l'Agudat Israël (l'un des parti orthodoxes et asionistes) propose lors du débat à la Knesset la création d'un « lieu saint » pour l'étude des textes religieux. Quant aux sionistes laïcs, comme Eliahu Eilat, ils craignent qu'un tel monument ne soit pas conforme avec l'optimisme fondamental du mouvement sioniste15.
Si en Pologne, sur les lieux mêmes de la destruction, la prise de conscience qu'un processus d'annihilation systématique des Juifs est en cours est immédiate, il n'en est pas de même ailleurs dans le monde. De ce qu'a été le sort des déportés de France, de l'ampleur de l'annihilation des Juifs de l'Est, le monde ne prend la mesure qu'avec l'ouverture des camps. Certes, des informations ont filtré. Dans le Yishuv, notamment, la presse rend compte avec une relative précision du Génocide à l'est de l'Europe16. Pourtant, les sociétés, que ce soit en France ou en Palestine, ne sont guère prêtes à entendre, ni à intégrer ce qui se passe sur « l'autre planète », comme l'auteur d'un des tout premiers récits, Ka-tzetnik, désignera Auschwitz17.
Quelques données chiffrées, avant de comparer le cas de la France et celui d'Israël, nous permettent de prendre la mesure des évidentes dissemblances. 75 000 Juifs sont déportés depuis la France. 2 500 d'entre eux retrouvent ce pays au printemps 1945. Chiffre dérisoire au regard du nombre de Juifs vivant alors dans l'Hexagone (peut-être 250 000), de la population globale française (une quarantaine de millions), et même des 40 000 déportés, 80 fois plus nombreux que les Juifs, rentrant des « camps ordinaires » (expression utilisée par une ancienne de Ravensbrück, Micheline Maurel). Dans les années qui suivent la guerre, la mémoire de la déportation est largement dominée en France par celle des déportés de la Résistance18.
Les quelques données chiffrées qui concernent Israël sont d'un tout autre ordre. Pendant la guerre, le Yishuv compte 450 000 âmes environ. Il faut inclure à ce chiffre 50 000 à 60 000 yekkes (réfugiés venus d'Allemagne et d'Autriche) arrivés en Palestine avant le déclenchement du conflit et qui, d'une manière ou d'une autre, ont déjà eu un contact sinon avec la Shoah, du moins avec l'antisémitisme nazi. Pendant le conflit lui-même, quelques dizaines de milliers de réfugiés réussissent à fuir l'Europe occupée et à rejoindre le Yishuv. Dans la seconde moitié de l'année 1945, 90 000 réfugiés d'Europe -- qu'on appelle sheerit hapléta (« les survivants », cf. II Rois, 19-31) -- parviennent en Palestine, souvent après un impressionnant périple, encadrés par les envoyés du mouvement sioniste à travers l'Europe en ruine (la Briha). Au cours des trois années qui suivent s'ajoutent plus de 60 000 immigrants, clandestins ou non. Lors de la première année d'existence de l'État, 200 000 rescapés viennent encore grossir les rangs du Yishuv dont la population double en un an. A la fin de 1949, on estime qu'un Israélien sur trois est un survivant de la Shoah (350 000 personnes environ)19.
Proportionnellement, on le voit, ce chiffre est sans commune mesure avec celui des rescapés de France ou des États-Unis. En outre, ces survivants sont destinés à évoluer dans un monde exclusivement juif. Même si beaucoup de ces rescapés repartent au cours des années 50, ce qu'évoque le film de Guilah Almagor L'Été d'Avia (un des meilleurs documents-fictions sur les relations ambiguës entre Israéliens et survivants de la Shoah dans les années 50), une telle proportion de survivants dans la toute nouvelle vie nationale fait, à coup sûr, d'Israël un cas à part.
Aussi étrange que cela puisse paraître, pourtant, à la lumière de ces chiffres, l'accueil de ces survivants n'est pas sensiblement différent en France et en Israël. Comme les rescapés français, les rescapés nouveaux-israéliens reviennent des camps pleins de récits et, comme en France, ils ne tardent pas à constater qu'« une barrière de sang et de silence » les sépare de leurs compatriotes. Les mêmes mots se retrouvent dans la bouche de la Française Simone Veil et dans celle de l'Israélienne Myriam Weinfeld. Elles ont à peu près le même âge, ont toutes les deux vu, à Bergen-Belsen, sous leurs yeux, mourir leur mère si près de la Libération. La première raconte:
« J'ai toujours été disposée à en parler, à témoigner. Mais personne n'avait envie de nous entendre. {...} Cette incompréhension, ces difficultés, nous les retrouvons en famille. Peut-être même surtout dans nos familles, c'est le silence. Un véritable mur entre ceux qui ont été déportés et les autres20. »
Quant à la seconde, installée au kibboutz Degania Bet, « elle aurait souhaité qu'on la questionne sur son histoire, c'était la seule façon qu'elle avait de tisser un lien quelconque avec son nouveau pays. Mais on ne lui posa aucune question21 ».
Dans le cas israélien, l'irruption massive des réfugiés venus d'Europe est
venue faire imploser l'image de soi valorisée, l'utopie de l'Hébreu, de
« l'homme nouveau » que se flattaient de faire naître en Palestine
les idéologues du sionisme (qu'ils fussent « cananéens » --
c'est-à-dire comme le poète Ratosh, l'historien Gourevitch-Horon et plus tard,
avant leur évolution vers l'extrême gauche, Ouri Avneri et Amos Kenan22 --
ou qu'ils fussent attachés à l'idéologie pionnière nationaliste et marxisante
des partis de gauche). Alors que l'idéologue du parti travailliste, Berl
Katznelson, qualifiait d'ores et déjà les Sabras de « tribu
différente », les survivants ne viennent-ils pas offrir à une société
ultrapolitisée l'image de la souffrance juive diasporique avec laquelle ils
avaient voulu rompre ? Ce choc mêlé à un certain sentiment de culpabilité
explique que silence et malaise entourent les rescapés. Tom Segev résume ainsi
la situation qui prévaut à la fin des années 40 et 5023
« Pour beaucoup de rescapés, raconter leur histoire représentait un devoir patriotique {...}. Ils se sentaient investis de l'obligation morale et historique de préserver le souvenir des disparus. Ils exprimaient par là également leur immense besoin de partager cet écrasant fardeau émotionnel. Mais ils découvraient que les autres ne voulaient pas ou ne pouvaient pas les écouter... »
Et quand ils parviennent à parler, on refuse parfois de les croire.
Dans le cas français, on retrouve, dans des modalités différentes, comme un écho de ce qui se passe dans le Yishuv. Le séjour en camp nazi n'est acceptable pour le public que s'il est le prolongement de l'activité de résistance. Le camp type est alors Buchenwald et non Auschwitz. Les Juifs de France, quant à eux, ne souhaitent pas faire état d'un sort spécifique. Ils préfèrent inscrire leurs morts dans une double litanie: celle des « morts pour la France », pour les milieux proches du Consistoire, ceux qui ont perdu la vie aux champs d'honneur de 1940 et 1944-1945, dans la résistance et à Auschwitz; quant aux milieux de gauche, largement issus de l'immigration, les morts ont globalement sacrifié leur vie pour lutter contre le « fascisme ».
Les circonstances de la fin des années 40 expliquent en partie ce silence. N'oublions pas que les rescapés découvrent en Israël un pays en guerre et, de plus, un pays pauvre où sévit le marché noir, comme Tom Segev le décrit dans ses Premiers Israéliens. 22 000 survivants combattent dans la guerre d'Indépendance, soit un tiers de l'ensemble des effectifs de la nouvelle armée israélienne. La plupart n'ont, sur place, ni famille ni réseau relationnel, et le souvenir de leur lutte ou de leur mort se perd dans les sables, faute d'un milieu pour en entretenir la flamme. On ne peut que citer le texte poignant d'Aryeh Sivan sur les Gahaletz (Guiouss Houtz La'aretz), généralement des rescapés arrivés des camps de personnes déplacées de l'Europe en ruine, et tués dans la bataille de Latroun, au cours de la guerre d'Indépendance:
« Nous devrions essayer pour une fois de nous souvenir d'eux. Mais ce n'est pas facile. D'abord, beaucoup n'avaient même pas de papiers à jour, et ils avaient perdu tous leurs anciens amis. Que peut-on mettre sur la tombe d'un Gahaletz qui n'a jamais eu de nom de famille ? Pouvons-nous y graver le numéro que les SS avaient tatoué sur son bras ? Dans la mémoire de qui va vivre son souvenir ? Il n'a ni parents pour visiter sa tombe saison après saison, pour arroser les racines qu'il a plantées. Il n'y a ni chambre pour accrocher sa photo, ni ami pour raconter des anecdotes sur lui, ni veuve pour donner un nom à son fils24. »
Comme dans toute société d'immigration, la position sociale est, en Israël, fonction du degré d'intégration et de la date d'arrivée dans le pays. Ce phénomène contrebalance donc quelque peu la présence numériquement et proportionnellement massive des réfugiés de la Shoah, et explique pourquoi cette « barrière de sang et de silence » entre rescapés et non-rescapés tient bon, même dans un État juif. Elle crée une situation d'incompréhension réciproque et d'isolement des survivants, somme toute assez comparable au cas français.
C'est probablement ce sentiment de ne pas être entendu qui suscite les témoignages écrits, faisant surgir ainsi, en Israël comme en France, une première vague de récits, certains publiés, d'autres sans éditeur. Car la mémoire, dans ces années d'après-guerre, se limite à la mémoire meurtrie portée par les individus, ou encore à la mémoire collective des survivants des petites villes de Pologne, pleurant leur monde disparu.
Dans l'immigration, que ce soit en France, aux États-Unis ou en Argentine, les immigrants ont créé, dès le XIXe siècle, des associations où ils se regroupent par shtetlek (bourgades) ou villes d'origine. En Israël, les sociétés de landsmanshaftn restent importantes. Leur noyau dur est aujourd'hui souvent composé des anciens « du ghetto ». Ces sociétés d'originaires, les landsmanshaftn, constituent, dès avant la Seconde Guerre mondiale, un réseau tout à la fois de sociabilité et d'entraide. La guerre finie, les landsmanshaftn forment des comités transnationaux pour rédiger des ouvrages, les livres du souvenir, les Yizker Bikher, qui doivent à la fois porter témoignage de la splendeur de la vie juive détruite et conter le martyre de leur ville ou de leur village d'origine. Principalement rédigés en yiddish, 440 de ces livres sont, en 1979, déjà publiés aux États-Unis, en France, en Argentine principalement, mais aussi en Israël.
La rédaction de ce genre d'ouvrage donne lieu à une activité sociale: échange de souvenirs, de photos, de correspondances, de textes, etc. Durant les deux dernières décennies, celles qui suivent la guerre de Kippour de 1973, un nombre égal d'ouvrages est encore publié, cette fois principalement en Israël et en hébreu25, portant cette « bibliothèque de la catastrophe », selon l'expression de l'Américain David Roskies, à un millier de volumes. Les auteurs de ces livres -- plus de 5 000 personnes y ont participé --, cherchent à ériger un monument de papier à la mémoire de leur ville disparue et à porter témoignage de la perte incommensurable qu'ils ont subie. Les célébrités de ladite ville sont mises à contribution (Zalman Shazar pour Stoyvetz et David Ben Gourion pour Plonsk, par exemple). Dans les préfaces, les auteurs affirment tous vouloir faire connaître à leurs enfants, et aux enfants de leurs enfants, le monde dont ils sont issus et comment cet univers a été détruit. Le Yizker-Bukh devait être l'un des lieux de la commémoration, remplaçant celui dont la collectivité avait été privée: le cimetière. Il devait être aussi un outil de la transmission. Il ne l'a pas été. Chaque ouvrage est édité à quelques centaines d'exemplaires, en hébreu et en yiddish. Sa diffusion ne dépasse donc pas le cercle des Landsleit, des membres de la société d'originaires. Celui consacré à la ville de Lodz est publié dès 1943. Remarquons à nouveau à quel point, dans ce cas précis, le souci de la mémoire, comme nous l'avons noté plus haut, se montre contemporain de la catastrophe.
Dans le même temps, les Israéliens rédigent des brochure-souvenirs en l'honneur des victimes de la guerre d'Indépendance. Il serait intéressant de comparer le rythme de sorties des Yizker Bikher avec celui des brochures sur 1948. Ces dernières paraissent généralement à l'occasion du premier anniversaire de décès du soldat tué (ce qui, remarque Emmanuel Sivan, correspond à la périodisation du deuil dans le calendrier juif traditionnel) -- donc au tout début des années 50. En revanche, d'après Tom Segev, la moitié des Yizker bikher, en Israël, auraient été publiés après la guerre du Kippour, en 197326.
C'est donc d'abord au papier, geste conforme à la tradition d'un peuple qui se veut le « peuple du livre », que les survivants confient leur souvenir. Les premières institutions historiques, l'Institut d'histoire des Juifs de Varsovie ou le Centre de documentation juive contemporaine, recueillent, de leur côté, les premiers témoignages, publient les premières études historiques. Le CDJC publie dès 1946 Le Monde juif; première revue au monde exclusivement consacrée à la Shoah. C'est en 1946 que le récit de Georges Wellers, De Drancy à Auschwitz, voit le jour et que Joseph Billig commence ses recherches pionnières.
Très vite aussi, les survivants érigent de petits mémoriaux, dans les carrés juifs des cimetières, dans ceux des grands villes américaines ou, à Paris, dans celui de Bagneux. Les communautés de province aussi construisent leurs mémoriaux. Pour ne prendre qu'un exemple, au cimetière israélite de Sedan a été érigée une stèle en forme de tables de la Loi, de deux mètres de hauteur, portant les noms des personnes décédées, et une plaque dédiée:
A nos martyrs. A nos héros
victimes de la barbarie nazie
1939-1945
Morts au champ d'honneur et fusillés
Morts en déportation
de Sedan et Charleville-Mézières
C'est le 27 février 1949 qu'est inauguré, lors d'une grandiose cérémonie à laquelle assiste le président de la République, Vincent Auriol, le monument de la synagogue de la Victoire, dédié « a la mémoire de nos frères combattants de la guerre et de la libération, martyrs de la Résistance et de la Déportation ainsi qu'à toutes les victimes de la barbarie allemande ». En Israël, c'est au kibboutz Mishmar Ha'Emek (« Gardien de la vallée ») qu'est construit le premier mémorial, l'Yeldei Hagola, les « Enfants de l'exil ». Ce sont quatre bas-reliefs encastrés dans un long mur de pierre et représentant, dans un style influencé par le cubisme, un enfant dans la position foetale, puis des silhouettes en procession symbolisant l'Exil du peuple juif, et enfin, une femme dont les longs bras serrent un enfant. La bouche de l'enfant est ouverte comme pour lancer un cri. La tête de la mère s'en détourne. C'est une figure de la douleur27.
A New York, le 19 octobre 1947, une foule de plusieurs dizaines de milliers de personnes se réunit sur Riverside Drive, entre la 83e et la 84e rue, pour la pose de la première pierre du premier mémorial américain. Cette pierre, plutôt une dalle, porte le texte suivant: « Ceci est le site pour le mémorial américain aux héros de la bataille (battle) du ghetto de Varsovie avril-mai 1943 et pour les 6 millions de Juifs d'Europe martyrs pour la cause de la liberté humaine28. »
Pour des raisons qu'il serait trop long d'exposer ici, aucun des projets de monument ne trouve grâce auprès des autorités new-yorkaises; le mémorial ne sera donc jamais construit à l'endroit assigné par le maire de New York. Mais le passant peut toujours voir, sur Riverside Drive, la première pierre avec son inscription où sont déposées chaque 19 avril, date anniversaire du début du soulèvement du ghetto du Varsovie, des gerbes de fleurs.
De ces premiers mémoriaux, marques du souvenir du Génocide dans le paysage, nous pouvons dire qu'ils sont d'abord peu nombreux; ensuite qu'ils sont généralement disposés dans des espaces certes publics, mais à fréquentation limitée: kibboutz, synagogues, cimetières. Enfin, à l'exception de celui du kibboutz « Gardien de la vallée », ils mêlent les victimes du Génocide et les morts glorieux, ceux des combats et de la Résistance.
Le début des années 50 voit dans ce domaine une inflexion. Isaac Schneershon
prend conscience que le « monument de papier » que le CDJC a
constitué par ses ouvrages et sa revue ne suffit pas à inscrire le Génocide
dans la mémoire collective. On veut ériger un « tombeau du Martyr juif
inconnu », capable de développer un rituel du souvenir identique à celui
du Soldat inconnu sous l'Arc de triomphe. Schneersohn crée un comité de
patronage prestigieux, comptant des personnalités telles qu'Eleanor Roosevelt
ou Winston Churchill et entreprend une collecte. Il obtient de la Ville de
Paris un terrain situé au coin de la rue du Grenier-sur-l'Eau et de la rue
Geoffroy-L'Asnier. Le 17 mai 1953, lors d'une grandiose cérémonie dont la
presse rend compte, la première pierre du « tombeau du Martyr juif
inconnu », qui ne deviendra mémorial qu'en 1974, est posée. La réaction
israélienne est vigoureuse. Dès le lendemain de la cérémonie, un débat s'ouvre
à la Knesset. « Tous les députés intervenus {...} convinrent que Jérusalem
était le seul endroit approprié pour la construction du mémorial des victimes
du nazisme29. »
C'est donc le 9 août 1953 que la Knesset vote la loi sur la Shoah et la Guevoura (« héroïsme ») -- expression que nous aurons à commenter plus loin -- et accorde officiellement à Yad Vashem la fonction de « réunir, rechercher et publier l'ensemble des faits relatifs à la Shoah et à la Guevoura ».
Les promoteurs du projet s'opposent à l'érection du mémorial parisien. A l'issue de longues polémiques, il est finalement décidé que Yad Vashem restera le principal projet de mémorial, conservera le droit exclusif de tenir les registres des noms des victimes et distribuera les autorisations de construire des mémoriaux ailleurs dans le monde. Le mémorial de la rue Geoffroy-L'Asnier, inauguré en 1956, aura ainsi, à l'encontre des ambitions de son promoteur, une fonction mémorielle simplement nationale, la centralité de la mémoire étant dévolue à l'État d'Israël.
Il y a cependant, en Israël même, plusieurs autres lieux de mémoire consacrés à la Shoah: le kibboutz Lohamei Hagetaot (« les Combattants des ghettos »), en Galilée, Yad Mordechaï (dédié à Mordechaï Anielewicz, le chef du soulèvement du ghetto de Varsovie) et un petit musée sur le mont Sion à Jérusalem. Yad Vashem est placée sur le mont Herzl, face au désert de Judée. Véritable « Autorité du souvenir », selon le texte de loi contresigné par Ben Gourion et Ytzhak Ben-Tzvi, Yad Vashem a vu sa primauté mise en cause avec l'ouverture du United States Holocaust Memorial Museum et d'autres mémoriaux, en Californie notamment. Certaines voix se sont élevées contre cette tentative d' « américanisation de la Shoah », l'enjeu de mémoire devenant un enjeu d'identité (l'issue du voyage juif est-elle Washington ou Jérusalem ?)30.
L'institution d'une journée du Souvenir est le reflet de la lancinante discorde entre religieux et laïcs en Israël. A l'origine, le rabbinat envisage d'intégrer la commémoration au deuil fixé au 10 du mois hébraïque de teveth, fête dite du Kaddish Klali (prière des morts générale à l'attention de ceux dont on ignore la sépulture -- ce qui est éminemment le cas des victimes de la Shoah). Le 4 mars 1959, la Knesset vote la loi sur la « journée du Souvenir de la Shoah et de l'Héroisme ». Jusqu'aux années 70, on prétend favoriser la mémoire combattante, celle de la révolte, de la résistance, conforme à l'idéal sioniste traditionnel.
Le choix de la date (27 nissan) lie également la mémoire à l'héroïsme puisque la commémoration est fixée une semaine après la date anniversaire du déclenchement de la révolte du ghetto de Varsovie. Dès lors, toutes les structures de la mémoire de la Shoah sont en place en Israël. Mais, contrairement à ce qu'en attendent les promoteurs, un renversement va s'opérer. La mémoire favorisant les combattants rachetant « l'honneur du peuple juif » laisse place à une mémoire plus soucieuse désormais de ceux que le poète et militant Abba Kovner accusait, dans le ghetto de Vilna, de se laisser mener « comme des moutons à l'abattoir ».
Tom Segev, dans son Septième Million, consacre un long chapitre à cette question. Les négociations s'ouvrent le 30 décembre 1951, alors que la cristallisation de la guerre froide a donné à la RFA une position plus forte en Europe (notons que jusqu'en 1965, jusqu'à l'installation de Rolf Pauls, il n'y a pas d'ambassadeur de RFA à Tel-Aviv). En septembre 1945, Haïm Weizmann a demandé aux puissances d'occupation l'attribution à l'Agence juive des biens juifs sans héritiers -- le futur État juif s'estimant le légataire des victimes, qu'elles aient été sionistes ou non. Sur les 8 milliards de dollars réclamés, les Alliés n'octroient en tout et pour tout que 25 millions de dollars à répartir entre l'Agence juive et d'autres organisations humanitaires. Le 27 septembre 1951, le chancelier Adenauer fait une déclaration historique au Bundestag, acceptant au nom de son pays de prendre en charge
« une réparation sur le plan moral et matériel, tant pour les dommages individuels subis par les Juifs que pour les préjudices causés aux biens juifs dont les ayants-droit individuels n'existent plus aujourd'hui ».
En décembre 1951, le comité central du Mapaï vote l'acceptation du principe des réparations (en écartant toutefois la possibilité pour ses membres de voter chacun suivant sa conscience, tant ils sont nombreux à hésiter devant le principe même des « réparations »).
Le débat à la Knesset, le 7 janvier 1952, provoque une série d'émeutes fomentées par le Herout de Menahem Begin, qui trouve dans cette tempête politique l'occasion de revenir, lui et son parti, sur le devant de la scène politique. Les négociations commencent. Les accords, âprement discutés, sont signés le 10 septembre 1952. Pour la première fois dans l'histoire, des Juifs vont être dédommagés -- même partiellement -- pour les souffrances infligées par un régime antisémite. Concrètement, l'Allemagne s'engage à verser 820 millions de dollars, dont 750 millions à l'État d'Israël. L'Allemagne se voit également dans l'obligation d'indemniser les victimes du nazisme, ce qui est fait sous forme de pensions individuelles et non de paiements immédiats.
Cette affaire laisse bien des égratignures. Matérielles d'une part: Israël ne touche pas tout ce qu'il avait demandé. Les revendications israéliennes initiales étaient fondées sur l'hypothèse que le coût de l'intégration d'un réfugié était de 3 000 dollars et que 500 000 rescapés avaient été intégrés pour 1,5 milliards de dollars. Les Allemands ont donc su marchander. Blessure symbolique d'autre part: dans l'accord, Israël est désigné non comme la patrie du peuple juif mais comme un pays d'immigration parmi d'autres31.
Ainsi, à la fin des années 50, le paysage mémoriel a amorcé sa transformation. Mais c'est le procès d'Adolf Eichmann qui marque le véritable tournant.
Dans les années 50, le jeune État d'Israël est secoué d'affaires et de procès mettant en cause l'attitude du Yishuv pendant la Shoah. La plus célèbre de toutes est bien entendu l'affaire Kastner. Kastner était un dirigeant travailliste promis à une belle carrière politique. Or, au début des années 50, il est accusé par un homme, d'origine hongroise comme lui, Malchiel Gruenwald, de s'être contenté, alors qu'il représentait les sionistes dans la Hongrie occupée, d'arracher aux nazis un millier de privilégiés. On lui reproche également d'avoir témoigné en faveur de SS aux procès de Nuremberg. La toute nouvelle presse contestataire en Israël, et notamment le fameux Ha'olam hazé d'Ouri Avneri, reprend l'accusation à son compte et mène campagne contre Kastner pour ébranler à travers lui l'establishment travailliste. Kastner sera assassiné en 1957 par un fanatique. Avec la question des réparations et le procès Kastner, la Shoah fait ainsi irruption au coeur de la scène politique israélienne. Elle ne la quittera plus32.
Dans la foulée de ce procès, un écrivain nommé Ben Hecht publie au début des années 60 un violent pamphlet intitulé Perfidie, dans lequel il met en cause l'attitude du Yishuv. On peut considérer que c'est la première occurrence d'une « historiographie » polémique sur ce sujet, avec les livres du rabbin Michaël Weissmandel, qui a tenté de sauver de la déportation les Juifs de Slovaquie, et qui, depuis New York, tempête contre l'incurie dont il accuse les dirigeants sionistes d'avoir fait preuve à l'époque. Mais le processus d'identification collective des Israéliens à la Shoah se fait bel et bien à l'occasion du procès Eichmann.
Rappelons brièvement les faits. Le 23 mai 1960, le Premier ministre israélien Ben Gourion annonce à la Knesset, qu'Eichmann, chef du service IVB4 de l'Office de sécurité du Reich, responsable « de la solution du problème juif en Europe », a été découvert par les services secrets, qu'il se trouve en Israël et qu'il sera jugé prochainement conformément aux dispositions de la loi de 1950 sur le châtiment des nazis et de leurs collaborateurs. Le 11 avril 1961, le procès s'ouvre à Jérusalem.
Ce procès, dont nous ne ferons pas ici le récit, présente de nombreuses originalités. C'est la première fois dans l'histoire millénaire du peuple juif qu'un persécuteur est jugé par un tribunal juif. Mais surtout la volonté politique de Ben Gourion est claire. Ce procès doit être « le Nuremberg du peuple juif ». Plusieurs fonctions lui sont assignées. La première, interne au monde juif, Abba Eban, alors ministre de l'Éducation et de la Culture de l'État hébreu, l'exprime très clairement dans ses mémoires. Le procès doit réduire certains fossés qui sont en train de se creuser dans la société israélienne:
« Fossé entre la nouvelle classe moyenne des villes et la vieille élite rurale née du mouvement kibboutz {...} fossé entre la population qui avait été élevée en Europe -- et leurs enfants sabras -- et les immigrants orientaux {...} Fossé des générations: les jeunes nés au soleil, sous le vaste ciel, étaient attirés par une conception plus simple de l'existence, moins tourmentée, mais aussi plus superficielle intellectuellement que celle des premiers pionniers. Et enfin, le fossé entre les sabras, très réalistes, et les Juifs de la diaspora plus sentimentaux, plus compliqués, plus introvertis mais aussi plus créateurs. »
Pourtant, précise Abba Eban, certains souvenirs communs rappellent souvent aux Israéliens que l'histoire a traité l'ensemble du peuple juif d'une manière telle qu'en fin de compte leur destin est indivisible. L'un des grands moments de vérité de l'unification est la capture et le procès d'Adolf Eichmann.
Ainsi le procès a-t-il pour fonction d'éduquer la jeunesse, de resserrer les liens entre Israël et la diaspora et de montrer l'unicité du peuple juif. Le procès a aussi pour fonction de faire entrer le Génocide, par le biais de ce « Nuremberg du peuple juif », dans la conscience universelle, et de prévenir ainsi d'autres tentatives de destruction. Pour ce faire, il faut qu'il ait un écho mondial: la salle de presse est prête à accueillir 600 journalistes du monde entier; le procès est filmé pour la télévision (que ne possédait pas encore Israël), et des séquences en sont diffusées, notamment aux États-Unis.
Ainsi, même s'il s'agit de juger un homme, Eichmann, pour les crimes dont il est personnellement responsable (et le procès, de ce point vue procès exemplaire, est mené selon les règles de la justice), il est aussi celui du Génocide. Comme le dit Gideon Hausner, le procureur général israélien, on cherche à écrire, en lettres de feu, un désastre national. Pour ce faire, Gideon Hausner opte pour un procès qui donne le premier rôle aux témoins. Cette option est l'inverse du parti pris du procureur américain Jackson à Nuremberg -- l'accusation s'étant alors fondée pour l'essentiel sur des documents. Hausner, lui, veut une reconstitution vivante de ce désastre humain. Il convoque à la barre un grand nombre de témoins. Il confie à Rachel Auerbach, historienne et survivante du ghetto de Varsovie, qui dirigea la division de Yad Vashem chargée de rassembler les témoignages, le soin de dresser une liste de témoins parmi lesquels il opère ses choix:
« des enseignants, des maîtresses de maison, des artisans, des écrivains, des paysans, des commerçants, des ouvriers et des médecins, des fonctionnaires et des industriels, et c'est de toutes les parties de la nation que les gens sont venus en attester33. »
Ces témoignages, que l'on entend alors pour la première fois, bouleversent. Ils provoquent l'identification, surtout des jeunes, aux souffrances des victimes. Pour la première fois dans l'histoire de la mémoire du Génocide, le témoin, dont le récit est relayé par la radio, et, nous l'avons vu, pour la première fois par la télévision hors d'Israël, est devenu le vecteur principal de la mémoire. Et il n'a cessé de l'être: le procès Barbie, et plus encore le film qui en a été tiré, projeté à la télévision dernièrement, joue sur l'émotion provoquée par le récit des souffrances. Le grand film de Lanzmann, Shoah, est bâti sur la confrontation du témoin aux lieux de la destruction. L'université Yale a entrepris, aux États-Unis et dans d'autres pays, en France notamment, un programme systématique d'enregistrement de récits de survivants, et elle n'est pas seule à le faire.
Le procès Eichmann a donc largement rempli ses objectifs. Il a permis un double passage: la mémoire du Génocide s'est décloisonnée en passant de la société des survivants à l'ensemble des sociétés juives, en diaspora comme en Israël. Cette mémoire appartient aujourd'hui à tous les Juifs. Ceux des séfarades qui n'ont pas été touchés (car, ne l'oublions pas, une partie du judaïsme séfarade fut aussi annihilée: la Salonique juive fut détruite tout comme Varsovie) ont maintenant intégré cette histoire. Mais la mémoire du Génocide a aussi, par le biais du procès, intégré la mémoire universelle. Elle n'a plus quitté en tout cas la scène publique.
Pendant la Tekoufat Hametana (période d'attente) qui précède la victoire israélienne de la guerre des Six-Jours, l'angoisse saisit la population israélienne. Elle est vécue sur un mode « génocidaire ». La situation s'inverse par rapport à celle qui prévalait pendant la Seconde Guerre mondiale. Désormais, c'est la diaspora (du moins la diaspora occidentale) qui se trouve en sécurité, tandis qu'Israël est menacé de destruction. Ce véritable « renversement des valeurs » sera une tendance longue, dont l'acmé est la guerre du Kippour, et dont la guerre du Golfe est encore une sorte de rappel. Une éventuelle paix au Proche-Orient pourrait peut-être en signifier la fin, et l'entrée dans une nouvelle époque.
Un jeune soldat, interrogé après la guerre de 1967 pour le livre Le Septième Jour: des soldats parlent de la guerre des Six-Jours, se souvient que tous
« s'attendaient à être exterminés si l'on perdait la guerre. Cette idée nous est venue des camps de concentration -- ou bien en avons-nous hérité. La Shoah était concrètement concevable pour qui avait grandi en Israël, même s'il n'avait pas connu les persécutions hitlériennes. {...} En Israël, tout le monde vit avec cette idée. On y a tous pensé. Chaque Israélien sent que cela fait partie de sa vie et connaît la précarité de son existence -- je la ressens moi-même à tous les niveaux --, et pas seulement en raison du danger militaire. L'existence juive en Israël n'est pas un fait acquis. Historiquement, il s'agit d'un phénomène particulièrement récent, de plus nous sommes numériquement peu nombreux34. »
Chez les Juifs de France, la guerre des Six-Jours amène une rupture, probablement préparée par le procès Eichmann. Elle fait craindre aussi la destruction de l'État d'Israël, rappel d'une autre destruction. Raymond Aron, peu enclin aux épanchements intimes, écrit le 4 juin, à la veille de la guerre:
« Monte en nous un sentiment irrésistible de solidarité. Peu importe d'où il vient. Si les grandes puissances, selon le calcul froid de leurs intérêts, laissent détruire le petit État d'Israël qui n'est pas le mien, ce crime modeste, à l'échelle du monde, m'enlèverait la force de vivre et je crois que des millions d'hommes auraient honte de l'humanité. »
Et quelques mois plus tard, il précise:
« {...} Je sais aussi, plus clairement qu'hier, l'éventualité même de la destruction de l'État d'Israël (qu'accompagnerait le massacre d'une partie de la population), me blesse jusqu'au fond de l'âme. »
Cette destruction éventuelle, Raymond Aron la nomme « Étatcide35 ».
La guerre des Six-Jours marque ensuite largement le divorce entre les Juifs et le communisme, en Pologne, certes, où les derniers Juifs sont contraints de quitter le pays, et où se déroulent les premières polémiques autour du site d'Auschwitz, mais aussi en France, notamment dans les milieux issus de l'immigration. Mais surtout, et c'est là l'originalité française des conséquences de la guerre des Six-Jours, elle met fin à la croyance dans la possibilité, pour les Juifs de France, de s'assimiler totalement, et ce du fait de la politique française à l'égard de l'État hébreu et de la fameuse déclaration de De Gaulle lors de sa conférence de presse de novembre 1967:
« On pouvait même se demander et on se demandait même chez beaucoup de Juifs si l'implantation de cette communauté sur des terres qui avaient été acquises dans des conditions plus ou moins justifiables et au milieu de peuples arabes qui lui étaient foncièrement hostiles n'allait pas entraîner d'innombrables, d'interminables frictions et conflits. Certains même redoutent que les Juifs, jusqu'alors dispersés, qui étaient restés ce qu'ils avaient été, un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur, n'en viennent, une fois qu'ils seraient rassemblés, à changer en ambition ardente les souhaits très émouvants qu'ils formaient depuis dix-neuf siècles: "l'an prochain à Jérusalem". »
Pour Raymond Aron, « de Gaulle, sciemment, volontairement, avait rouvert une nouvelle période de l'histoire juive et peut-être de l'antisémitisme. Tout devenait possible, tout recommençait. Pas question, certes, de persécution: seulement de la « malveillance ». Pas le temps du mépris: le « temps du soupçon ».
Et c'est l'ouverture de ce « temps du soupçon » qui fit prendre conscience à Raymond Aron, mais aussi à bien d'autres, de l'existence d'une identité juive résiduelle, bien difficile à définir:
« Si assimilé qu'il soit ou se juge, le Juif garde un sentiment de solidarité et avec ses ancêtres, et avec les autres communautés juives de la diaspora. Surtout à notre époque, après les persécutions hitlériennes, un Juif ne peut pas fuir son destin et ignorer ceux qui, ailleurs, ont cru ou croient au même Dieu d'Israël et de Jacob, celui de ses ancêtres. »
Mémoire et identité ont donc partie liée.
Ce que révèle aussi la guerre des Six-Jours alors que, pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, Israël semblait en danger, c'est que la France ne le soutient pas, et que cette identité juive résiduelle peut entrer en conflit avec l'identité française. Écoutons encore un aveu de Raymond Aron:
« Depuis Hitler, j'ai toujours su que l'intérêt de la France ne coïncidait pas toujours et nécessairement avec celui des Juifs ou des Israéliens. »
L'attitude du gouvernement français à un moment où les Juifs de France s'identifient, dans leur immense majorité, avec le destin d'Israël réveille ce qui avait été mis entre parenthèses dans l'après-guerre: l'exclusion dont les Juifs ont été victimes du fait de Vichy. Dès lors, la mémoire du Génocide prend en France, en partie, la forme d'un combat militant: celui de la dénonciation des complicités de Vichy dans la déportation des Juifs de France. La mémoire juive en France s'inscrit ainsi largement dans les guerres franco-françaises, dont elle devient, surtout avec l'attentat contre la synagogue de la rue Copernic, en octobre 1980, attentat pourtant d'origine proche-orientale, une composante.
La guerre du Kippour provoque un ébranlement considérable dans la confiance en soi des Israéliens. Dans la mémoire de la Shoah, le mythe de la Guevourah, de l'héroïsme, a été refoulé ou consumé. Là encore laissons parler un militaire, le colonel Ehud Praver, chef-adjoint de l'instruction militaire:
« À l'école nous étions fascinés par la Résistance. Nous étions littéralement envoûtés par l'idée que la Résistance c'était "nous" et qu'"eux" étaient les agneaux menés à l'abattoir. Tout d'un coup cela se fissura -- nous avions eu besoin du soutien des Juifs américains {...} Nous nous sentions totalement isolés: le pays était sur le point d'être détruit et personne ne bougeait {...} Nous nous sommes révoltés contre la Résistance. Elle avait été un symbole. Nous la considérions désormais comme un grand mensonge que la guerre du Kippour avait révélé. Jusque-là nous avions cru dans l'opposition des termes Shoah et Guevourah. Nous nous étions identifiés à l'héroïsme. La guerre nous fit prendre conscience de la signification du Génocide et des limites de l'héroïsme36. »
Avec la guerre du Golfe, en 1991, un nouveau pas va être franchi. L'identification collective qui a commencé avec le procès Eichmann va devenir individuelle. Jamais, dit Tom Segev, un si grand nombre d'israéliens n'avait partagé une expérience (d'impuissance devant les attaques de Scuds) aussi « juive ». Ce d'autant plus que l'effondrement du bloc de l'Est a permis la reprise des voyages de jeunes Israéliens sur les sites des camps d'extermination, pèlerinages qui d'ailleurs avaient commencé dès les années 60, avant que le camp socialiste ne rompît ses relations diplomatiques avec Israël37.
Quelles sont, en 1994, les formes et les contenus de la mémoire du Génocide en France, comme en Israël? Avouons-le, le recul manque pour procéder à une analyse approfondie des dernières années. Nous nous contenterons donc de formuler quelques remarques et de lancer quelques pistes.
Du côté des livres, tout d'abord. Rien qu'en janvier 1994, deux ouvrages importants, dûs à des historiens américains, sont traduits en français. Celui de Raoul Hilberg: Victimes, témoins et bourreaux, Celui de Christopher R. Browning, Des hommes ordinaires. Le 101e bataillon de réserve de la police allemande et la solution finale en Pologne38. Ce que note André Kaspi se vérifie: l'étude de la Solution finale se fait principalement hors de France. Pourtant, davantage de livres sont traduits, et plus rapidement qu'auparavant, ce qui montre l'intérêt des éditeurs qui supposent, nous espérons à raison, l'existence en France d'un marché. Côté français, un ouvrage, celui de Gérard Boulanger sur l'affaire Papon.
En Israël apparaît une historiographie nouvelle. La mise en cause de l'attitude du Yishuv pendant la Shoah, telle qu'elle s'est exprimée brutalement dans les livres de Boaz Evron, et plus modérément dans l'historiographie universitaire, chez Dina Porat, semble laisser place à une relation toujours douloureuse mais plus sereine avec la mémoire de la Shoah. Le temps des mises en cause est passé. Celui de l'histoire de la mémoire commence. Le livre de Tom Segev, si souvent évoqué, en est un exemple, même si, çà et là, l'attitude du Yishuv pendant la Shoah sert de machine de guerre politique à diverses tendances israéliennes hostiles au « consensus » (l'extrême gauche « colombe » dite « post-sioniste », et les milieux ultraorthodoxes, a- ou antisionistes).
Seconde remarque concernant la vie associative, en France comme en Israël. Les associations de survivants de la déportation continuent à jouer leur rôle dans l'entretien de la mémoire, notamment par le biais de témoignages, lors des commémorations qu'elles organisent ou dans le milieu scolaire. Pourtant, d'autres associations sont apparues ces dernières années, regroupant d'autres catégories des victimes en France, l'Association des filles et fils de déportés juifs de France, fondée par Serge et Béate Klarsfeld; en Israël, aux États-Unis comme en France, des associations d'enfants cachés. Ainsi, plusieurs générations coexistent désormais dans le champ associatif de la mémoire, blessées au plus profond par les thèses négationnistes, qui firent leur apparition publique en décembre 1978. Ces associations répondent à une double finalité: sociabilité et échanges entre ceux qui ont vécu les mêmes expériences, mais aussi, en France, appel au « devoir de mémoire » pour la société globale, afin qu'elle se souvienne de ce qui est advenu à leurs membres du temps de l'Occupation, par les poses de plaques qui s'est multipliée ces dernières années, notamment sur les lieux d'internement et de départ pour la déportation. L'existence d'une « Mémoire officielle » donne à ces phénomènes, en Israël, une dimension sans commune mesure.
Cette mémoire a aussi pris un caractère revendicatif. Elle demande des comptes. A l'Allemagne, par le biais de l'accusation des responsables allemands de la Solution finale: ce sont les procès de Cologne en 1979, de Barbie en France, en 1987, ainsi que de Demjanjuk en Israël. Mais on demande aussi des comptes à la France, par le biais de la mise en accusation d'hommes ayant eu des responsabilités dans la mort ou dans des déportations de Juifs. Le cas de Papon n'est pas encore réglé. Paul Touvier a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour crime contre l'humanité le 20 avril 1994. Avec l'émergence d'une nouvelle association, le comité Vel' d'hiv' 1992, qui a lancé une pétition demandant à l'occasion du cinquantième anniversaire de la grande rafle un geste au président du la République, ce sont désormais des comptes symboliques qui sont réclamés. Le geste, ce fut la loi organisant la journée commémorative que nous avons déjà évoquée. Il est trop tôt pour savoir, alors que dans le pays la commémoration est en crise, que les actes commémoratifs (poses de plaques, célébrations) attirent un public de plus en plus clairsemé et que, comme le dit le professeur Geoffrey Hartmann, la mémoire de la Shoah demeure essentiellement une « mémoire juive », quel impact aura cette nouvelle « journée » sur la construction de la mémoire.
Mais ce que montre aussi l'évolution récente, c'est l'éloignement, dans la mémoire, des responsabilités nazies dans la destruction. Phénomène que ne touche pas la France seule: les débats publics portent en Pologne sur les responsabilités polonaises. En Israël aussi, on demande des comptes au mouvement sioniste et au Yishuv pour son attitude pendant la Shoah. Un phénomène général de déplacement de responsabilité est-il en cours ? Les travaux de Morse, à partir des années 60 et avec une amplification au cours des années 1960, de Laqueur, et de Wyman, qui mettaient l'accent sur l'inertie des Alliés et des démocraties face au Génocide, constituent la version américaine de cette tendance39.
Enfin, la mémoire procède aujourd'hui largement par identification avec les victimes prises individuellement. L'idée de nommer les victimes a été présente dès l'après-guerre. Les livres du souvenir, dont nous avons parlé, contiennent des listes des morts de la ville ou du shtetl. Yad Vashem s'était assigné la tâche de rassembler les noms. En France, la publication des listes de déportés par Serge Klarsfeld constitua un véritable choc. Aujourd'hui ces noms sont lus publiquement, en Israël comme en France, le jour de Yom Ha-Shoah, qui est en train de s'acclimater en France.
L'identification individuelle à une victime de la Shoah est poussée à son point extrême au mémorial de Washington où chaque visiteur est muni d'une carte portant l'identité réelle d'un enfant pendant la Shoah et suit son parcours. Si cette identification aux victimes, de plus en plus poussée, de plus en plus extrême, paraît caractériser la relation des nouvelles générations à la Shoah, on peut légitimement se demander si ce phénomène transnational est un phénomène transitoire, marquant l'acmé de la mémoire avant le passage inexorable à l'histoire, ou s'il est destiné à créer une forme inédite de mémoire, qui ne connaîtrait pas l'oubli.
____________________________
Server / Server
© Michel Fingerhut 1996-2001 - document mis à jour le 05/12/2000 à 15h29m44s.
Pour écrire au serveur (PAS à l'auteur)/To write to the server (NOT to the author): MESSAGE