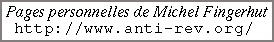

Le 23 mars 1938, dix jours après l'Anschluss, la France est conviée par le gouvernement américain à conférer avec vingt-huit autres nations d'Europe et d'Amérique latine, mais sans le Reich, sur les moyens de « faciliter l'émigration des réfugiés politiques en provenance d'Autriche et probablement d'Allemagne[1] ». Prévenir le chaos d'une fuite éperdue devant la violence nazie déchaînée comme jamais en Autriche annexée -- et qui pourrait faire tache d'huile --, former une nouvelle instance internationale habilitée à négocier avec les autorités allemandes, tels sont les objectifs affichés d'une démarche unique en son genre dans l'entre-deux-guerres[2]. Président d'une nation isolationniste, Roosevelt soulève là en effet, sous le coup d'un sentiment d'« urgence », une question restée largement tabou dans les relations internationales en raison du risque d'ingérence dans les affaires intérieures des États qu'elle pourrait impliquer: celle des réfugiés, ou plutôt, pour parler clair, celle des Juifs, qui forment le gros de leurs bataillons.
Ce drame contribue pourtant à déstabiliser, depuis 1933, une Europe malmenée par la crise et les « coups » hitlériens. Au premier rang des pays frontaliers de l'Allemagne, la France a dû recevoir, malgré l'impatience croissante de l'opinion et des autorités, des dizaines de milliers de réfugiés, en transit le plus souvent, mais aussi candidats à un séjour prolongé, sinon définitif, à raison de l'amenuisement des chances de réémigration. En 1938, elle abrite ainsi, à titre légal ou clandestin, 20 000 à 30 000 réfugiés du Reich secourus très souvent par des oeuvres d'assistance submergées, généralement juives elles aussi[3]. Retranchés derrière des quotas d'immigration nationaux dont l'effet léonin se trouve encore aggravé par les pratiques consulaires, les États-Unis n'ont accueilli, eux, de 1933 à 1937 inclus, que 27 000 des 150 000 émigrants environ ayant alors quitté l'Allemagne[4]. Jusqu'en 1938, les problèmes relatifs à l'assistance et à l'établissement des réfugiés sont réglés tant bien que mal dans les cadres nationaux, la Société des nations -- dont les États-Unis ne font pas partie -- se bornant en fait à la promotion de la protection juridique des apatrides au travers d'organismes conçus comme temporaires: l'office Nansen et le Haut Commissariat pour les réfugiés (Juifs et autres) en provenance d'Allemagne[5].
Émanant d'un État européen, et notamment de la France, pays directement concerné par la marée montante, le voeu d'internationaliser la question des réfugiés pourrait donc sembler légitime. Or, non contentes de n'y avoir aucune part, les démocraties française et anglaise réservent un accueil des plus réservés à l'initiative américaine. Faut-il voir dans cette réaction, comme le fait l'historiographie, l'annonce de l'abandon dans lequel furent laissés les Juifs lors de la Shoah[6] ? L'étude, inédite encore, de l'attitude française replacée dans le concert d'Évian est du reste nécessaire pour prétendre élucider le mécanisme compliqué d'un échec qualifié parfois de « Munich juif »[7].
De Blum à Daladier: la France et l'initiative
américaine
A la différence du Foreign Office, le Quai d'Orsay, dirigé par Joseph Paul-Boncour, ministre du second et éphémère cabinet de Front populaire conduit par Léon Blum, s'empresse, dans un premier temps, de répondre « très favorablement » à l'invite de Washington[8]. Le désir des États-Unis de se placer « sur un terrain purement humanitaire[9] » s'accorde en effet avec l'attitude généreuse, quoique prudente, adoptée sur le chapitre des réfugiés par la majorité de gauche au pouvoir depuis juin 1936. Tout en manifestant une sollicitude conforme à l'esprit démocratique, « cette action devrait conserver un caractère privé », a opportunément précisé le sous- secrétaire d'État Sumner Welles, « tant par l'origine des fonds qui y seraient consacrés que par la composition des différents comités nationaux. Les gouvernements réglementeraient, chacun en ce qui le concerne, l'admission et le séjour des réfugiés sans avoir à modifier leurs lois et leurs règlements actuels[10]. » Bref, le geste ne sous-entend pour la France aucun « effort spécial », ni financier ni législatif. Quant au projet d'une démarche collective impliquant Washington pour obtenir de l'Allemagne qu'elle ne dépouille pas totalement ses émigrants, il ne fait, à ce stade, l'objet d'aucun commentaire. Mais il est clair que ni l'Angleterre, ni la France -- qui n'ose guère, à cette époque de « décadence », se démarquer de Londres[11] --, ni, a fortiori, la SDN honnie de l'Allemagne ne veulent -- pour des raisons de principe -- ni ne peuvent engager avec quelque chance de succès un dialogue jugé pourtant indispensable par beaucoup. Certes, on se montrerait plus circonspect si l'institution genevoise, foyer de l' idée de sécurité collective, devait en souffrir, mais on semble présumer alors à Paris que les États-Unis n'entendent ni « contrarier ni restreindre l'activité des organisations fondées par la SDN[12] ».
Il n'échappe pas aux responsables français que l'initiative américaine obéit d'abord au souci, purement intérieur, « de canaliser le mouvement très vif de sympathie qui se manifeste en ce pays pour les réfugiés autrichiens et qui pourrait facilement, si l'administration n'en prenait la direction, conduire à des manifestations d'hostilité violente [envers] l'Allemagne et à une campagne pour la modification de la législation sur l'immigration[13] ». Mais, comme les dirigeants britanniques, ils veulent y voir aussi une nouvelle manifestation de l'attitude adoptée par Roosevelt depuis son discours dit « de la quarantaine ». Depuis le mois d'octobre précédent, ce dernier travaille, leur semble-t-il, à faire prendre conscience aux Américains, progressivement, prudemment, du danger potentiel que fait courir le fascisme à leur propre sécurité, comme de l'antinomie fondamentale entre le comportement hitlérien et les « principes d'humanité » chers à l'Amérique[14]. Si Roosevelt jugeait la cause des réfugiés propre à faire reculer l'isolationnisme, ce n'est pas le gouvernement Blum qui s'aviserait de le gêner.
Mais ce dernier tombe le 8 avril, cédant la place à un cabinet de centre-droit présidé par Daladier qui devra assumer l'engagement pris par son prédécesseur dans un contexte de montée des périls à l'extérieur, et de durcissement, à l'intérieur, du régime des étrangers. Pris par d'autres soucis et en l'absence de pressions immédiates de la part du département d'État, le nouveau gouvernement n'ouvre le dossier que fin avril-début mai[15]. La Suisse, à laquelle les Américains avaient demandé d'abriter la conférence, ayant décliné cet honneur -- de crainte de désobliger la SDN et, surtout, d'irriter l'Allemagne --, les États-Unis se tournent en effet vers la France, suggérant le site d'Évian, ce que Paris finit par accepter sans grand plaisir[16]. Informé, toujours à la même époque, de la nomination de l'ancien homme d'affaires et ami personnel de Roosevelt, Myron C. Taylor, à la tête de la délégation américaine, le Quai, dirigé par Georges Bonnet, ne sollicite, pour représenter la France, Henry Bérenger, président de la commission des Affaires étrangères au Sénat et habitué des instances traitant des réfugiés, partisan comme le ministre de l'« apaisement », que le 30 mai[17]. Le retard pris par les préparatifs impose finalement de reporter l'ouverture de la conférence du 15 juin initialement prévu au 6 juillet, la médiocrité des dispositions matérielles convenues avec Washington achevant de souligner la réserve désormais de mise à Paris[18].
Tout occupé à durcir sensiblement par les décrets-lois de mai- juin 1938 les conditions de leur accueil et de leur séjour en France, le nouveau gouvernement redoute désormais l'ouverture d'un débat international sur les réfugiés. Comment éviter que la France ne soit finalement sollicitée d'en accepter un contingent, sinon en métropole, du moins dans l'empire ? Les Américains, les organisations de secours, sans parler des États antisémites pressés d'expulser leurs Juifs comme la Roumanie et la Pologne, tirent des plans en effet sur les possessions françaises comme sur les colonies britanniques[19]. D'autant plus soucieuse de voir surgir à Évian des perspectives quelconques qu'elle n'entend à aucun prix ouvrir davantage la Palestine aux Juifs, l'Angleterre s'enquiert soudain du projet Madagascar lancé en janvier 1937 par le ministre des Colonies du Front populaire, Marins Moutet. Mais Georges Mandel, le nouveau ministre des Colonies, soutient qu'une immigration importante à Madagascar, comme en tout autre point de l'empire, reviendrait à « [reconnaître] par là même l'existence d'une question juive », et « qu'il serait peut-être téméraire d'accueillir dans nos territoires d'outre-mer des Juifs originaires des pays qui formulent des revendications coloniales, tels que l'Allemagne et la Pologne[20] ».
Malencontreuse, l'initiative américaine l'est aussi parce que, estime-t-on désormais à Paris comme on l'a toujours pensé à Londres, elle risque d'encourager l'antisémitisme en Europe centrale et orientale, et, partant, d'augmenter à un degré incontrôlable le problème des réfugiés qu'elle se propose de résoudre. Ces assises pourraient fort bien en outre tourner au procès de l'Allemagne et compromettre ainsi les efforts d'« apaisement » de Georges Bonnet, convaincu que la France doit éviter à tout prix une guerre qu'elle n'est pas en état de soutenir[21]. Enfin l'on redoute à présent à la sous-direction de la SDN au Quai, peut-être à l'instigation anglaise, un nouvel affaiblissement de la Société, ce qui la pousse à tenter d'obtenir des Américains par avance, mais vainement, l'assurance d'« une certaine continuité entre les travaux du Comité [de la SDN} et ceux de la future conférence d'Évian[22] ». Les Anglais, qui, plus que les Français, ont la haute main sur les oeuvres internationales d'assistance et ne veulent pas en fait d'une création concurrente, choisissent de leur côté de différer l'expression de leur désaccord persistant sur ce point; le temps, en fait, soupçonnent les Français, d'affermir leur emprise sur les institutions de la SDN. Paris s'est employé, au côté de Londres, à éviter la liquidation de l'oeuvre d'assistance de la SDN prévue normalement à la fin de 1938, perspective écartée en février, moyennant la fusion prochaine de l'office Nansen et du Haut Commissariat en un seul nouveau Haut Commissariat, et la formation -- acceptée par Londres à contrecoeur -- d'une commission intergouvernementale destinée à « collaborer » avec le futur haut commissaire, très probablement un Britannique[23]. En mai, Londres revient précisément sur cette concession, ar guant « qu'un comité intergouvernemental ferait double emploi avec l'organisme envisagé outre-Atlantique[24] ». La France n'en soutient pas moins les efforts anglais pour faire adopter, en mai, l'extension de la compétence du nouveau Haut Commissariat aux réfugiés d'Autriche, une mesure clairement destinée à renforcer la main de Genève face aux projets prêtés à Washington[25].
Pas question néanmoins de faire trop grise mine aux Américains, dont il convient, estime-t-on à Londres comme à Paris, d'encourager les velléités de participation au concert politique européen. Dès le début de juin, on ne nourrit d'ailleurs au Quai guère d'illusions sur les chances de découvrir à Évian de réelles possibilités d'établissement massives pour les réfugiés. L'attitude plus que réservée des autres gouvernements invités lui est connue, notamment celle des pays d'Amérique latine[26]. L'Amérique compte-t-elle elle-même se montrer concrètement généreuse ? On a toutes les raisons d'en douter. Résolue à conserver ses quotas d'immigration, elle s'est contentée d'annoncer le cumul des quotas allemand et autrichien, ce qui porte le quota annuel autorisé en provenance du Reich à 27 370 personnes[27]. Tout au plus peut-on espérer voir ce quota effectivement rempli et affecté aux seuls réfugiés. Quant à la négociation financière envisagée ultérieurement avec le Reich, elle n'a guère de chances d'aboutir, confie un membre de l'ambassade américaine à Paris[28]. Cette perspective toutefois, même aléatoire, et surtout la réinsertion des États-Unis dans les affaires européennes, même sur ce mode mineur, interdisent de bouder trop ouvertement une initiative dont la diplomatie française se fait fort, du reste, de limiter les inconvénients et les risques.
Étudiée d'abord au sein de la sous-direction de la SDN au Quai, la ligne française est arrêtée lors de deux réunions interministérielles, les 11 et 27 juin, cette dernière seulement en présence d'Henry Bérenger[29]. Le chef de la délégation française a pu, par ailleurs, se concerter avec son homologue américain arrivé en Europe depuis plusieurs semaines; ayant pris connaissance, le 15 juin, comme tous les participants, de l'ordre du jour élaboré à Washington, il s'est vu en outre communiquer le texte du discours de Taylor ainsi que celui du projet américain de la résolution appelée à sanctionner la réunion[30]. Avec les Anglais, en revanche, il n'eut guère de contacts, semble-t-il, tandis que les organisations d'assistance privées, consultées à Washington et à Londres, ne jouent aucun rôle dans le processus de décision français[31].
Le premier souci est d'éviter que cette conférence, improvisée, juge-t-on, par une diplomatie novice, n'éveille des « espoirs immodérés » tant chez les persécuteurs que chez les persécutés[32]. D'où des échanges avec le département d'État sur des points qui ne sont pas de pure forme. Washington convient ainsi que l'expression de « réfugiés politiques », préférée par eux au terme de « réfugiés » en usage au sein de la SDN, sert mal une entreprise réputée purement humanitaire et entretient une attente indue dans l'émigration antifasciste. En attendant de trouver une autre formule, il est convenu de ne pas la faire figurer dans le titre de la conférence[33]. Tous cependant, Anglais, Américains, Français, s'accordent tacitement pour qu'il ne soit pas fait ouvertement mention de « Juifs » de crainte de favoriser l'antisémitisme et, ajoute-t-on chez les derniers, de paraître se rallier à un esprit de discrimination contraire à la tradition républicaine. Mais cet euphémisme a aussi, et peut-être surtout, pour fonction de ne pas fournir un argument supplémentaire à la campagne fasciste contre les démocraties « enjuivées ». A Paris et à Londres plus qu'à Washington, en revanche, l'on juge essentiel de couper court aux tentatives faites pour élargir le débat à l'ensemble de la « question juive » en limitant expressément la compétence de la conférence aux réfugiés en provenance d'Allemagne et de l'ex-Autriche. A ce propos, ses partenaires européens regrettent fort de voir Washington persister à inclure dans l'ordre du jour non seulement le sort des réfugiés proprement dits, mais aussi celui des aspirants à l'émigration; c'est, à leurs yeux, un « chèque en blanc », « un encouragement pour les Juifs allemands à quitter leur foyer » comme pour ceux de Pologne et de Roumanie[34]. Anxieuse de limiter les dégâts, la France pèse pour ne pas donner finalement à la rencontre d'Évian le lustre d'une véritable « conférence »; simple « comité intergouvernemental », son titre officiel désormais, elle devrait n'être qu'une réunion de travail ne justifiant ni la convocation officielle des organisations privées ni la tenue de séances publiques[35].
La France accepte-t-elle d'accueillir encore des réfugiés ? Non, bien entendu. Elle a déjà rempli, assure-t-on à grand renfort de statistiques, plus que son devoir d'humanité; « saturée », elle doit encore s'attendre à « une immigration discrète {...} au cours des mois prochains[36] ». Tout au plus pourrait-elle accepter à titre individuel quelques personnalités « utiles pour l'économie et le patrimoine intellectuel » et un rôle de transit pour des émigrants dûment munis de subsides, d'un visa et d'un billet pour l'outremer[37]. Aussi la question du « triage » apparaît-elle le 11 juin, pour éviter « que le Reich ne mette à profit la bonne volonté dont témoigneront les autres pays pour se débarrasser de tous les éléments qui le gênent ou qui l'inquiètent et que, finalement, toute l'opération {...} ne se traduise par un solde en faveur du gouvernement allemand ». De peur d'hériter des seuls « déchets de toute l'immigration autrichienne ou allemande », le triage devrait « se faire impérativement avant l'arrivée en France, sous l'égide d'une commission dominée par l'élément américain[38] ». L'empire ? L'Algérie écartée « étant donné l'acuité du problème anti-juif » sur place, tout juste pourra-t-on laisser espérer l'installation de « quelques centaines de familles de colons » en Nouvelle-Calédonie et de « quelques milliers » à Madagascar, bien que « la colonisation juive dans notre domaine d'outre-mer {offre} à tous égards, maintient Mandel, plus de dangers que d'avantages[39] ».
Pourrait-elle au moins faire le geste de ratifier la convention signée le 10 février 1938 sous l'égide de la SDN et dont le but est de doter les réfugiés allemands, russes, arméniens et assimilés d'un statut et de garanties juridiques? Pourrait-elle surtout accepter d'en étendre le bénéfice aux ex-Autrichiens ? Pas davantage, tranche-t-on après quelques hésitations[40]. La France se présente donc à Évian « en position non de demanderesse mais de défenderesse[41] », une attitude qui ne risque guère, elle le sait bien, de la singulariser à Évian.
Quant à l'organisme permanent que veulent créer les Américains, les Français ne lui sont pas hostiles, contrairement aux Anglais. Une collaboration future entre celui-ci et le nouveau Haut Commissariat de Londres est néanmoins souhaitée afin d'« éviter les chevauchements » préjudiciables au prestige de ce dernier[42]. L'expérience acquise mérite bien du reste des égards que les Etats-Unis ne semblent pas vouloir marchander, même s'ils répugnent à définir, pour ménager leur opinion, les termes précis d'une « collaboration » avec Genève[43]. Entre Anglais et Américains, le Quai s'emploiera donc à dégager un compromis, à condition toutefois que Washington renonce à établir à Paris le siège de la nouvelle institution internationale. En 1933, la France a soutenu l'installation à Londres du Haut Commissariat pour les réfugiés. En 1938, Paris se soucie moins encore d'abriter « un centre d'attraction pour tous les individus en rupture d'établissement, en même temps que le foyer des revendications et des protestations provoquées par les persécutions présentes et futures ». « Est-il dans l'intérêt de la France d'apparaître », souligne Bérenger dans des termes bien peu républicains, « {...} comme l'asile officiel de tous ceux que l'Allemagne considère comme ses ennemis naturels ? Un élément d'antagonisme culturel et racial serait introduit à titre permanent dans les relations franco-allemandes[44] . » Le raisonnement vaut aussi pour l'Italie qui a décliné l'invitation américaine par solidarité avec l'Allemagne, comme il engage la France à refuser la présidence de la conférence que les Américains, désireux de partager le fardeau d'une initiative dont ils commencent à mesurer les périls, comptent lui abandonner[45].
Éviter de mettre Paris en avant, ménager le Reich, complaire si possible aux États-Unis et à l'Angleterre, tels sont donc les guides de la politique « prudente et modérée {. . .} sans être négative » que met en oeuvre Bérenger, avec un succès certain, du 6 au 15 juillet à l'Hôtel Royal d'Évian, siège de la réunion[46]. Au terme d'un assaut de politesses hypocrites, Taylor se résigne, le 7, à accepter la présidence de ce qui se présente plus en définitive, sous la pression de l'opinion publique, comme une conférence que comme la session de travail privée envisagée à l'origine[47]. Pas invités, mais libres de venir à leur gré, les représentants d'une quarantaine d'organisations privées -- dont vingt juives -- ont fait le déplacement, ainsi qu'une centaine de journalistes. Il fallut consentir à tenir publiquement la presque totalité des séances et à former deux sous-comités pour recevoir, en privé, des informations sur les législations et les pratiques en matière d'immigration, ainsi que les rapports des organisations[48]. Ces improvisations n'auront guère d'incidence sur les négociations qui se tiennent en coulisses. Elles en auront davantage sur l'image -- désastreuse -- de la conférence dans l'opinion, tenue informée, à l'étranger du moins, de la comédie en train de se jouer; car la presse française semble s'être davantage pliée aux consignes de discrétion délivrées par Bérenger lui-même[49].
Du coup, la rencontre tourne à un forum où s'étalent sans vergogne les égoïsmes. Parmi les orateurs des trente-deux Etats venus uniquement justifier la fermeture de leurs pays à l'immigration, Bérenger n'est pas en reste: la France, assène-t-il d'entrée de jeu, en est « au point extrême de saturation, si elle ne l'a pas déjà dépassé[50] ». Tandis que le chef de la délégation britannique, lord Winterton, annonce de très vagues possibilités d'établissement en Afrique anglaise et la décision de Londres d'appliquer la convention de 1938 étendue aux ex-Autrichiens, Bérenger se garde de l'imiter, ne mentionnant même pas l'empire, pas plus d'ailleurs que le fameux « triage » désormais sans objet. Acceptant sans murmure le refus de Londres de voir soulevée la question palestinienne, il désigne crûment le continent américain et les dominions -- l'Australie surtout -- comme la clé du problème. Plus que l'Angleterre, la France se fait à Évian le porte-parole d'un Vieux Monde anxieux d'obtenir l'« écoulement » des réfugiés européens dans les territoires « vides » du nouveau, lequel, naturellement, s'y refuse énergiquement. Parlant au nom des États-Unis, Taylor chante les mérites de son pays qui, dit-il, peut être « fier de la libéralité de ses lois et de ses méthodes actuelles[51] ». Quant aux dominions et aux nations d'Amérique latine, unanimes, à l'exception de la République dominicaine, à proclamer leur incapacité à accueillir de nouveaux réfugiés -- sauf peut-être des travailleurs agricoles --, ils s'abandonnent parfois à des excès de langage frappés au coin d'un antisémitisme rampant. Ainsi l'Australie déclare préférer l'immigration britannique, car, sans « problème racial réel » chez elle, elle juge inutile « d'en créer un[52] ». Mêmes relents douteux dans les déclarations péruviennes: « l'Europe si troublée » doit comprendre « qu'un continent au moins {doit} rester libre de la haine et de l'esprit de vertige[53] ». Ces joutes n'ont d'autre but évidemment que de faire porter aux autres la responsabilité d'un échec qui ne surprend personne, y compris les instigateurs américains.
C'est bien pourquoi le véritable objectif des Américains à Évian est d'obtenir la création, sous leur houlette, d'un organisme permanent capable d'engager un dialogue avec le Reich[54]. Paris est tout disposé à suivre Washington sur ce point et à considérer Évian comme « le commencement d'une grande action collective » en faveur des réfugiés, moyennant cependant des assurances et à condition que les Américains en assument la conduite effective, conceptions propres à rallier les Anglais[55]. Discuté en coulisses entre Taylor, Bérenger et Winterton, le texte de la résolution finale se rapproche sensiblement des conceptions françaises; les « réfugiés politiques » deviennent des « immigrants involontaires », et la Grande-Bretagne se résigne à la création d'un comité intergouvernemental permanent, « pour répondre à la préoccupation de Washington de se tenir à l'écart de Genève » et parce que, pour négocier avec le Reich, « une organisation complètement indépendante de Genève était bien préférable[56] ». Son siège sera à Londres, comme celui du nouveau Haut Commissariat de la SDN, pour favoriser leur « coopération » future, les Anglais n'ayant pu établir un lien de subordination entre les deux organismes. Les principales responsabilités sont fixées: au côté d'un président « forcément anglais », le directeur, un Américain, aura le rôle majeur. Avec une vice-présidence sur les quatre prévues[57], la France a donc pleinement réussi à placer les États-Unis devant leurs responsabilités et à minimiser, dans toute la mesure du possible, les siennes.
La négociation envisagée -- dont rien ne garantit d'ailleurs que le Reich accepte le principe -- vient au secours des impératifs de la politique d'apaisement de la France pour justifier que le texte soit purgé de toute considération morale sur les persécutions. Comme les orateurs à la tribune, les rédacteurs de la résolution se bornent à exprimer le voeu d'« obtenir la collaboration du pays d'origine », pays jamais nommé et jamais stigmatisé pour ses agissements. Termes jugés pourtant encore trop audacieux par nombre de républiques sud-américaines en raison des « moyens de pression économiques dont le Reich disposerait vis-à-vis de leurs pays respectifs {les livraisons de matières premières effectuées par ces pays en effet n'ayant pas encore reçu leur contrepartie][58] ». Tout le poids des États-Unis, et une manoeuvre de séance des trois « grands », furent nécessaires pour arracher leur consentement. Encore fallut-il, pour assurer un vote unanime le 15, que Taylor endossât seul la responsabilité du texte final et qu'il fût stipulé que cette « recommandation » n'obligeait pas ses signataires[59]. Tout en se félicitant que la manifestation d'Évian ait « fait ressortir l'esprit de collaboration existant entre les trois grandes démocraties », Paris -- comme Londres -- entend demeurer en seconde ligne. « Dans l'ensemble », estiment en effet les négociateurs français, « le texte de la Résolution nous paraît rédigé, et parfois même contradictoire[60]. » Harcelés notamment par la diplomatie roumaine, ils demeurent réservés sur l'inclusion dans la compétence du comité des réfugiés « potentiels », comme sur l'insertion d'une phrase obscure préservant peut-être les chances d'une extension ultérieure des compétences géographiq ues du comité[61]. « Mais, ajoutent-ils, il a semblé préférable de ne pas remanier entièrement le projet américain afin d'en laisser la pleine responsabilité à ses auteurs », d'autant que la France « fa réussi} pleinement {...} à éviter de contracter aucun engagement précis[62] ».
La France au comité intergouvernemental de Londres
(1938-1939)
Si les véritables intentions et le degré de détermination du Département d'État ne sont pas toujours évidents avant Évian, la diplomatie américaine se montre décidée, une fois le comité permanent créé, à relever à travers lui le double défi qu'il s'était fixé: trouver des possibilités d'établissement et négocier avec le Reich[63]. Sous son impulsion, le bureau du Comité intergouvernemental pour les réfugiés (CIR) est composé, le 3 août 1938, de Winterton à la présidence, de Taylor et Bérenger comme vice-présidents -- en attendant la désignation des deux autres --, tandis que George Rublee, un avocat rompu aux tractations internationales et proche de Roosevelt, occupe le poste stratégique de directeur exécutif, assisté de son compatriote, le diplomate R. Pell. Que peuvent-ils attendre des Français qui, au lendemain d'Évian, se reconnaissent l'« obligation morale » de « ne pas abandonner la recherche d'une solution du problème donné[64] » ? Pas plus au fond que ce que laissent entendre ces termes pris au pied de la lettre: Paris s'est engagé à chercher, pas à trouver, une solution. Coopérative dans la forme, l'attitude française est généralement, sur le fond, d'indifférence et d'obstruction.
Paris n'a pas apprécié tout d'abord de se voir imposer certaines dispositions de fonctionnement. La délégation française -- désignée tardivement -- ne retrouve pas à Londres l'avantage de sa position d'Évian entre Américains et Anglais, ces derniers préférant éviter, dans toute la mesure du possible, de contrarier Washington alors que la guerre menace[65]. Ils se satisfont d'ailleurs de la solution pragmatique donnée au problème de la collaboration entre le comité et le Haut Commissariat de la SDN par l'association de fait du haut commissaire aux travaux du comité, en attendant qu'après la démission de Rublee, en février 1939, le haut commissaire, sir Herbert Emerson, cumule ses fonctions avec celles de directeur du comité de Londres, « les deux organes demeurant cependant distincts[66] ». Isolés, les Français doivent accepter la primauté des États-Unis au sein du bureau, et surtout un budget trop élevé à leur gré. Ils ne devaient jamais du reste s'acquitter de leurs obligations financières avec diligence[67].
Quant à sa mission proprement dite, Rublee ne tarde pas à comprendre qu'elle ne lui sera pas facilitée par ses partenaires, notamment français. Arrivé à Londres vers la mi-août en pensant chercher immédiatement le contact avec le Reich, il doit se rendre aux raisons, très sérieuses au demeurant, de Bérenger et de Winterton: la crise des Sudètes et la tension internationale extrême imposent un report. Au moins compte-t-il, en attendant, poursuivre « aussi activement que possible » la recherche de possibilités d'établissement, question primordiale en fait, puisque, résolue, elle aurait pu lui donner du crédit auprès du Reich[68]. Or la France ne brille pas par son ardeur à proposer des solutions constructives.
Avant comme après la Nuit de cristal (10-11 novembre 1938), alors que s'enfle le flot des réfugiés, la fermeture du territoire métropolitain reste un dogme justifié par l'état de « saturation » du territoire, à moins que l'on n'invoque le risque de « graves difficultés politiques » ou celui « qu'un afflux d'israélites ne viennent provoquer des différends d'ordre racial » en France[69]. Quant à l'empire, on n'en parle à l'occasion que pour faire mine d'accompagner les efforts d'investigation des Anglais et des Américains. S'étant déjà enquis de l'état du projet Madagascar, Sumner Welles rappelle en novembre les promesses faites par Daladier et Bonnet « d'étudier sans délai la possibilité d'établir un certain nombre de réfugiés juifs dans les colonies françaises[70] ». On songe alors vaguement au Togo, ancienne colonie allemande confiée en mandat à la France après la Grande Guerre comme l'avait été le Tanganyika, dont il est aussi question comme refuge possible, à l'Angleterre. Mais Paris ne donne pas suite, partie pour les motifs évoqués dès avant Évian, partie à cause de la violence de la réaction allemande[71]. Si, en décembre, mois où Georges Bonnet reçoit Ribbentrop à Paris, la France se déclare prête à accueillir 10 000 réfugiés dans l'empire, c'est à la condition, évidemment peu réalisable, que cette mesure entre « dans le cadre d'un plan général auquel chaque Etat participerait d'une façon effective[72] ». En juillet 1939, Bérenger, soutenu en l'occurrence par Taylor, réagit vivement contre la suggestion faite par Winterton d'engager, contrairement à l'un des principes cardinaux d'Évian, des fonds publics dans l'oeuvre d'établissement[73]. En fait, la France se lave les mains du sort des réfugiés juifs européens; aux États-Unis estime-t-elle, d'y pourvoir.
Cet état d'esprit, la France le partage bien entendu avec bien d'autres nations, notamment celles d'Amérique latine restées fixées, elles aussi, sur leurs positions d'Évian[74]. Les États-Unis demeurent, pour leur compte, intraitables sur les quotas comme l'Angleterre sur la Palestine. Mais ces démocraties se montrent malgré tout plus sensibles à la tragédie qui gagne en ampleur, surtout après la Nuit de cristal. Les Anglais ouvrent alors leurs portes à quelques milliers d'enfants rescapés, tandis que Roosevelt évite l'expulsion à 10 000 à 15 000 réfugiés détenteurs de visas provisoires sur le sol américain. Londres prospecte l'empire, la Guyane britannique notamment, après le Tanganyika, le Kenya, la Rhodésie du Nord et le Nyasaland. Sous son influence, les dominions assouplissent parfois leur réglementation, l'Australie admettant finalement 15 000 réfugiés. Roosevelt pour sa part ne cesse d'agiter toutes sortes de projets d'établissement, aussi grandioses souvent que fantaisistes, en Asie et en Amérique du Sud, voire en Éthiopie italienne[75]. Sans doute est-ce à un constat d'impuissance qu'aboutissent les autorités anglaises et américaines. Ont-elles vraiment cru d'ailleurs à leurs chances de réussir ? Il serait hasardeux de l'assurer, et il est permis de penser que Roosevelt aurait davantage fait la preuve de son humanitarisme en prenant le risque politique d'ouvrir plus grandes les portes de l'Amérique qu'en prospectant les déserts étrangers. Reste que ces puissances ont cru bon d'accomplir des gestes, même symboliques, dont la France s'est tenue pour dispensée.
Celle-ci s'intéresse un peu plus, à l'origine, à la perspective de négociations avec Berlin, ce qui explique sa déception devant la nomination de Rublee, une personnalité de second plan selon elle[76]. Sitôt la crise des Sudètes passée, Bérenger se déclare partisan de pousser le projet en avant et la France accomplit, sans se faire prier, une démarche concertée avec Londres et Washington auprès de la Wilhelmstrasse pour obtenir que Rublee soit reçu à Berlin[77]. « Aucun de ces États », souligne la note verbale remise par son chargé d'affaires le 24 octobre, « ne conteste au gouvernement allemand le droit absolu de prendre à l'égard de certains de ses ressortissants des mesures qui relèvent uniquement de l'exercice de sa souveraineté. Ils estiment toutefois que ces mesures, qui provoquent ou développent le mouvement d'émigration dont il s'agit et débordent ainsi le cadre d'une affaire purement allemande, font apparaître d'autant plus désirable la collaboration du gouvernement du Reich à une solution prompte et équitable à laquelle il est lui-même intéressé à divers titres[78]. » Mais Berlin ne consent à répondre à ces avances qu'après la Nuit de cristal, au moment même où, pour protester contre le pogrom, les démocraties rappellent leurs ambassadeurs en consultation. Au sein du cercle dirigeant nazi, les partisans de la manière forte en matière juive comme le ministre des Affaires étrangères, Joachim von Ribbentrop, voient en effet leur influence reculer devant celle d'hommes comme Goering et Schacht, respectivement chef du Plan de quatre ans et président de la Reichsbank, qui discernent dans l'affaire des réfugiés le moyen de porter remède à la grave crise des exportations et des devises qui gêne alors le réarmement allemand. C'est même avec l'aval de Hitler qu'en décembre 1 938 Schacht prend discrètement contact avec Rublee[79].
Un résumé des tractations extrêmement complexes qui se déroulent entre le directeur du comité et Berlin suffiront à notre propos. Rublee et Pell, son adjoint, rencontrent à plusieurs reprises Schacht, à Londres d'abord en décembre 1938, puis à Berlin en janvier suivant. Un accord est à portée de main lorsque le directeur de la Reichsbank est brusquement démis de ses fonctions, sans que cette disgrâce ait rien à voir avec la négociation en cours. La preuve: Goering désigne aussitôt un nouveau représentant, un fonctionnaire de son administration, le conseiller Helmut Wohlthat, pour reprendre les pourparlers au point où ils en sont restés. Le 1er février, les négociateurs échangent des mémorandums confidentiels, chacun récapitulant des décisions présentées comme unilatérales et dont l'exécution est présentée comme indépendante de l'autre partie. Ce curieux arrangement -- qui n'est pas un accord, l'Allemagne refusant de reconnaître le comité et les puissances animant ce dernier préférant ne point trop se compromettre -- prévoit notamment le départ organisé de 150 000 Juifs allemands aptes au travail dans les trois à cinq années à venir, leurs parents -- groupe évalué à 250 000 personnes -- devant les rejoindre dès que possible. Un Trust Fund (fonds de garantie), alimenté par le quart des avoirs des Juifs allemands, se chargerait de financer le transport des émigrés et des achats de fournitures diverses, sans compter l'entretien des 200 000 Juifs âgés ou invalides qui, eux, ne quitteraient pas l'Allemagne. Hors d'Allemagne, une Coordinating Foundation rassemblant des fonds privés du « judaïsme international » se constituerait simultanément pour faire la liaison avec les autorités allemandes et négocier les marchandises sorties d'Allemagne de manière à dégager les fonds nécessaires à la réinstallation. Jugeant alors sa tâche accomplie, Rublee démissionne, abandonnant à Emerson le soin de découvrir des lieux d'établissement et à Pell, devenu vice-directeur, celui de me ttre l'arrangement en oeuvre[80].
Quel rôle tient la France dans toute cette affaire ? Son intérêt initial tourne vite à la désillusion lorsqu'elle est informée, en décembre 1938, des premières propositions de Schacht. Au comité des experts techniques, réuni à Londres le 20 décembre, ses représentants, Emmanuel Mönick, l'attaché financier à Londres, et Georges Coulon, signifient sans ambages « qu'il ne pouvait pas être donné suite {...} parce que ce plan supposait l'émission d'un emprunt international dont le service aurait été lié à un accroissement des exportations allemandes »; une « prime scandaleuse » au persécuteur et un encouragement pour d'autres gouvernements à agir de même, estime-t-on à Paris, comme d'ailleurs à Londres et à Washington[81]. Les pourparlers se poursuivant néanmoins avec Schacht, puis Wohlthat, Rublee en tient informé le bureau du comité, réuni au Quai d'Orsay, le 23 janvier 1939. Bérenger veut bien prendre acte de l'abandon de l'idée d'un emprunt international ainsi que du lien fait antérieurement entre « l'émigration méthodique » et l'augmentation des exportations allemandes. Mais il ne croit pas pour autant, contrairement aux affirmations de Rublee, que les Allemands aient vraiment « renoncé à un accroissement de leurs exportations du fait de l'émigration involontaire » et maintient donc les « réserves » déjà exprimées par les experts en décembre. Il juge par ailleurs « très humiliant » que l'Allemagne se refuse à reconnaître le comité et d'un caractère par trop « incertain » nombre de points de l'arrangement[82]. Dès ce moment, en fait, la France est résolue à enterrer l'affaire tant elle redoute que l'Allemagne ne cherche à mettre le comité « devant un fait accompli qu'il pourrait être déshonorant » -- et, ajouterons-nous, coûteux -- « d'accepter ». Avec Taylor et Winterton qui s'efforcent surtout de calmer les esprits, il convient cependant de « la nécessité de laisser poursuivre les négociations sans se commettre en aucune manière ». Seul l'Américain veut encore croire aux chances d'un règlement; ses deux partenaires européens ne voient en fait plus d'autre intérêt à cette affaire que de concourir à l'esprit d'apaisement, même si l'Anglais exprime son scepticisme avec plus de ménagement que le Français[83].
Prenant la tête des puissances secondaires représentées au bureau, la délégation française ne se départit plus désormais de cette attitude dilatoire. Les 13 et 14 février 1939, à Londres, lors d'une réunion plénière du comité, la France préconise et obtient sans mal « le vote d'une motion conçue en termes aussi généreux que possible n'entraînant aucun engagement de notre part, mais évitant cependant de donner l'impression d'un échec des pourparlers[84] ». Le comité se borne donc « à prendre note » du résultat des négociations et exprime son intention de l'« étudier ». Malgré les promesses de Bérenger lors de la session du 20 juillet 1939, Paris semble s'être bien gardé de pousser, contrairement à Londres et surtout à Washington, à la constitution de l'organisme privé international censé, selon l'Arrangement, financer la réinstallation des réfugiés[85]. Privé, cet organisme doit, selon les Français, ne bénéficier d'aucune sorte de sollicitude officielle. Peu leur chaut qu'en son absence il n'ait pas la moindre chance de voir le jour, vu la répugnance marquée par les capitalistes juifs sollicités[86]. L'Allemagne en tirant de toute façon argument pour ne pas créer, de son côté, le Trust Fund, le processus de règlement s'enlise avant même d'avoir connu un début d'exécution. Raison de plus pour qu'à Paris on s'étonne de l'insistance mise par Roosevelt à maintenir, une fois la guerre déclarée, la réunion du comité à Washington les 16 et 17 octobre 1939. On s'exécute cependant car il importe plus que jamais de maintenir vivantes toutes les formes de collaboration entre les démocraties[87]. Quant à résoudre le problème des réfugiés, voilà des mois que la France, qui ne s'est jamais montrée t rès coopérative, ne s'en soucie pas le moins du monde.
Que conclure de cette étude ? Elle vient confirmer tout d'abord les travaux réalisés à partir des archives anglaises et américaines: la démarche inaugurée par Washington à Évian vise bien à lancer une nouvelle politique des réfugiés, globale et multilatérale. Fruit des efforts déployés alors par Roosevelt pour relancer dans différents domaines la coopération internationale, elle mérite de figurer au nombre des initiatives qui éloignent progressivement les Etats-Unis des horizons isolationnistes.
Son échec, ensuite, est moins celui de la conférence de juillet 1938 proprement dite que celui du CIR fondé pour mener son programme à bien. Échec logique sans doute, en dépit de la conclusion inespérée de l'arrangement Rublee-Wohlthat. Non tant du fait d'ailleurs des autorités nazies, qui semblent bien, dans l'état actuel des connaissances, avoir vu en lui une base possible pour la réalisation de la politique de règlement de la « question juive » par l'émigration qui est alors la leur[88]; mais du fait des démocraties, rendues méfiantes par les exactions du Reich[89], et incapables de trancher le noeud de contradictions politiques et morales que recèle inévitablement un marché passé avec un partenaire inaccessible aux valeurs morales qui les inspirent. Traiter avec les nazis, cela ne revient-il pas à les aider à régler leur « problème juif » ? N'est-ce pas capituler devant le racisme et devant une barbarie que l'on imagine alors à son summum ? N'est-ce pas, à terme, compromettre le destin des autres Juifs en Europe ?
Aussi nous semble-t-il globalement inexact de voir dans cette politique internationale des réfugiés la préface de l'abandon dans lequel se sont trouvés les Juifs européens pendant la Shoah. Car, dans l'esprit de ses inspirateurs, cette tentative, si limitée soit-elle dans ses objectifs et dans le cadre auquel elle se cantonne, vise à chercher par les voies nouvelles de la coopération interétatique le remède au désordre et aux souffrances des Juifs du Reich. Elle nous semble à ce titre appartenir de plein droit à l'histoire d'une diplomatie humanitaire que l'on entreprend tout juste d'écrire[90].
Cela dit, une distinction s'impose entre les démocraties qui s'y sont associées. Sans être dépourvue d'ambiguïtés et de calculs, l'attitude américaine tranche par sa générosité relative sur celle, décidément négative, de la France, comme, mais à un degré moindre, sur celle du Royaume-Uni. Car il serait tout aussi inexact de mettre les démocraties dans le même sac que d'opposer sommairement la bonne volonté américaine -- limitée, on le sait -- à l'égoïsme européen, les positions et les tactiques développées par la France et le Royaume-Uni différant sensiblement. Sur le fond des valeurs morales communes, le niveau de la conscience humanitaire suit à l'évidence le baromètre des réalités de la puissance et de la proximité de la menace. On ne peut manquer pourtant d'être frappé non pas tant par l'absolu manque de générosité de la politique française que par son indifférence à en préserver même les apparences et par la fréquence de propos à tendance antisémite dans la bouche d'officiels républicains dans l'exercice de leurs fonctions. Les exigences du prestige -- alors même que bien des traits de cet épisode d'Évian trahissent la dégradation de la puissance française --, l'implication américaine et la poursuite d'une politique d'apaisement en Europe justifient, seuls, la participation au CIR. Sous couvert de realpolitik, la France officielle de Daladier et de Bonnet a bel et bien abandonné les Juifs. C'est déjà, de la part de la patrie des droits de l'homme et de l'émancipation, une capitulation morale de bien triste augure.
____________________________
Server / Server
© Michel Fingerhut 1996-2001 - document mis à jour le 09/11/1998 à 20h22m04s.
Pour écrire au serveur (PAS à l'auteur)/To write to the server (NOT to the author): MESSAGE